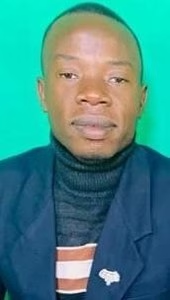Le principe de continuité de l’État est crucial dans la théorie juridique du début du 20ème siècle, soulignant son importance en tant que loi selon Rolland. Cet article explore son déclin contemporain face à l’évolution de l’intervention publique et des pratiques de gestion.
§2. Principe de continuité de l’État
Le principe de continuité était dans la théorie juridique du début du 20ème siècle d’une importance exceptionnelle. C’est d’ailleurs le seul que Rolland désigne expressément du terme de « loi ». Aujourd’hui ce principe semble passer au second plan, probablement parce que cette continuité ne pose plus, dans les faits, en raison de l’extension de l’intervention publique, du niveau économique et de l’expérience de gestion, de véritable problème1. Pour la théorie du service public qui ne considérait l’État que comme un faisceau de services publics, la valeur de ce principe est fondamentale et aujourd’hui, le principe de continuité des services publics est un principe à valeur constitutionnelle2.
Contenus du principe : fondement des affaires courantes
Selon le professeur GILLES GUGLIELMI, en vertu du principe de continuité de l’État, une personne publique est tenue de faire fonctionner régulièrement les services publics dont elle a la charge sans autres interruptions que celles prévues par la législation en vigueur. Dans le cas où cette personne publique manquerait à son obligation, et en présence d’un préjudice, il pourrait y avoir lieu à l’engagement de la responsabilité publique3.
Ainsi, pour le compte du professeur Félix VUNDWAWE, la continuité de l’État est un principe général de droit constitutionnel selon lequel l’État doit continuer à assurer l’ordre public et à offrir ses services à sa population, quelles que soient les circonstances4. Par ailleurs, Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE, souligne que le principe de continuité de l’État réside dans la mission essentielle de l’État, celle de garantir la continuité de la gestion des affaires du pays.
Ainsi, l’État opérant la jonction entre l’ordre interne et l’ordre international, la continuité de l’État réfère à l’idée de sa préservation dans le temps, nonobstant les mutations légitimes qui peuvent l’affecter à travers ses composantes (territoire, population et puissance publique). Cela a comme conséquence que le gouvernement est responsable des engagements pris par son prédécesseur au niveau interne qu’au niveau international5. En plus, la continuité de l’État n’est pas entamée en cas de changement de régime ni en cas de changement de dirigeants politiques. Par voie de conséquence, on ne peut pas s’y fonder pour pérenniser ad vitam le pouvoir d’un individu6.
En effet, en RDC, l’article 69 al.3 de la Constitution du 18 février 2006 concrétise le principe de continuité de l’État, en confiant les prérogatives au Président de la République d’assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l’État7. Cette disposition constitutionnelle ne définit pas le principe de continuité de l’État, elle confère uniquement au Président de la République en exercice la compétence d’assurer cette continuité en vue de préserver la permanence de la vie nationale8.
La Cour constitutionnelle a également soulevé le principe de continuité de l’État à l’occasion de l’Affaire du recours en interprétation de l’article 70 de la Constitution du 18 février 2006 telle modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 en relation avec les articles 75, 103, 105 et 197 de la même constitution, en ce sens : « L’alinéa 2 de l’article 70 permet au Président de la République arrivé fin mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l’État, jusqu’à l’installation effective du nouveau Président de la République élu »9. Le juge constitutionnel, non plus, n’a donné aucune définition du principe de continuité d’État. Par ailleurs, le principe de continuité de l’État a été défini par SERGE GUINCHARD comme étant un principe selon lequel le Gouvernement ne peut répudier les obligations souscrites par son prédécesseur10.
À cet effet, le principe de continuité de l’État est un principe général de droit constitutionnel selon lequel l’État doit continuer à assurer l’ordre public et à offrir ses services à sa population, quelles que soient les circonstances11. Selon ce principe, l’État ne meurt jamais, ses institutions doivent fonctionner sans interruption pour satisfaire l’intérêt général, c’est aussi l’application de l’ancien adage : « le Roi ne meurt jamais »12.
En effet, la continuité de l’État peut être considérée comme corollaire du droit de la population aux services étatiques. Pour cela, l’État ne doit pas s’arrêter, ni lui-même, ni dans ses institutions, ni dans ses compétences. Cela suppose la permanence de l’État dans son existence, dans ses institutions et ses activités13. Car au sens étymologique du terme, l’État, c’est ce qui est stable. Ou ce qui devrait l’être. C’est sous le signe de la continuité, de la stabilité, de la permanence que l’État organise ses institutions et développe ses activités14.
Cela étant, le Conseil d’État fait toutefois remarquer, à juste titre, que le principe de continuité des services publics n’est pas un principe constitutionnel, mais plutôt à valeur constitutionnelle et relevant plus du Droit administratif que du Droit constitutionnel15. Ainsi, le Conseil d’État français a affirmé qu’il s’agit d’un principe général du droit16.
À l’occasion de l’affaire Dame Bonjean, le Conseil d’État a également souligné son importance, en le qualifiant de « principe fondamental »17. En effet, en RDC, la Loi organique 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, prévoit le principe continuité des services publics parmi les principes fondamentaux qui régissent les services publics congolais18.
Ainsi, selon le législateur congolais le service public est continu et assuré en permanence dans toutes ses composantes. Le non-respect de ce principe peut engager la responsabilité envers tout intéressé ayant subi un préjudice de ce fait19.
Par ailleurs, les deux professeurs Félix VUNDWAWE et Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE distinguent deux variantes de la continuité de l’État : la continuité ontologique ou existentielle (A) et la continuité institutionnelle(B).
La continuité ontologique de l’État
La continuité ontologique ou existentielle veut que les éléments constitutifs de l’État persistent et ne disparaissent pas en aucune circonstance. Il s’agit du territoire, de la population et la puissance publique ou le Gouvernement. Par conséquent, lorsqu’un de ces éléments est atteint, c’est l’État qui est entamé et qui risque de disparaitre juridiquement20. C’est ainsi que, le Chef de l’État veille à l’intégrité territoriale, à la souveraineté nationale et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics21.
La continuité institutionnelle de l’État
La continuité institutionnelle signifie que les institutions ne peuvent pas disparaitre tant que ne sont pas abrogées les normes portant son organisation et son fonctionnement. C’est pourquoi, elle peut être organique (1) ou fonctionnelle (2).
Continuité institutionnelle organique
La continuité organique de l’institution part du postulat selon lequel les organes étatiques sont des institutions qu’il ne faut pas confondre avec les individus qui les incarnent. « Les hommes passent, mais les institutions restent »22. En effet, l’alternance démocratique qui s’effectue à travers l’organisation des élections par lesquelles un mandat est octroyé aux individus dans un État démocratique ne supprime pas l’institution. Celle-ci continue d’exister, même si les dirigeants ont changé23.
Il en est de même lorsque le dirigeant démissionne, meurt, soit empêché par toute autre circonstance. Telle est la raison d’être de l’article 31 de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, dispose : « En cas d’adoption d’une motion de censure, le Gouvernement provincial expédie les affaires courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Gouvernement »24. Aussi, de l’article 81 de la Loi organique n° 08/016 du 0 7octobre 2008 portant composition et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les provinces prévoit également qu’en cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Chef de chefferie pour un fait portant atteinte à l’honneur ou à la dignité, les trois Echevins expédient collégialement les affaires courantes en attendant la désignation du nouveau Chef de chefferie25.
Enfin, le professeur Félix VUNDWAWE affirme que l’État doit continuer à assurer l’ordre public et à offrir ses services à sa population quelles que soient les circonstances26. Par conséquent, aucune circonstance, nature ou artificielle, voulue ou non voulue par l’autorité administrative ou politique, ne peut empêcher le fonctionnement des institutions de l’État. Il en est ainsi du cas de démission, qui malgré la désinvestiture du Gouvernement, dans le souci de sauvegarder la continuité de l’État, il expédie les affaires courantes.
Continuité institutionnelle fonctionnelle
Selon la continuité fonctionnelle, toute institution étatique doit accomplir la fonction que lui confère le droit. Ainsi, en vertu de la continuité fonctionnelle, lorsqu’une institution n’est pas encore mise en place ou que les individus qui l’incarnent sont dans l’impossibilité d’accomplir ses compétences, celles-ci doivent être exercées par une autre institution ou par d’autres individus.
Il résulte de la continuité fonctionnelle que, quelles que soient les circonstances, l’activité de l’État doit continuer à se déployer à travers le fonctionnement de ses institutions. La continuité fonctionnelle est concrétisée notamment par l’article l’art. 70 al. 2, de la Constitution de la RDC, consacre à la fois la continuité fonctionnelle et celle du mandat. Elle dispose : « À la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu »27.
Aussi, l’article 126 de la loi précitée, le législateur congolais prévoit qu’en attendant l’organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales28.
En effet, le principe de continuité fonctionnelle fonde, entre autres, les différents transferts de compétence organisés pour faire face à la conjoncture, à la carence ou à l’empêchement des autorités politiques et administratives. En l’espèce, ce sont les compétences des autorités démissionnaires qui doivent continuer, et non la personne qui incarne l’institution et en exerce les compétences.
La distinction doit être opérée clairement entre l’activité de l’État et l’homme d’État qui a reçu un mandat. Enfin, la continuité fonctionnelle est à distinguer de la continuité de mandat dont la question se pose en cas d’abrègement d’un mandat causé par une circonstance indépendante de la volonté du mandataire. La continuité de mandat est une spécificité de la continuité fonctionnelle. Elle est mise en œuvre par le mécanisme consistant à assurer l’intérim ou la suppléance de celui qui exerce une fonction étatique en vertu du mandat en cours et qui se trouve empêché. C’est pourquoi, en cas d’absence ou d’empêchement, l’autorité peut être remplacée provisoirement par un collaborateur29.
En fin de compte, en raison de ce qui précède, l’existence du principe de continuité de l’État ou de continuité de services publics exprime la quintessence du fondement de la théorie d’expédition des affaires courantes.
________________________
1 Comme c’était le cas dans l’Affaire Fondation d’utilité publique « Comité belge pour l’UNICEF» et crt c/ État Belge, les requérants avaient soulevé l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte pris en affaires courantes. ↑
2 Art. 96, Constitution coordonnée de l’État belge du 17 février 1994, disponible sur : https://www.ejustice.just.fgov.be/cg, consulté le 12 octobre 2022. ↑
3 J. GILLES GUGLIELMI, Une introduction au droit du service public, Paris, Collection « Exhumation d’épuisés », p.17. ↑
4 Ibidem. ↑
5 J. GILLES GUGLIELMI, Op.cit., p.17. ↑
6 F. VU NDUAWE te PEMAKO, Op.cit., p.84. ↑
7 C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, « La fin du mandat présidentiel et le principe de continuité de l’État dans la constitution congolaise », 2016, p.5, disponible sur : https://www.droitcongolais.info/files/RDC-MANDAT—CONTINUITE.pdf, consulté le 19 octobre 2O22. ↑
8 Idem., p.6. ↑
9 Art. 69, al.2, Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, in J.O. RDC, 52e année, Kinshasa, n° spécial, février 2011, p. 27. ↑
10 C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, Op.cit.p.4. ↑
11 Arrêt, R. Const. 262, 24 juin 2016, §5, p.12. ↑
12 S. GUINCHARD et T. DEBARD., Lexique -des-termes juridiques, Op.cit., p.293. ↑
13 C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, Op.cit.p.5. ↑
14 JEAN-CLAUDE RICCI, Droit administratif général, 5ème Ed., Paris, Hachette, 2013, p.259. ↑
15 C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, Op.cit. p.6. ↑
16 F. DELPEREE, « Gouverner sans gouvernement ? », In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome 23, 2012. p. 121. ↑
17 Conseil constitutionnel français, 25 juillet 1979, Continuité du service public de la radio-télévision, Rec.33, disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79108/.htm, consulté le 18 octobre 2022. ↑
18 C.E. Sect., 30 mars 1979, Affaire Secrétaire d’État , recours n 09369 du secrétaire d’État aux universités, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de bordeaux du 24 juin 1977 en tant qu’il annule sa décision du 9 septembre 1976 fixant la dotation de l’université de bordeaux II en crédits de vacation et d’heures complémentaires d’enseignement pour l’année universitaire 1975-1976 , statuant au n° 09369 09413 Rec.14. ↑
19 C.E., le 13 juin 1980, Affaire Madame Bonjean, requête en annulation du jugement du 28 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigé contre les décisions des 29 octobre et 31 décembre 1975 par lesquelles le Recteur de l’Académie de Genoble a opéré une retenue de son traitement de janvier 1976, Rec.274, n° 17995, §4,p.2. ↑
20 Art. 6, point 4, Loi organique n° 16-001 du 3 mai 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des Entités territoriales décentralisées, in J.O.RDC, n° 11, col.11, 1er juin 2016, p.2. ↑
21 Art.10, in fine, Op.cit., p.2. ↑
22 C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, Op.cit.p.6. ↑
23 Art. 69, al. 2, Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, in J.O. RDC, 52e année, Kinshasa, n° spécial, février 2011, p. 27. ↑
24 C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, Op.cit.p.6. ↑
25 Ibid. ↑
26 Art. 31 et art. 41, Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatives à la libre administration des provinces telle que modifiée et complétée par la Loi n°13/008 du 22 janvier 2013, in J.O.R.D.C, 5e année, n° spécial, 1er février 2013, p.8. ↑
27 Art. 81, Op. cit., p. 24. ↑
28 F. VU NDUAWE te PEMAKO, Op.cit., p.84. ↑
29 Art. 70, al. 2, Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, in J.O. RDC, 52e année, Kinshasa, n° spécial, février 2011, p. 27. ↑