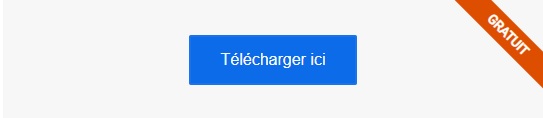La place de l’école dans les changements successifs d’emploi
3.4. La place de l’école dans les changements successifs d’emploi après avoir quitté le système éducatif
Après avoir observé successivement les modes de recrutement des employeurs du BTP, puis les modes d’accès à l’emploi tels que fournis par l’enquête Emploi, nous mobilisons ici une enquête longitudinale menée auprès de jeunes sortant de formation.
L’événement commun à tous ces jeunes et marquant le début de l’observation longitudinale est la sortie du système éducatif. Ce type d’enquête devrait permettre d’apprécier de façon plus précise l’importance de l’école comme mode d’accès à l’emploi pour la population a priori la plus concernée.
Cette enquête de cheminement a été réalisée sous forme d’entretiens individuels86 par le Céreq en 1993 auprès d’élèves ayant quitté en 1989 une formation initiale professionnelle ou générale avant le baccalauréat.
Elle a porté sur un échantillon de 13100 jeunes représentant 366 600 jeunes issus cette année-là soit d’un collège, d’un lycée général ou technologique, ou d’un lycée professionnel (enquête G41), soit d’un centre de formation d’apprentissage (G42)87. Elle couvre donc les niveaux VI, Vbis et V de la nomenclature de formation du ministère de l’Education Nationale.
85 Nous conservons à propos de l’école les données du tableau d’origine non recomposé sur la question du mode d’accès à l’emploi dans la mesure où nous considérons que les emplois obtenus lors d’une période pédagogique en entreprise, quelle que soit sa forme, l’ont été grâce à un réseau de l’école.
86 Menés par des enquêteurs de l’INSEE.
87 L’exploitation de cette enquête a pu être réalisée grâce à la collaboration très attentionnée de l’équipe du Lasmas (principalement Alain Degenne, Marie-Odile Lebeaux) que je remercie chaleureusement.
Tous les emplois occupés par les élèves entre 1989 et 1993 ont été observés, et en particulier la façon dont les élèves les ont obtenus. Nous disposons donc des modes d’accès pour chaque emploi successivement occupé chez un employeur différent durant cette période.
Un peu plus de 12300 élèves ont trouvé au moins un emploi après le 1er juin 198988, soit sur une période d’observation couvrant quatre années. Dans un premier temps les différents modes d’accès à l’emploi selon le rang de celui-ci sont présentés, ce qui permet de mettre en valeur le rôle spécifique de l’école pour le premier emploi.
Puis l’analyse sera centrée uniquement sur le premier emploi, et passera en revue quelques variables susceptibles de faire varier les poids respectifs de chacun des modes d’accès à l’emploi.
3.4.1. Mode d’accès à l’emploi selon le rang de celui-ci
L’enquête mobilisée comprend 68 types de modes d’accès à l’emploi (liste présentée en annexe 1) recodés à partir des réponses en clair des personnes enquêtées, réunis en grands groupes :
- “ recherche sans intermédiaire ” ;
- “ recherche transitant par un organisme ou une institution avec ou sans relation ” ;
- “ emploi lié à un emploi antérieur ” ;
- “ emploi par relation hors institution ou organisme ” ;
- “ autre ”.
L’esprit de ces regroupements était de faire apparaître les divers organismes et institutions impliqués dans ces modes d’accès (ce qui se perçoit bien dans l’intitulé du groupe “ recherche transitant par un organisme ou une institution avec ou sans relation ”), plus que de mettre l’accent sur les dimensions relationnelles sous-tendant le processus d’accès à l’emploi.
Nous avons donc recomposé nos propres groupes, en isolant chaque fois que c’était possible les items explicitement relationnels. 14 groupes ont ainsi été constitués (annexe 1).
Dans les tableaux qui suivent, les modes d’accès ont été regroupés selon leur caractère a priori relationnel ou non, même si des dimensions relationnelles sont par ailleurs présentes dans des organismes a priori considérés comme non relationnels comme dans le cas de l’ANPE (cf. chapitre 1.1).
Les items 1 à 7 correspondent donc aux modes d’accès a priori non relationnels, les items 8 à 11 aux modes d’accès relationnels. Voici comment se répartissent les modes d’accès selon le rang des emplois.
88 La date de sortie a été fixée conventionnellement au 01/06/89, dans la mesure où quelques individus de l’échantillon avaient trouvé un emploi avant la fin des études (498 personnes), sans que l’on puisse en identifier clairement les raisons. Dans la mesure où il s’agit de l’obtention d’un emploi après la sortie de l’école, l’apprentissage doit être considéré comme une voie de formation à part entière ; ceci permet d’éviter de prendre en compte pour les apprentis l’éventualité que ceux-ci n’aient déclaré comme premier emploi la situation d’apprentissage en elle-même. Ainsi, ne sont pris en compte dans nos résultats que les nouveaux emplois pris après la fin de leurs études.
Tableau 20. Evolution des modes d’accès à l’emploi selon le rang de celui-ci (%). Elèves sortis de l’enseignement secondaire général, technique ou professionnel avant le bac en 1989. Source enquête G41 Céreq
| G41 – Rang de l’emploi | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7et+ |
| 01 – Concours, examen | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| 02 – Réponse à annonce, annonce passée | 6,3 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 9,1 | 9,5 |
| 03 – Candidatures spontanées, démarches personnelles | 21,0 | 24,4 | 25,1 | 24,2 | 24,9 | 21,3 | 23,7 |
| 04 – ANPE, organismes de placement | 8,6 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 7,8 |
| 05 – PAIO, missions locales, mairies, collectivités publiques… | 5,2 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 2,2 |
| 06 – Organismes et syndicats professionnels | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 07 – Par intérim (sans savoir si CS ou RPA) | 8,1 | 9,1 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 11,1 | 8,1 |
| 08 – Relations liées à l’école : enseignants, directeurs, intervenantsprofessionnels, professionnels rencontrés par le stage… | 10,7 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| 09 – Relations liées au dispositif de formation par apprentissage | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 – Relations professionnelles antérieures (y c. si contacté parl’employeur) | 3,5 | 13,3 | 13,9 | 14,2 | 15,8 | 15,6 | 20,7 |
| 11 – Relations autres que professionnelles | 34,5 | 29,6 | 27,7 | 27,3 | 24,0 | 29,1 | 24,0 |
| 11a – dont relations familiales identifiées11b – dont relations personnelles identifiées 11c – Relations non identifiées | 13,65,3 15,6 | 8,95,6 15,0 | 7,05,5 15,2 | 6,46,0 15,0 | 5,04,1 14,9 | 6,65,9 16,7 | 6,05,5 12,5 |
| 12 – A son compte | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
| 13 – Autres | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 14 – Non réponses, réponse indéterminée | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif répondant | 8976 | 7342 | 4706 | 2674 | 1405 | 714 | 695 |
Premier point, il est possible d’observer ici les poids respectifs de chacun des modes d’accès pour le premier emploi : tout d’abord, dans près de la moitié des cas (49%), l’obtention du premier emploi a mobilisé une relation, quelle qu’elle soit (items 8-11).
Cela appelle deux remarques méthodologiques : ce type d’interrogation par question ouverte, n’obligeant pas les enquêtés (ou les enquêteurs dans les enquêtes par téléphone) à rentrer dans des cases pré structurées, révèle bien plus de phénomènes relationnels dans le fonctionnement du marché du travail.
En revanche, dans un travail d’une telle ampleur (plus de 13000 interrogés), il est difficile d’obtenir pour chaque personne interrogée une spécification précise de la relation mobilisée, dans le cadre d’une question ouverte sans aide ni indication pour l’enquêteur89.
Plus généralement, les démarches personnelles-candidatures spontanées, expurgées ici, quand cela a été possible, des cas identifiables où une relation a été mise en œuvre, mais comprenant probablement encore des cas de prise de contact suite à des recommandations ou des conseils par des tiers (de l’école, du stage, du contexte professionnel du moment, des amis, etc.) n’atteignent qu’un peu plus du cinquième des modes d’obtention.
La famille représente 13,6% (au minimum), ce qui correspond assez bien à ce qui a été constaté à propos des jeunes les moins titrés scolairement dans le point 3.3 précédent à partir de l’enquête Emploi (12,7% en 1990) ou dans d’autres travaux (Degenne et alii 1991, Forsé 1997).
Un certain nombre de relations (non professionnelles) qui n’ont pu être distinguées interviennent dans 15% des cas. Certes, il est difficile de comparer ces résultats à ceux obtenus dans l’enquête Emploi.
Tout d’abord, le public est différent puisqu’il s’agit ici de données sur les seuls élèves ayant quitté le système éducatif sans avoir atteint la classe du baccalauréat. Ensuite, le mode d’interrogation (question ouverte recodée a posteriori) n’est pas identique et les regroupements effectués ici ne correspondent pas nécessairement.
Mais surtout, la logique d’enquête n’est pas la même. Dans l’enquête Emploi, nous avions tenté de nous rapprocher le plus possible de la situation « premier emploi obtenu après la formation », à partir de la confrontation entre deux situations instantanées espacées d’une année.
Malgré cela, rien n’empêchait a priori qu’une personne sélectionnée de cette façon ai pu occuper deux ou trois emplois de durée infra annuelle entre sa sortie de formation (ou de service national) et l’emploi décrit au moment de l’enquête. La comparaison s’avère donc aléatoire.
Mais on remarquera simplement que la proportion des jeunes ayant accédé au premier emploi grâce à l’école est ici de 11%, un peu supérieure à celle de l’enquête Emploi 1990 (la plus proche en date) pour le public de même niveau d’étude (8,3%), tandis que la part de la catégorie « relations professionnelles antérieures y compris si contacté par l’employeur » (3,5%) est très nettement inférieure à la part cumulée des deux catégories « relations professionnelles antérieures » et « contacté par l’employeur » dans l’enquête Emploi (17,3%).
89 Par exemple un précodage indicatif structuré des réponses possibles sur le support d’enquête s’il s’agit d’une enquête téléphonique, associé à une formation spécifique des enquêteurs. C’est de cette façon que nous avons procédé pour notre enquête dont nous rendons compte au chapitre 5 (cf. questionnaire en annexe 3).
Second point, l’évolution des parts relatives des différents modes d’accès à l’emploi sur la période d’observation montre que ceux-ci portent la marque des phases de vie et des milieux dans lesquels les élèves évoluent lorsqu’ils trouvent leur emploi :
- poids importants et continus des candidatures spontanées-démarches personnelles (de 20 à 25%), en légère augmentation après le premier emploi, ce qui pourrait correspondre à l’idée que les démarches et candidatures spontanées aboutissent quand les jeunes sont déjà entrés dans la vie active et commencent à en intégrer les règles, mais peut aussi être relié aux expériences professionnelles apparaissant sur les CV en les rendant plus attractifs auprès d’employeurs devenus exigeants sur ce point ;
- le poids de la famille (13,6%) assez conséquent au début, puis se stabilise très vite autour de 5-6% ;
- les relations personnelles identifiées (les amis) restent stables autour de 5% ;
- l’intérim, dont on sait qu’il est un moyen croissant de se faire une expérience professionnelle, augmente très légèrement au cours du temps, tout en restant autour de 8-9 % ;
- enfin, le poids des réseaux liés à l’appareil de formation de 11% au premier emploi (items 8 et 9) tombe à 2,5% dès le second pour s’estomper, sans disparaître, peu à peu ; il est remplacé par les relations professionnelles antérieures qui passent brutalement de 3,5% au premier emploi à 13,3% dès le second pour ensuite croître régulièrement.
Tableau 21. Elèves sortis de l’apprentissage en 1989 (G42). Evolution des modes d’accès aux emplois occupés par les sortants sur la période d’enquête selon le rang de l’emploi (%). Source enquête G42 Céreq
| G42 – Rang de l’emploi | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7et+ |
| 01 – Concours, examen | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| 02 – Réponse à annonce, annonce passée | 7,1 | 10,9 | 11,4 | 11,6 | 13,1 | 8,7 | 11,3 |
| 03 – Candidatures spontanées, démarches personnelles | 17,5 | 19,4 | 23,1 | 22,3 | 23,4 | 24,8 | 22,6 |
| 04 – ANPE, organismes de placement | 5,1 | 5,8 | 7,6 | 8,1 | 7,7 | 12,2 | 7,8 |
| 05 – PAIO, missions locales, mairies, collectivités publiques… | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 2,0 |
| 06 – Organismes et syndicats professionnels | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3,0 | 0,5 |
| 07 – Par intérim (sans savoir si CS ou RPA) | 6,2 | 8,5 | 8,1 | 10,3 | 6,7 | 7,4 | 6,9 |
| 08 – Relations liées à l’école : enseignants, directeurs, intervenantsprofessionnels, professionnels rencontrés par le stage… | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
| 09 – Relations liées au dispositif de formation par apprentissage | 24,7 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
| 10 – Relations professionnelles antérieures (y c. si contacté parl’employeur) | 2,9 | 17,6 | 12,7 | 14,4 | 15,5 | 15,2 | 17,7 |
| 11 – Relations autres que professionnelles | 30,1 | 30,1 | 30,0 | 27,1 | 26,2 | 23,1 | 27,5 |
| 11a – dont relations familiales identifiées11b – dont relations personnelles identifiées 11c – Relations non identifiées | 12,74,5 12,9 | 8,75,7 15,8 | 7,06,3 16,7 | 5,55,9 15,7 | 5,25,0 16,1 | 4,46,1 12,6 | 4,92,5 20,1 |
| 12 – A son compte | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
| 13 – Autres | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 – Non réponses, réponse indéterminée | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Effectif répondant | 3378 | 2692 | 1627 | 916 | 465 | 230 | 204 |
Dans le cas des sortants d’apprentissage, la répartition des modes d’accès n’est pas fondamentalement différente. Cependant, le poids des phénomènes relationnels est encore plus marqué et atteint 60% des modes d’obtention du premier emploi ; et cela est dû à un fait propre aux jeunes apprentis : plus du quart de leurs premiers emplois (27%) ont été obtenus par l’intermédiaire des dispositifs de formation, ce qui bien sûr ne surprend pas dans le cas des apprentis puisqu’une partie d’entre eux restent ensuite chez leur maître d’apprentissage.
Les relations autres que professionnelles sont toujours aussi importantes, bien qu’un peu moins que dans le cas précédent, mais cela ne concerne ni les relations familiales ni les relations amicales qui restent au même niveau pour les apprentis comme pour les « lycéens ».
Le poids important de l’appareil de formation se ressent plutôt dans les parts plus faibles des relations non professionnelles non identifiées, des démarches personnelles-candidatures spontanées, de l’intérim, ou de l’ANPE, tout au moins dans les premières années dans ce dernier cas.
Enfin, ici comme pour les lycéens, le même phénomène est visible : le poids des relations liées au dispositif de formation, élevé au premier emploi, chute brutalement dès le second emploi (de 27 à 3%), tandis que les relations professionnelles antérieures prennent le relais dès le second emploi, passant de 3 à 17%.
Qu’on soit « lycéen » ou apprenti, l’école joue un rôle conséquent dans le processus d’accès à l’emploi, mais uniquement pour le premier emploi, et ce rôle s’estompe très fortement -sans disparaître totalement- ensuite.
Dès la mise en route du processus d’accès au second emploi, interviennent cette fois-ci les relations liées au nouvel environnement professionnel.
Le passage de l’école à l’emploi est une période de vie intéressante de ce point de vue, car elle permet une hypothèse : le capital social auquel les individus ont accès dépend du milieu dans lequel ils évoluent, mais son efficacité dépend de sa capacité de liaison avec le milieu dans lequel ils envisagent d’entrer.
Il s’agit de celui de l’école et de ses liens avec des unités du monde du travail pour passer de l’école aux entreprises, puis de celui des entreprises et de leurs liens avec d’autres entreprises pour ensuite passer de l’une à l’autre.
Ce deuxième mouvement est moins aisément analysable dans la mesure où rien ne permet de spécifier ou de distinguer le rattachement des relations mobilisées quand on passe d’une entreprise à une autre : seul l’item « relation professionnelle antérieure » permet de l’approcher, sans qu’on puisse savoir s’il s’agit de relations nouées dans l’emploi précédent ou de relations conservées au cours du temps.
Il est d’ailleurs possible d’imaginer que la distinction pertinente ici ne serait plus à faire entre des entreprises considérées de façon isolée, mais entre des groupes d’entreprises appartenant à un même milieu professionnel, et au sein desquels les premiers contacts noués dès le premier emploi pourraient intervenir pour toutes mobilités ultérieures à l’intérieur de ce même milieu professionnel. La question est alors reportée à la définition pertinente du groupe.