L’approche méthodologique en communication révèle des mécanismes de défense insoupçonnés dans la communication interculturelle congolaise. En combinant psychologie interculturelle et méthodologies mixtes, cette recherche offre un cadre théorique novateur, essentiel pour comprendre les dynamiques socioculturelles en jeu.
- Langue ou code linguistique
La langue est définie, selon Ferdinand de Saussure137, comme un système de signes vocaux, y compris les signes graphiques et gestuels. Ces signes sont doublement articulés, notamment entre signifiant et signifié.
Pour Jean Dubois et alii138, une langue est un instrument de communication, un système de signes vocaux spécifiques aux membres d’une même communauté. Au sein de cette communauté, tous les membres produisent des énoncés qui, en dépit des variations individuelles, leur permettent de communiquer et de se comprendre, et qui reposent sur un même système de règles et de relations qu’il est possible de décrire. C’est à ce système abstrait, sous-jacent à tout acte de parole, qu’on a donné le nom de langue.
A l’intérieur d’une même langue, les variations sont également importantes, synchroniquement parlant : pour les niveaux de langue, on parle de langue familière, soutenue, technique, savante, populaire, propre à certaines classes sociales, à certains sous-groupes (famille, groupes professionnels) ; dans cette catégorie, on place les différents types d’argots et de jargons ; pour les variations géographiques, on parle de dialectes et de patois. Enfin à l’intérieur d’une même langue, on distingue deux moyens différents de communication, dotés chacun d’un système propre : la langue écrite et la langue parlée.
En effet, Jacques Demorgon139 l’a fait remarquer en ces termes : les langues sont au cœur des interactions et des interférences des hommes avec leurs environnements et des hommes entre eux. Potentiellement, chaque donnée culturelle est susceptible d’entrer en résonance avec toutes les autres. Sa possibilité d’y parvenir s’accroît considérablement dès lors qu’elle est incluse dans une langue qui la conserve.
Il y a donc lieu de distinguer la langue du langage et de la parole. A ce sujet, Pascal Vaillant140 déclare que si le langage désigne la faculté humaine générale de construire des messages en assemblant des signes la langue, elle, est un système particulier prescrivant les mots et leurs règles d’assemblage. On parle d’ailleurs toujours du langage, mais des langues. Tandis que « la parole se distingue de la langue comme ce qui est individuel et non social. La parole est un acte individuel de volonté et d’intelligence. La langue se distingue de la parole, acte de volonté et d’intelligence, acte libre, acte de création »141.
Par ailleurs, Fabienne Baily142 considère la langue comme un produit culturel, car elle reflète les caractéristiques d’une société donnée ; comme exemple, les mots renvoient aux expériences et aux habitudes spécifiques de la société à laquelle ils se rapportent. C’est ce qui explique notamment que certains soient « intraduisibles » dans une autre langue.
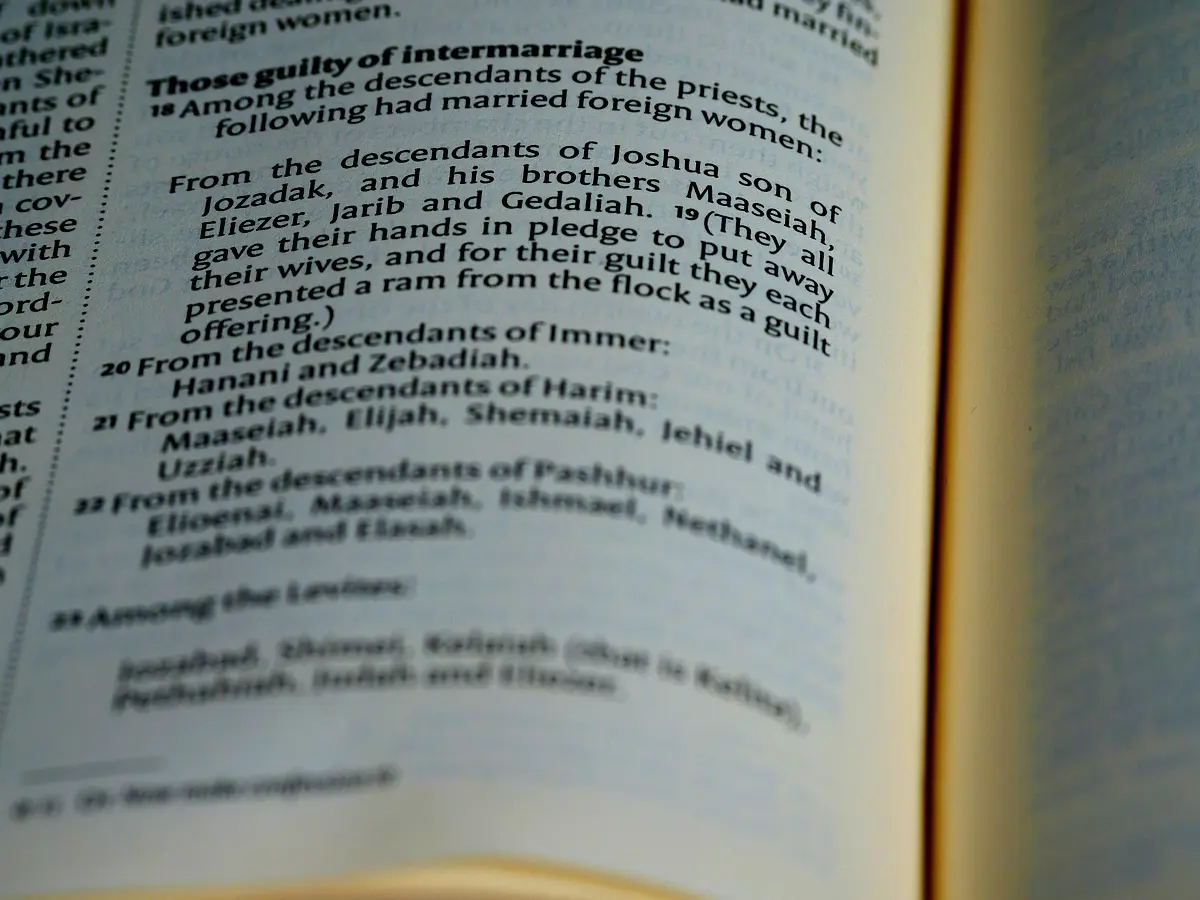
Pour que la communication soit possible entre individus de cultures différentes, il convient donc de rendre conscients les contenus de ces niveaux culturels, d’expliciter des comportements, des systèmes de valeurs et d’instaurer de cette manière un code commun aux interlocuteurs. En cela, la linguistique aura un rôle à jouer puisqu’elle permettra de verbaliser les strates implicites de la culture.
La langue constitue ainsi un moyen de découverte, un outil grâce auquel des individus vont pouvoir faire connaissance et rentrer progressivement dans le système de référence de l’autre.
Il sied de relever, comme Ron Scollon et Suzanne W. Scollon143, que la nature ambiguë du langage est une des sources majeures des difficultés dans la communication inter-discours. Lorsque deux personnes ne sont pas d’accord au sein d’un groupe parce qu’elles ne sont pas de même sexe, de même âge, de même groupe culturel ou ethnique, qu’elles n’ont pas reçu la même éducation, qu’elles sont de régions ou de quartiers différents, qu’elles n’ont pas le même salaire ou ne sont pas dans la même branche professionnelle, ou simplement qu’elles ont des histoires personnelles très différentes, ou encore qu’elles communiquent sous des registres de langues différents, … Il est très difficile pour chacune d’elles de tirer des conclusions sur ce que l’autre veut dire.
Or, déjà en 1959, le chercheur Edward Twitchel Hall144, dans son ouvrage Le langage silencieux, voulait montrer que les différences culturelles au niveau des styles de communication internationale et interculturelle résidaient en partie au niveau des codes linguistiques. Ces différences sont très marquées entre les individus au niveau du langage utilisé (direct, indirect, explicite ou implicite) ; l’on distingue des personnes qui veulent tout savoir dans les détails, qui racontent une anecdote par le menu et d’autres qui se satisfont d’une description globale et qui en déduisent le reste. Le langage direct est celui des règles, des lois, de la technique, des modes d’emploi. Le langage indirect est celui du non verbal, des rites, des règles de politesse, etc.
La tendance vers la communication directe ou indirecte influence aussi la préférence pour les messages lents ou rapides et pour les médias correspondants. Chaque culture a une vitesse de communication à laquelle ses membres communiquent plus aisément. On parle dans cette dimension de la rapidité avec laquelle on peut décoder un certain message et de la vitesse à laquelle on peut réagir par rapport à ce message. Les messages rapides sont par exemple les titres de journaux, les messages publicitaires et la télévision. Tandis que parmi les messages lents on peut citer l’art, les documentaires, les relations profondes, la poésie, la littérature…
Enfin, une préférence pour des messages rapides ou lents est une détermination culturelle. Dans une culture avec une préférence pour des messages rapides, les gens vont agir plus rapidement d’une manière confidentielle. En même temps, ils vont favoriser un type de communication plutôt direct et explicite.
- Langage corporel
Le langage corporel appelé paralangage ou non-verbal occupe une place de choix dans la communication humaine. En 1976, Edward Twitchel Hall145 avait déjà signalé qu’un message est composé par 55 % de mimiques et gestes, 38 % d’intonations et 7 % de mots. Le non verbal est donc très important, plus encore dans la communication interculturelle, en l’absence d’une langue en commun. Ainsi pour ces fonctions spécifiques : former des impressions (donner de la crédibilité, définir et limiter) et donner un sens au niveau affectif. Le non verbal est constitué par des éléments divers : la distance, le toucher et le contact, les mimiques et les gestes (ex. mains, visage, yeux,…) et les gestes auditifs (ex. le silence).
Le langage corporel fonctionne dans un contexte très large, il est beaucoup plus universel que le langage parlé même s’il n’est pas tout à fait universel. Il a été constaté que les émotions de base telles que la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, l’étonnement peuvent être reconnus facilement dans l’expression du visage des gens de différentes cultures. Les mouvements des muscles faciaux dont on se sert en exprimant ces émotions sont héréditaires.
Il est difficile d’assimiler l’usage de certains mouvements ou les règles implicites concernant la distance, le toucher, le regard, etc. A titre d’illustration :
- Se toucher : la distance, la fréquence et la durée régissant les contacts physiques pendant une rencontre portent chacune le sens des liens que l’on entretient ou que l’on veut tisser et peuvent être très différentes selon les cultures ;
- Se regarder : en Europe, le fait d’échanger des regards lors d’une conversation de face à face tombe sous le sens. Il est difficile d’accorder une crédibilité aux paroles de gens qui ne respectent pas ce principe. Pourtant, il n’est pas évident de se regarder pendant une conversation dans d’autres cultures, comme en RDC où, à la place des yeux, on regarde plutôt à hauteur du cou. Dans ce cas, baisser les yeux est un signe de respect.
La posture est la position et l’orientation du corps durant l’interaction. C’est une mode de l’expression kinésique, c’est-à-dire du langage du corps qui constitue un indicateur d’un état affectif, d’une motivation, du type de relation sociale existant entre les interlocuteurs. Actuellement, la plupart des auteurs s’accordent pour définir quatre postures fondamentales, liées chacune à une attitude spécifique, déterminant ou relevant le type de relation que celui qui parle cherche à établir, consciemment ou non, avec son interlocuteur. Il s’agit de 146 :
- Posture en expansion : la tête, le tronc et les épaules sont en extension. Elle manifeste
(ouest perçue) comme une attitude de domination ou de mépris de l’autre ;
- Posture de rejet : le corps (en particulier la tête et le buste) se détourne d’autrui, ne lui fait plus face. Elle est associée à une attitude de refus de l’autre ou de crainte de relation ;
- Posture de contraction : tête fléchie sur le tronc, épaules tombantes, c’est l’indicateur
d’une attitude de soumission ou d’abattement et de renoncement à la relation ;
- Posture d’approche : buste et tête inclinés vers l’autre, bras et mains ouverts, c’est la posture de l’attitude d’accueil, d’écoute, de centration sur l’autre. Contrairement aux trois premières, elle est l’élément déterminant le climat relationnel positif.
Pour Jean-Claude Martin147, les gestes sont déterminés par cinq facteurs : les racines (l’histoire personnelle), la culture, le statut social, l’état psychique et le contexte dans lequel ils apparaissent. A l’instar des postures, ils sont un indicateur de l’état des locuteurs, de ses motivations et du type de relation qu’il entend établir. Cependant, la signification d’un geste dépend largement du contexte socioculturel dans lequel se déroule l’interaction.
En conclusion, il faudrait retenir que l’interprétation des comportements ne peut être efficace que si elle tient compte des différences des cultures. Dans certains pays, il est normal et coutumier que les hommes se serrent la main au début de chaque rencontre. Tel n’est malheureusement pas le cas lorsqu’un homme serre la main d’une femme. Par contre, on fait un signe de main sur la poitrine ou on s’incline devant l’autre. A ce fait, plusieurs degrés d’inclination sont possibles.
137 SAUSSURE (de), F., Cours de Linguistique Générale, Paris, Payot, 1916, pp. 1-331. ↑
138 DUBOIS, J. et alii, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 2002, pp. 266-267. ↑
139 DEMORGON, J., Complexité des cultures et de l’interculturel, Paris, Anthropos, 2004, p. 211. ↑
140 VAILLANT, P., Sémiotique des langages d’icônes, Paris, Honoré Champion, 1999, p. 284. ↑
141 DUBOIS, J., op.cit, p. 267. ↑
142 BAILY, F., L’Animation linguistique dans les rencontres franco-allemandes de jeunes, Paris, OFAJ, 2009, p. 20. ↑
143 SCOLLON, R. et SCOLLON, S.W., Intercultural Communication: A Discourse Approach, Cambridge, Blackwell, 1995, pp.100-107. ↑
144 HALL, E.T., Le langage silencieux, Paris, Éditions du Seuil, 1959. ↑
145 HALL, E.T., op.cit, p. 95. ↑
146 ABRIC, J.-C., op.cit, pp. 64-65. ↑
147 MARTIN, J.C., Le guide de la communication, Paris, Marabout, 1999, p. 95. ↑
________________________
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la communication interculturelle dans le contexte congolais?
La communication interculturelle dans le contexte congolais examine les mécanismes de défense socioculturelle et vise à développer un cadre théorique de référence pour l’étude de cette communication.
Comment la langue influence-t-elle la communication interculturelle?
La langue est un système de signes qui permet aux membres d’une communauté de communiquer et de se comprendre, et elle joue un rôle essentiel dans l’explicitation des comportements et des systèmes de valeurs entre cultures différentes.
Quels sont les niveaux de langue mentionnés dans l’article?
Les niveaux de langue incluent la langue familière, soutenue, technique, savante, populaire, ainsi que les différents types d’argots et de jargons, et les variations géographiques comme les dialectes et patois.