La parole de la narratrice dans Ravisseur joue un rôle crucial dans la dynamique narrative, révélant les tensions entre son discours en tant que narratrice et ses interactions en tant que personnage. Cette analyse discursive met en lumière comment ces éléments façonnent l’intrigue et les idéologies sous-jacentes.
La destination des paroles des personnages
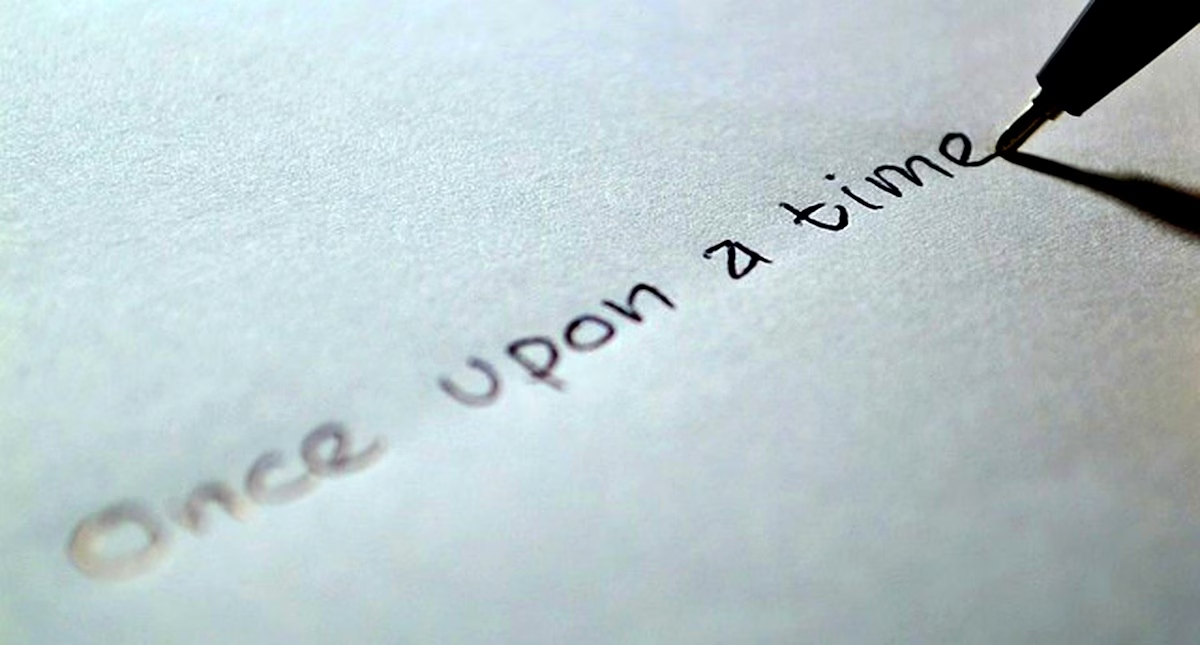
I. 3. 1. La parole de la narratrice
Les rapports que la narratrice entretient avec l’histoire qu’elle raconte vont déterminer la nature de la parole. Elle est confrontée au problème1 de la correspondance entre son langage en tant que narratrice et ses propos en tant que personnage, elle est amenée à retransmettre ses propres paroles aux lecteurs.
Je dressai mes plans, puis les appliquai avec minutie. Je téléphonai aux copines qui entassaient draps et nappes en vue de leurs noces. Je leur proposai mes services à bas prix. (p. 97)
Un soir où ma verve tarissait, à cause de la fièvre et parce que j’étais concentrée sur une commande à livrer, il déplia les bras, comme une invite, leva les sourcils alors qu’il voulait savoir les raisons de mon acharnement. Il nous fallait de l’argent, lui dis-je, beaucoup d’argent. (p. 140)
La narratrice raconte son histoire en se servant d’une distance humoristique pour renverser les situations narratives en sa faveur.
Il me salua dune inclinaison de la tête, une gracieuse révérence .si j’avais perdu la raison, j’aurais dit qu’il était l’ange Gabriel, ou un homologue, venu me proposer une carrière de prophétesse. Mais j’avais toute ma tête, et le désert était bien loin (p139)
Elle déploie aussi dans la description des personnages toutes formes d’humour : tendre, satirique, ironique. L’humour s’exerce d’une façon tendre à l’égard de ses sœurs, et d’une manière féroce à l’égard de son père et ironique à l’égard de sa belle-sœur. Soulignons aussi que la narratrice personnage se moque d’elle-même.
Ses paroles sont transmises au discours direct lorsqu’elle est partenaire d’une conversation, et en tant que narratrice au discours intérieur et monologue.
Je porterais une perruque ou, à défaut, me voilerais. Il me serait bien égal de porter le voile, à présent. Qu’avais-je à cacher sinon la disgrâce ? Je me couvrirais entièrement le visage, adopterais, tant qu’à faire, la cagoule des Afghanes, verrais le monde à travers des trous et le monde ne me verrait pas. Qu’était-ce que se voiler comparé aux séismes, violents et sournois, qui secouaient la terre, l’écartelaient, prenant au dépourvu ceux qui passaient par là, les engloutissant sans sommation ? Qu’avais-je à m’embarrasser des regards offusqués lorsque les volcans rugissaient, rougissaient, vomissaient, répandant leur lave, ensevelissant ceux qui vivaient alentour, happant leur vie sans aucune autre forme de remords ? […] (p. 132)
Son visage reprenait des couleurs, ses traits se détendaient : où notre jeune génitrice puisait-elle cette soudaine assurance ? Comptait-elle sur le soutien d’Omar maintenant père et dont les pouvoirs s’étaient renforcés grâce à l’arrivée de cette nouvelle protubérance ? quoi qu’il fût, j’applaudis en catimini ; ma mère se dressait enfin contre ce qui avait fait toute sa vie : une alternance de grossesses et de tâches ménagères. (p. 51)
De nos jours blinder des issues exigeait une fortune. Mais il nous fallait absolument ces onéreuses installations, pas seulement contre les vols. Il était maintenant indispensable de se doter de systèmes antisismiques car, expliquai-je, comme se répand la poudre, la nouvelle des jeunes, très jeunes filles seules dans une grande maison allait de bouche en bouche, d’oreille en oreille… la terre en vibrait, ses entrailles s’en échauffaient. Son bouillonnement n’épargnait même plus sourds. Bref, une histoire d’énergie géothermique guère faste. J’ai vu ça à la télé, précisai-je. (p. 141)
Ces quelques exemples retenus, montrent que la narratrice-personnage véhicule dans son discours beaucoup de non-dits et se fait la porte parole de l’auteur. Ses paroles sont nourries de réflexions de l’auteur. Elle affiche son opposition au voile, et revient sur la situation du pays (santé, économie, sécurité éducation)
La narratrice s’adresse aussi directement au lecteur dans ces exemples :
Je m’attelais donc à la tâche, jour et nuit, nuit et jour, avec obstination : protéger les miens de l’indigence et de la pitié, faire vivre ceux de ma famille qui, par ma faute –oui, par ma faute : je m’en expliquerai plus tard, si l’occasion se présente- étaient maintenant sans sécurité, livrés à eux-mêmes, et à moi. Heureusement, mes clientes devenaient de plus en plus dépensières, elles s’embourgeoisaient, les fêtes proliféraient, comme autant d’actes de survie, ou de résistance, ou de pérennité. Que sais-je encore ? (p. 137)
Malgré tout, ils renforçaient persiennes et portes, barricadent ainsi leurs femmes et avec elle toute velléité de les doubler, personne n’étant à l’abri de ce que vous savez… (p. 96)
Cet autre exemple : Mes sœurs me surnommèrent « Les Contes de la crypte », leur série télévisée préférée. (p. 131) comporte une indication destinée au lecteur qui partage certaines connaissances, et ce pour lui permettre de mieux se représenter la physionomie de la narratrice.
Le roman comme l‘affirme Bakhtine est un lieu de « diversité sociale de langages, parfois de langues et de voix individuelles, diversité littérairement organisée »2. Il est en mise en scène du langage, de valeurs, de points de vue. La narratrice utilise dans son récit la langue arabe ou plutôt le dialecte.Kaaba et Massih sont utilisés pour établir une comparaison indirecte ou de manière implicite entre deux religions.
Elle associe l’Islam à l’intégrisme et le christianisme à la justice, ce qui rejoint ici les réflexions de l’auteur. D’autres mots comme sidi, dada yéhoudia, gaouria,osbanes qui apparaissent lors d’un désaccord entre les locuteurs servent à diminuer de la valeur d’autrui et à donner une dimension réelle à la dispute qui éclate entre les interlocuteurs.
I. 3. 2. Les paroles des personnages
Le discours direct dans le roman est un procès de communication qui prend place à l’intérieur d’un autre procès de communication (auteur- lecteur).
La parole du personnage s’adresse à un interlocuteur fictif immédiat mais c’est le lecteur qu’il vise par le trucage énonciatif (double énonciation). La parole est alors adressée à deux destinataires : un narrataire et un destinataire. Le personnage allocutaire en est le récepteur direct3, et le lecteur en est le récepteur additionnel. Ce lecteur est la cible réelle de toutes les phrases et les informations qui charrient les différents discours. Et selon la terminologie d’Orecchioni4 tout passage dialogué fonctionne comme un « trope communicationnel ».
Nous avons retenu les exemples suivants qui expliquent ce principe.
- Faites-vous belles, les filles. Sortez, bravez les séismes et les volcans. La vie est trop courte, dit-elle (p. 162)
- Qu’il (le père) soit le bienvenu ! qu’il voie que les fenêtres sont faites pour être ouvertes, complètement ouvertes ! s’extasia Yasmina en humant l’air frais.
– […]
- Et ce n’est pas tout, ajouta Yasmina en allumant la radio, poussant le volume au maximum.
- Ya chaba ! ya chabh ! hohooo ! vive la muiquèeeh ! vive la liberté ! criait-elle, la luette hors du gosier. (p. 38-39)
Les sœurs sont les réceptrices directes, réelles des paroles de Khadidja et de Yasmina, le récepteur additionnel est le lecteur. Puisque derrière les personnages qui parlent, il y a l’auteur qui organise les discours et qui veut véhiculer son message.
Le roman de Leila Marouane ne cache pas sa portée idéologique. L’auteur est témoin de son temps et de l’histoire de son pays. Elle-même, était victime d’une violence physique qui l’a laissée pour morte. Son œuvre est donc signifiante dans le contexte que l’idéologie est « ce rapport imaginaire à des conditions d’existence réelles »5
Si l’on considère bien ces énoncés, ils sont produits par des femmes et visent les femmes. L’auteur peuple son roman de personnages féminins, qui, au départ soumis, humiliés et oppressés, retrouvent leur liberté à la fin du récit.
Par ailleurs, l’auteur réduit la parole masculine à une courte intervention du fils, à une réplique celle d’Allouchi, et à celle du père qui, progressivement deviendra un discours délirant, et redonne parallèlement la parole à la fille aînée et ses sœurs qui décident de leur sort.
Les conversations des personnages s’organisent en thèmes et, en fonction du nombre des locuteurs en différents type de dialogues. Donc il est nécessaire de relever et d’opérer une classification des dialogues insérés dans le roman de Leila Marouane.
________________________
1 Rullier Françoise. Dialogue et Narration. Hachette. 2001.p. 17. ↑
2 Bakhtine Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman.Paris: Gallimard. 1978. p. 88. ↑
3 Bakhtine Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman.Paris: Gallimard. 1978. p. 88. ↑
4 Orecchioni Kerbrat Cathrine. L’implicite.Armand Colin. 1986 ↑
5 Althusser Louis. Idéologie et appareils idéologiques d’Etat. Paris : Sociales. 1976. p.97 ↑