La bonne gouvernance en RDC est essentielle pour améliorer les taux d’épargne, selon une analyse macroéconomique de 1960 à 2020. L’article met en évidence comment des institutions efficaces et des droits respectés influencent positivement l’investissement et la croissance économique.
2.1.4. FACTEURS DE BONNE GOUVERNANCE
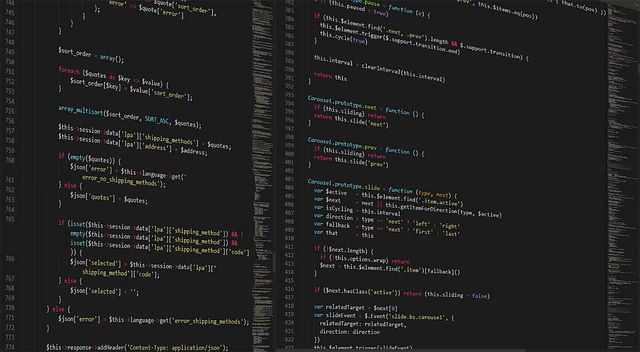
Il est vrai que l’augmentation des quantités du capital et du travail a un impact positif sur la croissance, mais faudra-t-il encore la rendre possible : c’est la thèse de l’économie institutionnelle.
Cette thèse suppose que les économies développées sont des économies qui disposent des institutions efficaces qui permettent la bonne gouvernance : droits individuels respectés, contrats sécurisés, administration efficace, institutions politiques démocratiques. Cette bonne gouvernance est présentée comme une solution permettant de générer la confiance nécessaire à la croissance économique16.
Dans le cadre de ce travail, nous présentons respectivement les degrés de liberté d’entreprendre, d’investir, de financement et enfin le degré de liberté fiscale comme composantes d’une bonne gouvernance.
2.1.4.1. Degré de liberté d’entreprendre
Le degré de liberté d’entreprendre montre à quel niveau les investisseurs sont en mesure de créer une entreprise, d’obtenir des licences et comment ils peuvent se comporter ou encore ce qui peut arriver en cas de faillite. Il est calculé sur base de dix facteurs regroupés en trois catégories, à savoir : création d’une entreprise, obtention d’une licence et fermeture d’une entreprise. Les procédures à effectuer pour commencer une affaire (Nombre, jours, coût et capital minimum) ; les procédures d’obtention d’une licence (Nombre, jours et coût).Enfin, les procédures pour fermer une affaire (jours, coût et taux de rétablissement)17.
[4_img_1]
Graphique N°3 : Evolution du degré de liberté d’entreprendre en RDC
Source : Données publié par le magazine perspective monde, usherbroke University Canada
Comme nous Pouvons voir sur ce graphique, pour l’ensemble de la période 1995-2012, la RDC enregistre une moyenne annuelle de 47,4. Il s’avère que la liberté d’entreprendre en RDC n’est pas garantie à cause notamment des plusieurs contraintes qui prévalent sur cette économie. Parmi les contraintes nous pouvons citer l’imposition élevée des bénéfices. L’Etat prélève 35% des bénéfices des entreprises. Ce pourcentage est très énorme et décourage les entrepreneurs à entreprendre. C’est en 2000 qu’on enregistre le plus haut niveau du degré de liberté d’entreprendre, soit 55% mais cela est suivi d’une chute drastique. C’est en 2010 qu’on enregistre le plus bas niveau (33,5). Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 30%.
2.1.4.2. Degré de liberté d’investir
L’évaluation de la liberté d’investir dans un pays est établie sur base des lois et procédures mises en place pour encourager l’investissement étranger. La préoccupation majeure de cette mesure est de savoir s’il y a une différence de traitement des investisseurs nationaux et étrangers ? Existe-t-il des restrictions d’accès aux devises étrangères, aux transferts de capitaux et aux investissements étrangers dans certains secteurs ? (Fondation héritage, 201218).
Il y a sept éléments ci-après qui entrent dans le calcul du degré de liberté d’investir : le traitement national d’investissements étrangers, le code d’investissement étranger, la restriction à la propriété terrienne, la restriction d’investissements sectoriel des exportations sans compensation juste, la liberté de commander les devises et du contrôle de capital.
Un degré proche de 100% signifie que les investissements peuvent être faits avec peu de limites.
[4_img_2]
Graphique N°4 : Evolution du degré de liberté d’Investir en RDC
Source : données publié par le magazine perspective monde, usherbroke University canada
Pour l’ensemble de la période 1995-2012, la RDC enregistre une moyenne annuelle de 22%. Ceci signifie qu’il y a trop de restrictions à l’investissement en RDC. Le territoire congolais n’est pas doté d’infrastructures susceptibles d’attirer les investisseurs tant privés qu’étrangers. Or ce sont les investissements qui peuvent relever le niveau du revenu des habitants et donc permettre aux ménages d’accéder à un bien-être supérieur à travers l’épargne qui va résulter de la hausse de revenu.
2.1.4.3. Degré de liberté fiscale
Cet indicateur mesure la pression fiscale dans un pays. Pour cela, il prend en compte à la fois du taux maximum d’impôt sur le revenu (par individu et par entreprise) et la part des recettes fiscales dans le PIB (Fondation héritage, 2012). Un degré proche de 100 signifie que le fardeau fiscal est faible : les individus et les entreprises ont peu d’impôts à payer.
[4_img_3]
Graphique N°5 : Evolution du degré de liberté fiscale.
Pour l’ensemble de la période 1995-2012, la RDC enregistre une moyenne annuelle de 61,7%. Il ressort de ces chiffres que la RDC fait quelques efforts pour réduire les tracasseries fiscales. Mais l’idéal est que ce taux soit très proche de 100%. Il est donc nécessaire que l’Etat continue son action sur la baisse de l’impôt notamment l’impôt sur le bénéfice qui à ce jour reste très élevé. Car d’après Keynes « la baisse des impôts stimule l’économie ». C’est en 2010 qu’on enregistre le plus haut niveau 74% et c’est en 1995 qu’on enregistre le plus bas niveau 50,9%. Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 42%.
2.1.4.4. Degré de liberté financière
Le degré de liberté financière évalue le niveau d’intervention des autorités publiques au niveau du système bancaire et financier. Il est une mesure d’efficacité d’opérations bancaires aussi bien qu’une mesure d’indépendance et d’interférence du gouvernement dans le secteur financier19.
Il y a cinq facteurs qui permettent le calcul du degré de liberté financière. Il s’agit de l’ampleur du règlement des services financiers par le gouvernement, le degré d’intervention de l’Etat aux banques et autres sociétés financières, l’ampleur du développement du marché financier, l’influence du gouvernement sur l’affectation du crédit et la franchise à la concurrence étrangère.
Un degré proche de 100% signifie que le gouvernement intervient peu dans le domaine financier. L’indépendance de la Banque Centrale est donc étendue. Le gouvernement se limite alors à assurer le respect des contrats ou à prévenir la fraude. Cette indépendance ne se décrète pas, ou plus précisément, l’indépendance et la crédibilité d’une Banque Centrale ne sont pas uniquement une affaire des statuts, elles se construisent et sont largement déterminées par l’existence d’un environnement favorable20.
Pour l’ensemble de la période 1995-2020, on enregistre une moyenne annuelle de 22%. En d’autres termes, la Banque Centrale du Congo n’est pas indépendante du pouvoir public. C’est en 1998 qu’on enregistre le plus haut niveau, 30% ; et c’est en 2000 qu’on enregistre le plus bas niveau 10%. Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 33%.
2.1.3. TAUX D’INFLATION
La lecture du graphique ci-dessous nous renseigne que les années 90 ont été caractérisées par l’hyperinflation. L’inflation est faible seulement en 1998. L’hyperinflation a atteint quatre chiffres en 1994 avec un taux annuel de l’ordre de 9797%. Cette situation provient du financement de déficits budgétaires par la planche à billets. En effet, à la fin des années 80, on assiste à une chute drastique de la production du cuivre suite à la vétusté des équipements.
Celle-ci a occasionné une baisse importante des recettes de l’Etat puisque la Gécamines contribuait à près de 70% au budget de l’Etat congolais. En conséquence, le budget de l’Etat a accusé d’importants déficits qui furent financés par la planche à billets étant donné que le gouvernement avait peu de possibilités pour s’endetter aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays.
Ce n’est qu’à partir de la décennie 2000, qu’on assiste à une baisse du taux d’inflation.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du taux d’inflation de 1964 à 2020
[4_img_4]
Graphique N°6 : Evolution du taux d’inflation
Source : données tiré dans le rapport de la banque mondiale
L’hyperinflation avait entraîné une forte instabilité macroéconomique entrainant la faillite de plusieurs entreprises notamment celles du secteur privé. D’abord les entreprises avaient réalisé d’énormes pertes du fait que toutes n’avaient pas pu intégrer la dépréciation monétaire dans leurs coûts de revient, notamment les anticipations d’inflation future, ce qui entraîna une érosion monétaire.
Ensuite, l’hyperinflation avait eu pour conséquence d’exacerber les contraintes de financement des entreprises, car ces entreprises ont eu du mal à constituer des ressources pour s’autofinancer puisque la valeur monétaire s’érode au jour le jour. Cette érosion monétaire a entraîné la dollarisation de l’économie car les agents économiques n’avaient plus confiance en la monnaie nationale.
A l’amorce de la période de 2002 à fin décembre 2019, période pendant laquelle l’inflation a été maintenue suite à une politique monétaire voire budgétaire orthodoxe. En effet en l’absence des chocs extérieurs importants, le cadre macroéconomique est demeuré stable. L’évolution du taux d’inflation se présente comme suit : 15,8% ; 4,4% 21,3% ;18,2% ;27,6% ;53,4% ;9,8% ;2,7% ;1,1% ;0,5% ;0,8% ;26% ;53% ;7,2% et 4,4%.
Le marché de change était également caractérisé par une stabilité structurelle. Il sied de souligner qu’à la suite de l’avènement de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de Covid-19, l’économie congolaise est affectée à l’instar d’autres pays de la planète et des mesures conjoncturelles sont en train d’être prises progressivement pour juguler les méfaits de ladite crise et permettre aux entreprises de se maintenir21.
En définitive, l’environnement économique dans lequel évoluent les agents économiques en RDC n’est pas stable. Un tel environnement n’est pas favorable à l’épargne car les épargnants ont besoin d’être rassurés que leurs épargnes sont protégées. Dans ces conditions on ne peut pas booster l’économie nationale. Il faudra donc l’assainir en vue d’espérer une forte mobilisation de l’épargne intérieure et donc trouver de quoi financer l’économie congolaise.
________________________
16 L’insaisissable relation entre « bonne gouvernance » et développementNicolas Meisel, Jacques Ould AoudiaDans Revue économique 2008/6 (Vol. 59), pages 1159 à 1191 ↑
17 http://www.heritage.org/index/download ↑
18 Fondation héritage, 2012 cité dans le rapport publié par perspective mnode usherbroke University canada. ↑
19 Rapport annuel de la Fondation héritage, 2012 ↑
20 Monnaie, banque et marchés financiers Frederic Mishkin 2010======================================= ↑