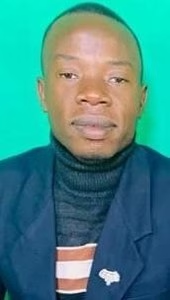Les pouvoirs en affaires courantes sont caractérisés par des limitations strictes, interdisant au gouvernement d’agir au-delà des affaires banales. Cet article explore la pratique des affaires courantes et son impact sur l’action gouvernementale en période d’inaction.
§2. Effets des affaires courantes
Des pouvoirs limités
Le gouvernement réduit à l’inaction, il doit s’abstenir de poser le moindre acte qui, en période normale, aurait pu justifier l’interpellation, question ou enquête devant le parlement1. En effet, il n’existe pas une liste type des affaires courantes, mais une pratique des affaires courantes. C’est ainsi que, à l’absence de cette liste, les affaires courantes sont considérées comme des affaires banales, celles qui relèvent du quotidien de la gestion publique.
C’est le cas de la distribution du courrier, les concours de la fonction publique sont organisés, les pensions de retraite sont versées, le paiement des employés, etc. . Il s’agit donc des opérations qui relèvent de l’usage habituel de la gestion administrative, qui doivent être accomplies. Non qu’elles soient sans importance, mais qu’elles forment le substrat de la vie de l’État.
Ainsi, cette vie de l’État doit se poursuivre, quels que soient les aléas de la vie politique. À cet effet, les affaires courantes, les affaires urgentes, celles que l’État doit prendre en charge sans désemparer, parce que tout retard pourrait mettre en danger les intérêts de l’État qu’il a la charge de protéger.
Ainsi, les mesures urgentes et nécessaires s’imposent à tout prix pour assurer la gestion des affaires publiques, quelle que soit la crise politique du moment2.
En fin de compte, les pouvoirs en affaires courantes se limitent à la gestion des affaires habituelles, qui ne présentent pas en fait une importance exceptionnelle3. Par ailleurs, bien qu’aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire ne limite clairement un tel pouvoir en droit positif congolais. Aussi, de l’absence d’une jurisprudence congolaise en la matière ; nous partageons la même position avec le Conseil d’État belge. En effet, dans l’Affaire Fondation d’utilité publique « Comité belge pour l’UNICEF», qui mérite d’être analysée in extenso ; les requérantes soulèvent un premier moyen, que l’acte attaqué a été pris en violation de l’article 33 de la Constitution, de la violation des articles 70 et 73, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Ils soulèvent en outre l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte et de la violation du principe général de droit selon lequel la compétence de l’exécutif est limitée aux affaires courantes en cas de dissolution des parlements nationaux, communautaires ou régionaux.
Les parties requérantes expliquent que lorsqu’un gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses pouvoirs pendant la période où il échappe au contrôle des assemblées élues, il peut uniquement expédier les « affaires urgentes » et « les affaires courantes ». Elles précisent ce qu’il faut entendre par « affaires urgentes et affaires courantes ».
Elles font valoir que l’urgence ne s’imposait pas en l’espèce pour prendre l’arrêté royal attaqué, vu le temps qui s’est écoulé après la promulgation de la loi habilitante et la formation imminente d’un nouveau gouvernement. Les parties requérantes indiquent qu’il ne peut non plus être soutenu que la matière est de peu d’importance ou de celle déjà en cours dont l’achèvement n’implique pas de choix politiques importants puisque les mesures prévues touchent à la question de la détention des étrangers en séjour illégal spécialement des familles avec enfants et à l’exercice de droits fondamentaux4.
Par ailleurs, la partie adverse répond que la notion d’ « affaires courantes » est généralement opposée à celle d’« affaires de gouvernement ». Elle soutient que, pour considérer que le gouvernement démissionnaire excéderait ses pouvoirs, il faut apprécier si l’acte posé à cette occasion est d’une importance telle qu’il engage les intérêts de l’État et manifeste la mise en œuvre de choix politiques qui n’ont pu recevoir l’assentiment de l’assemblée élue.
Elle ajoute qu’a contrario, l’adoption de mesures d’exécution d’une politique décidée antérieurement, qui vise à permettre l’application de la loi ne saurait être qualifiée d’affaire de gouvernement. Elle rappelle le contenu de l’article 108 de la Constitution et retranscrit un passage d’un arrêt de la Cour de Cassation et d’arrêts du Conseil d’État étayant la notion d’ « affaires courantes ».
Elle précise qu’en vertu du principe de la continuité du service public, les ministres démissionnaires conservent le pouvoir de régler les questions dont la solution ne souffre pas de retard. Elle explique que l’arrêté royal attaqué exécute la loi du 16 novembre 2011 résultant d’une initiative parlementaire et insérant dans la loi du 15 décembre 19805.
Enfin, le Conseil d’État donne son opinion en ce sens : « Dans une période où du fait de la dissolution des chambres législatives, le gouvernement est privé de sa base parlementaire et échappe au contrôle de la Chambre des représentants, il ne dispose plus de la plénitude de ses attributions et peut uniquement expédier les affaires courantes. Il en est de même lorsque le gouvernement a présenté sa démission au Roi.
Relèvent notamment des affaires courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la dissolution ou la démission. Une affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière et qui n’est pas urgente peut néanmoins être finalisée par le gouvernement, malgré la dissolution du parlement ou la démission du gouvernement, si la procédure qui a donné lieu à l’arrêté concerné a été engagée bien avant la période critique, si elle a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique ». Il souligne, en l’espèce : « Au moment où l’arrêté contesté a été pris, soit le 17 septembre 2014, le gouvernement était en affaires courantes à la suite de sa démission le 26 mai 2014.
Cependant, la chronologie des faits fait clairement apparaître que l’adoption de l’arrêté royal attaqué n’a fait l’objet d’aucune précipitation particulière et est le fruit d’une procédure entamée bien avant que le gouvernement fût placé en période d’affaires courantes. Une très grande partie du travail d’élaboration de l’acte attaqué remonte en effet à un moment où le gouvernement était toujours soumis au contrôle parlementaire et disposait de ses pleins pouvoirs.
Il peut dès lors être regardé comme le résultat final d’une opération qui a été entamée, conclue et réglée normalement et non comme la suite surprenante d’une opération rapidement mise sur pied par un ministre qui, n’étant plus responsable politiquement, aurait agi en dehors des conditions constitutionnelles normales. Les différentes démarches relevant du contrôle administratif et budgétaire ont aussi, pour la plus grande partie, été accomplies avant que le gouvernement ne démissionne »6.
Ainsi, il découle de cette affaire, relève notamment des affaires courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la dissolution ou la démission. Une affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière et qui n’est pas urgente peut néanmoins être finalisée par le gouvernement, malgré la dissolution du parlement ou la démission du gouvernement. C’est pour quoi, soumettre l’expédition des affaires courantes qu’aux interdictions, notamment : la suspension des recrutements, des promotions, des nominations, des missions de travail et des paiements de toutes les dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel, comme c’était le cas avec Gouvernement ILU NGA ILUNKAMBA. Cela constitue une restriction exagérée, car les affaires en cours ou déjà engagées sont poursuivies par le gouvernement démissionnaire, quelle que soit leur portée.
La justiciabilité des affaires courantes
La justiciabilité de la théorie des affaires courantes constitue ainsi un garde-fou contre les éventuels excès d’un gouvernement qui se montrerait trop zélé en voulant aller au-delà de ses compétences limitées. Ainsi, l’absence de contrôle parlementaire vis-à-vis d’un gouvernement expédiant les affaires courantes rend plus indispensable la mise en œuvre d’un contrôle juridictionnel effectif, afin de vérifier que celui-ci n’excède pas les limites des affaires courantes7.
En effet, la protection juridictionnelle des droits des citoyens s’articule essentiellement autour de trois organisations contentieuses portant la première sur le contentieux constitutionnel, la seconde sur le contentieux judiciaire et la troisième sur le contentieux administratif8. En effet, les trois types de juridictions sont susceptibles de contrôler l’action de l’Administration dans toutes circonstances, pendant les affaires courantes y compris. Il s’agit du juge constitutionnel (A), du juge judiciaire (B) et efficacement, du juge administratif (B).
A. Juge constitutionnel
À l’occasion d’un contrôle, la constitutionnalité d’un acte doit s’apprécier sous le double prisme de la légalité au sens large et de la légitimité constitutionnelle. Il permet, en effet, d’examiner plus clairement les intentions et les motifs des actes législatifs et réglementaires qui ne sont pas toujours guidés par un souci de protection des libertés9.
En effet, le contrôle exercé par le juge constitutionnel se comprend, dans la mesure où les actes de l’Administration doivent, pour leur régularité, se conformer aux dispositions constitutionnelles. Le juge constitutionnel vérifie, à cet effet, la conformité de l’acte réglementaire à la constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo en son article 162, alinéa 2 dispose que « Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire »10.
Et l’article 128 alinéa 1, de la même Constitution dispose aussi : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire »11. Or les décrets du Premier ministre, les arrêtes, les arrêtés ministériels et arrêtés du gouverneur de province portant nomination interviennent dans une matière autre que du domaine de la loi.
Voilà pourquoi ces actes de nomination, pris par le Premier Ministre ou le gouverneur de province démissionnaires ou réputés tels ou encore un gouverneur intérimaire, sont toujours, comme à temps normal, susceptible d’être censuré par le juge constitutionnel en vertu de l’article 162 alinéa 2 précité.
En fin de compte, au regard de ce qui précède, toute personne (morale ou physique) ayant intérêt dans l’affaire, peut donc saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d’un acte posé en période d’affaires courantes.
Quid du contrôle du juge judiciaire ?
Juge judiciaire
Les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes en principe pour apprécier la légalité d’un acte réglementaire. Par ailleurs, une seule exception est traditionnellement admise en vertu du principe selon lequel les juridictions judiciaires sont gardiennes des libertés fondamentales et des droits individuels. Voilà pourquoi, lorsqu’un tel droit est violé dans un acte administratif, les juridictions judiciaires peuvent refuser son application12.
En effet, en droit congolais, le juge judiciaire exerce un contrôle un indirect sur l’acte administratif c’est-à-dire, il ne vise pas l’annulation de l’acte, mais plutôt sa non- application13. Ainsi, la Constitution congolaise, à son article 153 alinéa 4 dispose que « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs »14. Par conséquent, tout acte réglementaire, même posé en affaires courantes, doit être conforme à la loi, sous peine d’être privé d’application par le juge judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire ne peut contrôler l’Administration que par voie d’exception c’est-à-dire lorsqu’une partie au procès soulève une exception d’irrégularité d’un acte administratif qu’une autre partie voulais son application. Dans ce cas, le juge judiciaire audiencier peut poser une question préjudicielle ou préalable au juge administratif. Ce dernier se limite à un pouvoir de constatation du sens ou de la validité juridique de l’acte administratif. Son travail se limite donc à dire quel est le sens du pareil acte et si oui ou non celui-ci a valeur juridique et peut être appliqué à un litige15.
Par ailleurs, l’exposé des motifs de la Loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, donne une compétence provisoire au juge judiciaire, de censurer les actes de l’Administration en ces termes : « Il est apparu nécessaire de laisser la Cour d’appel et la Cour suprême de justice exercer les compétences leur dévolues, en matière administrative par l’Ordonnance-loi n° 82- 020 du 31mars1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaire jusqu’à l’installation des juridictions de l’ordre administratif »16. C’est ainsi que les Cour d’appel, dans leurs sections administratives, sont compétentes pour censurer les actes réglementaires posés par les Gouverneurs. Dans ce sens, toute personne (morale ou physique) peut saisir la Cour d’appel de Bukavu, section administrative pour violation de la loi dans un acte posé en affaires courantes par une autorité démissionnaire ou intérimaire.
Juge administratif
A côté des contrôles exercés par le juge constitutionnel et le juge judiciaire sur les actes administratifs, celui du juge administratif a la plus grande ampleur. Car le juge administratif est le juge naturel de l’administration, le gardien de la légalité, capable d’annuler un acte administratif et faire disparaitre ses effets antérieurs et présents.
En effet, le juge administratif a pour mission de juger de la conformité des actes, décisions ou règlements des autorités administratives au droit. Il est de ce point de vue, juge de la légalité au sens large de cette expression17. Toutefois, le juge administratif (de même d’ailleurs que le juge judiciaire) ne peut pas contrôler la conformité d’une loi à la Constitution. Il est juge, non des lois, mais des actes administratifs. Mais il peut censurer un acte administratif pris en méconnaissance d’une règle constitutionnelle.
Il peut toutefois arriver qu’un acte administratif contraire à une telle règle soit insusceptible de censure de la part du juge administratif. C’est le cas lorsque cet acte a été pris conformément à une loi, dont il tient le vice d’inconstitutionnalité qui l’entache. La loi, toute inconstitutionnelle qu’elle soit, fait alors écran entre le juge et la règle constitutionnelle.
Censurer l’acte administratif serait, en effet, implicitement, mais certainement, censurer la loi dont il procède ou tout au moins dénoncer l’inconstitutionnalité de cette loi. La juridiction ordinaire (administrative ou, éventuellement, judiciaire) ne pouvant porter de jugement sur la régularité juridique d’une loi, ne pourra que rejeter comme « inutilement invoqué » le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’acte administratif, un tel moyen tendant « nécessairement » dans l’hypothèse considérée, à lui faire apprécier la constitutionnalité de la loi..
________________________
1 F. DELPEREE, « Gouverner sans gouvernement ? », In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome 23, 2012. p. 128. ↑
2 F. DELPEREE, « Gouverner sans gouvernement ? », In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome 23, 2012. p. 129. ↑
3 F. VUNDUAWE te PEMAKO, Op.cit., p. 684. ↑
4 C.E., Section du contentieux administratif, La Fondation d’utilité publique « Comité belge pour l’UNICEF» et crt c./ État belge, Op.cit.,§1, p.2. ↑
5 Idem.,§1, p.3. ↑
6 C.E., Section du contentieux administratif, La Fondation d’utilité publique « Comité belge pour l’UNICEF» et crt c./ État belge, Op.cit.,§2, p.4-5. ↑
7 Ibidem. ↑
8 J. BOUVIER, Eléments fondamentaux de droit administratif, Paris, Avril 2011, p 64. ↑
9 KHADIM THIAM, Le contrôle de l’exécutif dans la création de l’État de droit en Afrique francophone, Droit. Université de Bordeaux, Thèse de Droit public, Archives-ouvertes, 2018, p.48. ↑
10 Art.162, al.2, Constitution de la RDC du 18 février 2006, Op.cit., p.56. ↑
11 Art.128, al.4, La constitution de la RDC du 18 février 2006, Op.cit., p.45. ↑
12 Ibidem. ↑
13 Dans ce cas, l’acte administratif litigieux reste et demeure dans l’ordonnancement juridique, c’est pourquoi il faut saisir le juge administratif pour son annulation. ↑
14 La constitution de la RDC du 18 février 2006, Op.cit., art.153, al.4, p.54. ↑
15 T. MUHINDO MALONGWA, Droit administratif et institutions administratives, Ed. PVG-CRIG, Butembo, 2010, p.435. ↑
16 Loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, in J.O.RDC, n° spécial,2013, p.2. ↑
17 BOTAKILE BATANGA, Op.cit., p. 38. ↑