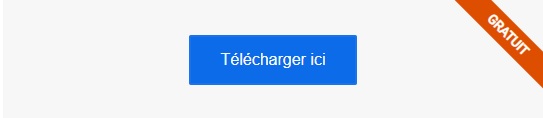Dispositifs de formation et Recherche d’emploi ou de recrutement
3. Les dispositifs de formation à visée professionnelle comme organisations supports de réseaux sociaux dans les processus de recherche d’emploi ou de recrutement
Les formations de l’école comme acteurs du marché du travail
Le travail développé ici s’intéresse aux individus sortant de l’appareil éducatif, et à leurs modes d’accès à l’emploi, particulièrement au premier emploi occupé à la sortie.
Il se situe à la croisée de deux champs de recherches : l’insertion professionnelle des jeunes d’un coté (Nicole-Drancourt & Roulleau-Berger 1995), le fonctionnement du marché du travail de l’autre, plus précisément les modes d’accès à l’emploi. Ces points seront développés au chapitre 1.
Entrer dans une formation pour les élèves n’est pas uniquement l’occasion d’obtenir un diplôme, de se doter de capital humain, mais c’est aussi la possibilité d’avoir accès à un monde professionnel convoité, de se créer des occasions de rencontre avec des professionnels susceptibles de les informer, de les recommander voire même de les embaucher.
C’est pour une grande partie d’entre eux le début de leur carrière qui se joue. De même, les employeurs peuvent y trouver leur intérêt en accédant à un vivier de candidats potentiels, et les responsables de formation se voient ainsi gratifiés de bons résultats en terme de placement de leurs élèves. En ce sens, le système éducatif est présent sur le marché du travail même si il y occupe une position particulière.
Au-delà de la délivrance d’un diplôme, son action sur ce marché peut se comprendre à partir des diverses formations qui constituent chacune un espace du marché du travail à la fois concret comme lieu à partir duquel s’opèrent des recrutements, et spécifique comme lieu des débuts de carrière professionnelle.
Le terme de “ formation ” est cependant ambigu et mérite une clarification sémantique. Il recouvre au moins deux aspects : un diplôme au sens générique du terme et un dispositif éducatif organisé particulier.
Dans le premier cas, il vise le contenu curriculaire de la certification préparée, les objets de connaissance qui constituent son programme. Il s’agit alors de tous les diplômes ayant le même référentiel, par exemple le BTS Action Commerciale ou le baccalauréat S.
Dans le second cas, il désigne les différentes entités organisées au sein desquelles se déroule l’activité de formation. Il s’agit alors du DUT Génie climatique de tel endroit ou tel établissement se distinguant du DUT Génie climatique de tel autre endroit, ou du baccalauréat L de tel lycée.
Les dispositifs de formation comme organisations éducatives spécifiques
C’est ce second sens qui sera retenu ici. L’expression “ dispositif de formation ” désigne ainsi des entités éducatives organisées, constituées d’individus participant à un processus de formation, principalement ceux qui “ produisent ” l’activité de formation (enseignants, intervenants, administratifs…), mais aussi ceux qui sont l’objet du processus formatif (les élèves).
Elles sont situées en un lieu donné, disposent de moyens déterminés, fonctionnent selon des formes pédagogiques spécifiques. C’est ce qu’on peut appeler le moment formatif9, avec ses lieux, ses modes de vie collective, ses règles, ses emplois du temps, ses dispositifs pédagogiques ou ses formes de fonctionnement.
Le terme dispositif a été choisi car il sous-entend aussi des questions d’organisation qui touchent à la fois au rôle de ces dispositifs de formation sur le marché du travail et à la plus ou moins bonne “ efficacité ” de la formation (chapitre 4). Deux auteurs du champ de la gestion permettent de préciser cela.
Ch. Vulliez (1997) parle à ce propos “ d’entreprise éducative ”, définie par un établissement, une implantation géographique identifiée, des moyens humains et matériels, et une direction assurée par un ou plusieurs responsables (p. 1501).
Cette première approche développe un parallèle marqué avec le fonctionnement traditionnel de l’entreprise et assigne en particulier deux finalités à l’entreprise éducative, une finalité individuelle assez classique de transmission des connaissances, et une finalité plus sociale “ d’insertion dans une activité ou une collectivité qui justifie les moyens financiers considérables qu’elle prélève ou qu’elle exige ” (p. 1502).
Elle a le mérite d’établir la proximité des questions organisationnelles dans le champ de la formation avec celles propres aux entreprises, ce qui incite à raisonner en terme d’organisation éducative, avec son objectif, ses moyens, etc., en tant que système d’action organisé selon Friedberg (1992).
Elie Cohen pour sa part (1997) observe le champ de la formation en terme de “ problèmes de gestion ” au sens large, orientation à laquelle nous souscrivons.
9 En reprenant à notre compte et en la modifiant l’expression de moment éducatif, objet de l’analyse d’E. Chatel dans Pragmatiques de l’éducation au lycée, in Institutions et conventions, Paris, sociale de sociale, 1998, pp. 91-118.
Prenant acte des contextes institutionnels particulièrement disparates qui les caractérisent, il définit les organisations éducatives ainsi : un “ organisme spécialisé ”, assurant la “ maîtrise institutionnelle, économique et pédagogique d’un programme ou d’un ensemble de programmes ” qu’il délivre, et pouvant revêtir “ le statut d’un établissement public, d’une société commerciale, d’une association ou encore celui d’une unité dépourvue de la personnalité morale mais dotée d’autonomie au sein d’une organisation plus vaste ” (1997, p. 1568), comme par exemple un département d’IUT ou un DESS spécifique.
Et l’auteur situe d’emblée l’étude de la nature problématique des relations de proximité qu’entretiennent les organisations éducatives et les entreprises comme objectif d’une analyse par la gestion du champ de la formation.
L’enjeu d’une telle approche est alors selon lui de traiter les questions relatives “ à la constitution et à la régulation d’un véritable tissu conjonctif reliant les entreprises et l’ensemble des organisations auxquelles il assure des prestations relatives à la fourniture de ressources éducatives ou informationnelles communes.
A cet égard, la gestion de la formation s’insère dans les stratégies relationnelles des entreprises et s’inscrit dans un espace structuré par des relations de coopération volontaire, de coopération contrainte et de concurrence ” (1997, p. 1567).
Le champ des enseignements concernés
Il s’agit de l’entrée des individus sur le marché du travail ; seuls sont donc considérés les dispositifs de formation à la sortie desquels les élèves ou les étudiants se destinent à occuper un emploi dans un milieu professionnel.
Cela ne recouvre pas les sorties de tous les segments de l’appareil éducatif, mais celles ayant lieu après les années terminales de cursus à visée professionnelle.
D’un coté, ces dispositifs de formation délivrent des enseignements dont la finalité professionnelle, dans un sens large, est affirmée : ils sont tournés plus ou moins explicitement vers le marché du travail, ayant, à des degrés divers, un caractère professionnel, préparant les élèves qui les suivent à des métiers, à des professions, à des fonctions ou à des milieux de travail plus ou moins bien identifiés.
De l’autre, ils correspondent la plupart du temps à la fin d’un cycle, constituent une fin en soi en étant sanctionnés par un diplôme terminal, mais ils peuvent par ailleurs s’intégrer dans un parcours d’étude plus long. Ceci exclut a priori les formations relevant de l’enseignement général. Tous les niveaux de formation peuvent être concernés.
Il ne s’agit pas de proposer une liste exhaustive des diplômes concernés. Elle n’aurait de sens que pour la période actuelle et les pratiques concrètes au sein du système éducatif ne correspondent pas toujours à la définition officielle des diplômes (Vasconcelos 1993, Cacouault & Oeuvrard 1995).
Cela recouvre cependant a priori dans le système éducatif français les CAP, BEP, brevets de techniciens, brevets professionnels, baccalauréats professionnels ou technologiques, BTS, DUT, licences professionnelles, maîtrises de sciences et techniques, IUP, DESS, etc.
Jusqu’aux thèses professionnalisées (comme par exemple celles menées dans le cadre d’une convention CIFFRE), et sans oublier les écoles professionnelles spécialisées, comme par exemple les grandes écoles de gestion ou d’ingénieur, les écoles sociales ou paramédicales, etc.
Seront retenus ainsi dans la suite les seuls dispositifs de formation visant un milieu professionnel donné, plus ou moins bien identifié, mais ayant d’une façon ou d’une autre guidé, orienté, servi de référent à ses concepteurs et à ses responsables.
Dans ce sens d’enseignement à vocation professionnelle, ces dispositifs de formation correspondent ainsi aux organisations éducatives constituant la «bordure externe» du système de formation, à la fois étape finale d’un parcours de formation pour les élèves et partie du système éducatif la plus proche du monde du travail en contact avec les milieux professionnels, située à l’interface entre l’école et ce monde du travail, voire au sein même du marché du travail.
Des individus et des relations : rencontres en cours de formation
Après une première analyse statistique menée sur le secteur (Rannou, Vari 1996), Jeanine Rannou a étudié les carrières des intermittents techniques de l’audiovisuel et des spectacles10 (1997) à partir de 158 entretiens très instructifs.
L’auteur, ne voyant pourtant dans l’école qu’un lieu d’apprentissage, considère que dans ce secteur celle-ci doit être « (…) suffisamment proche du milieu professionnel pour créer les conditions d’une anticipation de la pratique durant la formation, et assure cette anticipation à trois conditions (p. 70) :
- qu’elle garantisse une formation pratique suffisante ;
- que cette formation pratique ressemble le plus possible aux conditions réelles de la vie active ;
- qu’elle soit un premier lieu de rencontres avec des professionnels ».
Les deux dernières conditions sont intéressantes, particulièrement la troisième. J. Rannou (pp. 70-73) montre que l’école joue un rôle de premier contact important, ce dont ont conscience les élèves, puisque « tous se plaignent de n’avoir pas rencontré suffisamment de professionnels lors de leur cursus de formation ».
Et pourtant, comme le souligne Rannou, « c’est sur cet aspect que le rôle des écoles semble le plus performant » : elle constate que les élèves en bénéficient, même quand ils sont insatisfaits de l’enseignement suivi, et surtout ne relient pas spontanément leur période de formation avec les contacts qui leur ont permis de débuter, alors même que cette liaison apparaît à d’autres moments en cours d’entretien11 !
10 Ce secteur recouvre essentiellement trois groupes d’activités : le spectacle vivant (dont le théâtre est le plus emblématique, mais pas le seul sous-secteur), l’audio-visuel (production privée, TV…), et le cinéma (Rannou 1997).
11 Extraits d’entretiens avec Valérie, Didier et Charles (pp.72-73).
Le constat est exactement le même de la part de Catherine Paradeise (1998) à propos des comédiens cette fois-ci. Analysant le rôle de l’école dans les conditions d’apprentissage et la construction des solidarités (pp. 62-67), celle-ci est décrite, au delà des purs aspects de technique professionnelle, comme “ fil d’Ariane des réseaux, apprentissage des bons usages dans des lieux consacrés, repérage des étapes suivies par les anciens, etc. ”, offrant de nombreux avantages relationnels.
Et, “ plus généralement, l’école agit (…) en offrant un espace et un temps privilégiés pour la création de solidarités confraternelles et lignagères entre les jeunes comédiens et leurs aînés, en contribuant activement à la constitution et à la reproduction de ce qu’on désigne de façon suggestive par le terme de ‘familles’ dans le milieu professionnel ”12.
Ces contacts sont supposés être les bons vecteurs d’une socialisation initiale déterminante ou d’un apprentissage mené en partie par compagnonnage, et s’étirant tout au long de la vie active.
12 Paradeise retient aussi la réputation du dispositif de formation comme “ premier profit que les élèves peuvent en attendre ” (1998, p.65), mais ne se pose pas la question de l’origine de cette réputation, oubliant du coup que celle-ci est totalement intégrée aux mécanismes relationnels constitutifs de ces “ familles ” du milieu professionnel.
Mais sont-ils seulement cela ? Derrière l’exigence d’apprentissage revendiquée par tous, élèves comme professionnels ou enseignants, quelles places tiennent réellement ces dimensions relationnelles ?
Certes, les exemples présentés ici sont tirés du secteur culturel ; ces phénomènes y sont particulièrement visibles, cela sera abordé au chapitre 5.
Mais est-ce propre à ce secteur ? Derrière l’institution de formation, acteur de dimension macro sociale souvent sollicité dans les réflexions sur le fonctionnement du marché de l’emploi, se trouvent des individus, acteurs de dimension microsociale.
Ceux-ci agissent selon leur sphère de rationalité qui ne se réduit pas aux missions généralement affectées à l’appareil éducatif, ou aux interprétations macrosociologiques en terme de reproduction.
L’élève, l’étudiant engagé dans une formation de type professionnel côtoie plus ou moins régulièrement des enseignants, des intervenants occasionnels de type professionnel, des professionnels appartenant à la structure d’accueil en stage, éventuellement d’autres acteurs professionnels (des employeurs potentiels par exemple) rencontrés à l’occasion du stage, mais aussi d’autres élèves.
Le dispositif de formation constitué d’un lieu, d’enseignants, d’intervenants divers, de personnels administratifs, d’une organisation (de cours…), et d’une institution de rattachement (une université, un lycée, …), représente un espace, un moment dans la vie d’un individu qui offre des occasions de contacts avec des milieux ne correspondant pas forcément au milieu d’origine, en particulier le milieu professionnel visé par la formation.
De même que la vie familiale ou la vie de quartier constituent le point de départ de relations familiales ou de voisinage, le dispositif de formation, dans la mesure où il s’agit de la dernière année d’un cursus professionnel, peut être le point de départ de réseaux relationnels connectés avec le milieu professionnel visé.
Dès lors il s’agira d’essayer de repérer le poids des réseaux ayant pour base le dispositif de formation, et intervenant dans l’accès à un premier emploi, que ceux-ci aient pour point de départ des enseignants, des professionnels intervenant dans le dispositif de formation à des titres divers, une association d’anciens élèves, ou bien sûr tous les contacts offerts par la mise en situation professionnelle lors du stage.
Le fonctionnement concret d’un dispositif de formation, au-delà des questions d’ingénierie pédagogique, se traduit aussi par une création de lien social qui n’est pas indépendante des modalités d’accès au premier emploi à la sortie de formation.
C’est une fonction que l’appareil éducatif assume de fait. Entre canal de transmission d’information, instaurateur de confiance, et articulateur entre milieux, il s’agit ensuite d’élucider le sens de cette création de lien social entre monde éducatif et monde productif.