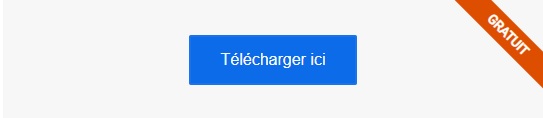Le copyleft : le meilleur hack de Richard Stallman
Durant les premières années du projet GNU, Richard Stallman s’était peu occupé des questions juridiques soulevées par le logiciel libre, n’éprouvant pas d’intérêt particulier pour ce domaine.
Il ne réfléchissait pas au logiciel libre sous l’angle légal, dans la mesure où « son but n’était pas de bricoler la loi, à laquelle il ne connaissait pas grand-chose, mais d’écrire une suite de logiciels libres à même de remplacer les logiciels propriétaires, et de contourner ainsi le problème de la loi »1.
Aux débuts du projet GNU, les droits de propriété intellectuelle (en particulier la loi sur le copyright) avaient pu sembler être un obstacle sur la voie du logiciel libre. Mais il s’agissait d’un obstacle que Richard Stallman entendait esquiver, et non affronter de front.
La nécessité de soumettre les programmes informatiques à des droits de propriété intellectuelle, semblables à ceux en vigueur pour la création littéraire et artistique, avait été dans les années 1970 un objet de débat parmi les juristes.
Aux débuts de l’informatique, les logiciels n’étaient pas protégés par le copyright.
Une telle protection ne renvoyait en effet à aucune nécessité pratique, étant donné les caractéristiques de l’informatique de l’époque (cf. supra).
D’autre part, les logiciels n’étaient pas considérés comme des créations fixées une fois pour toutes et attribuables à un ou plusieurs auteurs, mais plutôt comme des biens utilitaires et fonctionnels. Or, le droit américain du copyright couvre uniquement ce qui relève d’une expression originale, et non des faits, des méthodes ou des idées générales2.
Pour que le logiciel tombe sous le coup de la loi, il fallait donc démontrer qu’il avait un contenu « expressif ». De prime abord, les programmes informatiques ne semblaient pas remplir cette condition.
Ils apparaissaient plus proches d’objets purement fonctionnels (une pince à linge, un piège à souris, etc.) couverts par le régime des brevets.
De surcroît, on pouvait aisément montrer qu’ils s’inscrivaient dans un processus d’écriture continu, étant sans cesse « débogués » et améliorés bien que pour un temps fixés dans des versions dites « stables ». L’application du copyright au logiciel présentait donc des difficultés à la fois théoriques et pratiques, inconnues pour les œuvres artistiques et littéraires.
Aux États-Unis le Copyright Office consentait malgré tout depuis 1964 à enregistrer des logiciels, au « bénéfice du doute » (« rule of doubt »)3. Mais de nombreuses questions juridiques restaient en suspens, et le nombre de programmes déposés était relativement faible.
1 Gabriella COLEMAN, « Code is Speech : Legal Tinkering, Expertise, and Protest among Free and Open Source Software Developper », Cultural Anthropology, vol. 24, n°3, 2009, p. 420-454.
2 Cf. James BOYLE, The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind, New Haven & London, Yale University Press, 2008, p. 20-21, en ligne : http://www.james-boyle.com (consulté le 20/05/2010).
3 Cf. Madeleine DE COCK BUNING, « History of Copyright Protection of Computer Software. The Emancipation of a Work of Technology towards a Work of Authorship » in Karl DE LEEUW et Jan BERGSTRA, The History of Information Security, Amsterdam, Reed Elsevier International, 2007, p. 121-140.
La grande loi sur le copyright de 1976 (Copyright Act) apporta quelques éléments de clarification.
Ainsi, même si le logiciel n’était pas inclus explicitement dans la liste des objets soumis au copyright, plusieurs formulations du texte de loi semblaient confirmer la possibilité de protéger les programmes informatiques.
Les « œuvres littéraires » (literary works) étaient ainsi définies de façon très extensive comme « des œuvres, non audiovisuelles, exprimées en mots, nombres, autres symboles verbaux, numériques ou indications, quelle que soit la nature des objets sur lesquels elles sont représentées, par exemple des livres, revues, manuscrits, microsillons, films, cassettes, disques ou cartes »1.
Il fallut cependant attendre 1980 pour que le logiciel entre explicitement dans la loi américaine sur le copyright, à la faveur du Software Copyright Act, qui ajouta les programmes informatiques à la liste des objets auxquels s’appliquait la loi2.
Dans les faits, celle-ci fut néanmoins appliquée de façon assez libérale par les tribunaux, conformément à la tradition juridique américaine fondée sur la jurisprudence.
Seules furent ainsi sanctionnées les copies littérales de lignes de code, et non l’implémentation de fonctions similaires écrites différemment3. Le droit à la rétro-ingénierie fut également reconnu, conformément à la doctrine du fair use4.
Bien qu’appliquée avec une certaine libéralité, l’évolution du droit américain accompagna et favorisa sans aucun doute l’essor d’une industrie du logiciel autonome.
En revanche, pour un hacker comme Richard Stallman, ces bouleversements juridiques avaient pour effet de rendre plus délicate la réutilisation de morceaux de code écrits par autrui.
L’intégration du logiciel au régime du copyright semblait par conséquent contraire aux principes et aux pratiques de la programmation informatique défendus par la Free Software Foundation.
Richard Stallman découvrit cependant peu à peu que la loi, dont il n’approuvait pas l’esprit, offrait des possibilités insoupçonnées pour le projet GNU.
Il se rendit tout d’abord compte que le copyright n’empêchait pas les auteurs d’autoriser certains usages normalement interdits de leurs œuvres, pourvu qu’ils accompagnent celles-ci de licences spécifiques.
Pour la sortie d’Emacs en 1985, Stallman rédigea ainsi une licence autorisant la modification, la copie et la distribution du logiciel. Les utilisateurs devaient cependant s’engager à ce que les versions qu’ils distribuent, modifiées ou non, le soient toujours sous la même licence et accordent ainsi les mêmes libertés aux utilisateurs ultérieurs.
Ce dernier point, tout à fait inhabituel pour l’époque, était très important pour Richard Stallman, qui avait notamment beaucoup appris de l’exemple du logiciel X Window System.
1 GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Copyright Act, 1976, section 101, en ligne : http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#101 (consulté le 28/05/2010).
2 En France, le logiciel bénéficie d’une protection par le droit d’auteur depuis la loi du 3 juillet 1985. Il est cependant placé sous un régime dérogatoire. Ainsi l’auteur d’un logiciel ne bénéficie pas du droit de repentir et du droit à l’intégrité de l’œuvre (article L.121-7 du Code de la propriété intellectuelle).
En outre, lorsque le logiciel est créé dans le cadre d’une entreprise, les droits patrimoniaux appartiennent à celle-ci, et non aux auteurs (article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle).
3 C’est du reste cette interprétation de la loi qui permis à Richard Stallman de mener son combat contre Symbolics sans violer les copyrights possédés par l’entreprise. Cf. supra.
4 Sur ces points, voir James BOYLE, op. cit., p. 165-166
Développé par le MIT, ce logiciel avait été publié en juin 1984 sous une licence permissive, qui en en autorisait la copie, la modification et la distribution.
De nombreuses entreprises en profitèrent rapidement pour ajouter X Window System à leurs suites logicielles propriétaires, privatisant du même coup le programme, qui se retrouvait dès lors soumis aux mêmes conditions restrictives d’utilisation que les autres logiciels de l’éditeur.
Il apparut donc qu’un logiciel distribué comme logiciel libre pouvait se voir retirer cette qualité, en cas d’appropriation par un acteur privé.
C’était là tout ce que Richard Stallman voulait éviter. Sa parade fut d’ajouter à la licence d’Emacs la clause susmentionnée, stipulant que les versions ultérieures du logiciel devaient être distribuées selon les mêmes termes que la version initiale.
Richard Stallman commença ainsi à s’approprier les possibilités que la loi sur le copyright donnait aux auteurs, en leur permettant d’autoriser certains usages de leurs œuvres et d’en interdire d’autres.
La licence écrite pour Emacs n’était cependant pas très solide juridiquement, et il ressentit bientôt le besoin de prendre conseil auprès de professionnels compétents.
Il s’avisa aussi qu’il serait souhaitable de monter en généralité et de créer une licence qui puisse s’appliquer, non pas à tel logiciel particulier, mais à tout logiciel libre.
Après quelques années de maturation et de discussions, ces réflexions aboutirent en février 1989 à la première version d’une licence que Richard Stallman rédigea avec l’aide du juriste Eben Moglen : la General Public License (souvent abrégée en GNU GPL ou simplement GPL).
Celle-ci devint aussitôt la licence attachée à tous les logiciels développés dans le cadre du projet GNU.
Dans la lignée de la licence Emacs, elle avait pour particularité de conférer aux utilisateurs les quatre libertés fondamentales du logiciel libre (utilisation, copie, modification, distribution), tout en assortissant celles-ci d’une contrainte : l’obligation de maintenir la licence GPL sur les versions dérivées, de sorte que tous les utilisateurs futurs du logiciel, modifié ou non, disposent eux aussi des mêmes libertés.
Se transmettant ainsi d’une version du programme à l’autre, la GPL fut ensuite régulièrement décrite par ses « ennemis » (mais aussi parfois par ses défenseurs) comme « virale »1.
1 Le qualificatif « viral » fut notamment employé à propos de la GPL par Craig Mundie, aujourd’hui directeur de la recherche et de la stratégie chez Microsoft.
Steve Ballmer, PDG de la même entreprise, alla lui jusqu’à qualifier la GPL de « cancer » dans une interview au Chicago Sun-Times en 2001
Ce qualificatif peu amène, et pas tout à fait juste1, évoque ce qui constitue indéniablement la principale innovation de la GPL : la distance prise par rapport au régime du domaine public.
En effet, les universités plaçaient jusqu’alors les logiciels dont elles n’escomptaient pas tirer de bénéfices commerciaux dans le domaine public, afin de les rendre disponibles au plus grand nombre d’utilisateurs possibles.

Ce faisant, elles permettaient aussi à des entreprises de se les approprier, et de les intégrer à des offres payantes accompagnées de conditions d’utilisation restrictives (voir l’exemple donné plus haut de X Window System).
Le régime du domaine public était ainsi impropre à garantir qu’un logiciel distribué initialement avec les quatre libertés demeure libre pour l’ensemble de ses utilisateurs futurs.
La GPL se construisit en réaction à cette faiblesse, à partir de l’idée que le domaine commun devait être défendu contre ses ennemis, et contre sa possible privatisation ou dénaturation. Elle introduisit ainsi un élément de contrainte juridique, mais dans le seul but de protéger et de pérenniser les droits des individus sur le logiciel2.
Ce geste allait se révéler d’une ampleur considérable.
L’ironie de l’histoire était qu’il avait été rendu possible par l’intégration du logiciel au régime du copyright, lequel avait pourtant pu sembler être, dans un premier temps, un obstacle à la réalisation des objectifs du projet GNU.
Pour cette raison, Richard Stallman n’hésita pas à décrire le raisonnement à l’origine de la GPL comme « une forme de ju-jitsu intellectuelle, destinée à retourner le système légal mis en place par ceux-là mêmes qui souhaitaient retenir pour eux seuls les biens logiciels »1.
Il donna aussi de ce retournement une formulation percutante, à travers le terme de copyleft (parfois traduit en français par « gauche d’auteur »).
Celui-ci lui fut inspiré par Don Hopkins, un programmeur et artiste facétieux, qui lui envoya au milieu des années 1980 un courrier sur lequel était inscrit : « Copyleft – all rights reversed » (« Copyleft – tous droits reversés »).
1 Richard Stallman et de nombreux partisans de la Free Software Foundation considèrent les comparaisons à des virus ou des maladies comme des termes de propagande de Microsoft, non seulement offensants mais aussi erronés.
En effet, la GPL ne se transmet pas à tous les logiciels qu’elle « touche », mais seulement à tous les logiciels utilisant une partie substantielle d’un code déjà placé sous GPL.
Richard Stallman préfère pour cette raison utiliser l’image de la « plante grimpante », capable de repousser quel que soit l’endroit où l’on en place des boutures (cf. Richard M. STALLMAN, Sam WILLIAMS, Christophe MASUTTI, op. cit. p. 19).
Fred Couchet de l’April parle lui de licence « prophylactique », et insiste sur la dimension de choix au cœur de la GPL : « Un virus, tu ne choisis pas de le choper malheureusement, alors que la GPL, tu choisis de l’utiliser en toute connaissance de cause. Et ce n’est pas parce que tu vas utiliser de la GPL, que ça va se transmettre à tout ton code.
C’est vraiment un choix volontaire » (Fred COUCHET, informaticien, délégué général de l’April, entretien réalisé à Paris le 28 octobre 2009). Malgré tout, il n’est aujourd’hui pas rare de voir la licence GPL décrite comme « virale » chez des partisans du logiciel libre, même lorsque ceux-ci sont de bons connaisseurs du sujet.
2 Cette caractéristique essentielle de la GNU GPL la différencie nettement d’autres licences comparables, comme les licences de type BSD, qui ne comportent pas d’obligation à ce que les versions dérivées du logiciel soient diffusées selon la même licence.
Ces subtilités juridiques témoignent en fait de différences d’approche assez nettes. Les partisans de licence de type BSD prétendent ainsi qu’il est inconvenant et auto contradictoire de « forcer » les gens à être libres, en introduisant dans les licences un élément de contrainte comme le fait la GNU GPL.
Les défenseurs de cette dernière affirment au contraire que les quatre libertés du logiciel doivent être défendues et pérennisées, et que le libre n’a pas vocation à servir d’input gratuit pour les entreprises faisant du logiciel propriétaire.
Comme le rappelle Fred Couchet, il s’agit donc d’ « une séparation assez franche dans le monde du logiciel libre » (Fred COUCHET, entretien cité). Par ailleurs, on remarquera que la licence BSD place les logiciels sous un régime juridique très proche de celui du domaine public (à quelques restrictions mineures près, concernant notamment la redistribution), alors que la General Public License s’en distingue clairement en introduisant un élément de contrainte fort concernant les conditions d’utilisation des œuvres dérivées.
Par-delà le jeu de mot, le copyleft ne tarda tarda pas à être reconnu comme « l’un des meilleurs hacks de Stallman »2. Il se transforma ainsi en symbole de la créativité, de l’ingéniosité et du goût du jeu typiques de l’esprit des hackers du MIT.
Il devint surtout l’emblême d’un certain positionnement vis-à-vis du copyright : non pas simple négation, mais construction d’une alternative fondée sur les privilèges exclusifs conférés aux auteurs3.
1 Richard STALLMAN, cité dans Richard M. STALLMAN, Sam WILLIAMS, Christophe MASUTTI, op. cit., p. 173.
2 Richard STALLMAN, cité dans Richard M. STALLMAN, Sam WILLIAMS, Christophe MASUTTI, op. cit., p. 172.
3 Comme le rappelle le juriste Mikhaïl Xifaras, c’est bien « parce qu’il est propriétaire de ses créations que le créateur a la liberté d’user librement de son bien, jusqu’à décider de ses conditions de distribution » (Mikhaïl XIFARAS, « Le copyleft et la théorie de la propriété » in Multitudes, Paris, Éditions Amsterdam, n° 41, printemps 2010, p. 50-64). Autrement dit, le copyleft fut bel et bien rendu possible par le copyright. Par conséquent il ne l’ignore pas et ne le transgresse pas non plus.
Cette spécificité, cruciale pour comprendre ce qui se joue dans le logiciel libre, est malheureusement ignorée par certains auteurs, dont la critique ne peut dès lors que manquer son objet.
Ainsi, dans un article consacré au téléchargement illégal et plus largement au « mauvais utopisme » ayant cours à propos d’Internet, Gaspard Lundwall écrit que « la copyleft loue les glorieux effets du piratage sur le «bien-être général» » (Gaspard LUNDWALL, « Le réel, l’imaginaire et Internet », Esprit, op. cit.).
Cette assimilation entre le piratage et le principe du copyleft témoigne d’un contre-sens total.
Le piratage est une violation du droit d’auteur, qui peut être juridiquement assimilée à de la contrefaçon. L’utilisation de licences de type copyleft est à l’inverse pleinement légale, et repose précisément sur l’application du droit d’auteur.
Autrement dit, le piratage est une négation de la volonté de l’auteur, tandis que le copyleft exige le respect de cette volonté [Cf. Lawrence LESSIG, « An obvious distinction », The Huffington Post, 12 novembre 2010, en ligne : http://www.huffingtonpost.com/lawrence-lessig/an-obvious-distinction_b_783068.html (consulté le 16/02/2011)].
L’amalgame entre les deux est donc radicalement inexact et trompeur, et ne saurait être excusé par l’argument vaguement sociologique, selon lequel certains défenseurs du copyleft en matière de licences logicielles témoignent par ailleurs d’une certaine indulgence vis-à-vis de la copie non autorisée d’œuvres culturelles