L’approche méthodologique restavèk Haïti révèle une réalité troublante : des milliers d’enfants vivent dans des conditions d’esclavage moderne. Cette recherche met en lumière les origines historiques et les impacts dévastateurs de cette pratique, essentielle pour comprendre les enjeux contemporains des droits des enfants en Haïti.
Université d’Ottawa
L’École de Service Social
Maitrise en service social
Mémoire déposé à l’École de Service Social en vue de l’obtention de la maitrise en service social
Examiner la pratique du restavèk en Haïti à travers une perspective postcoloniale
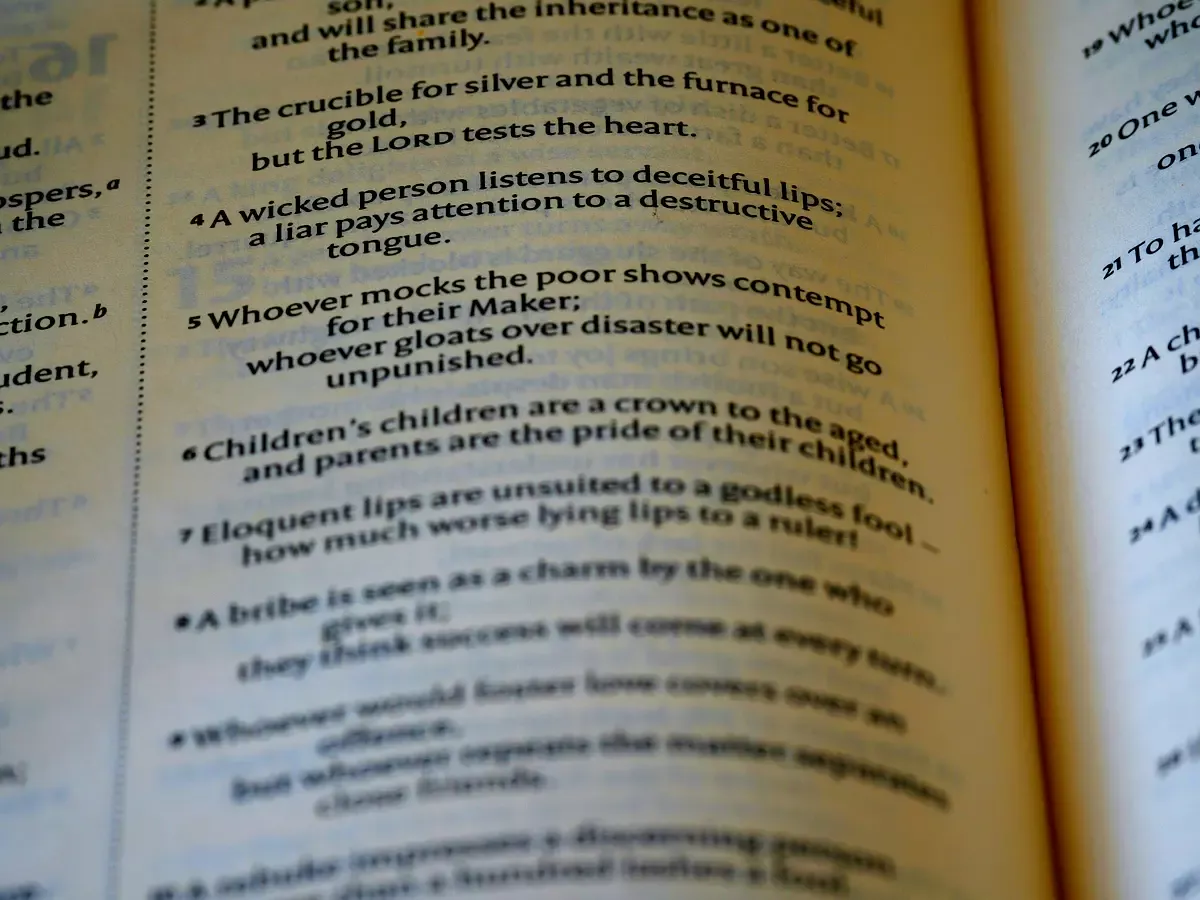
Présenté par Taïna Frazil
Sous la direction de Sonia Ben Soltane
Septembre 2020
Ce mémoire a pour but de comprendre et d’analyser les réalités des enfants en situation de domesticité en Haïti communément appelé restavèk. Cette pratique sociale s’explique par le fait que des parents qui sont en situation de pauvreté vont envoyer leurs enfants dans des familles aisées dans l’espoir qu’ils auront une vie meilleure.
Ces enfants deviendront des domestiques qui vont accomplir des tâches pour lesquels ils ne seront pas ou très peu rémunérés. La pratique été examinée de près par les militants des droits de l’homme et des ONG qui l’ont décrite comme une forme d’esclavage moderne. Cette situation permet de refléter les manières complexes dont le pouvoir est exercé, la manière dont les gens occupent simultanément les rôles d’ « oppresseur » et d’ « opprimé ».
De plus, ce mémoire vise à démontrer les conditions et les origines du restavèk qui sont attachées au passé historique de l’esclavage en Haïti qui permette à cette pratique de perdurer. En ajout, une partie de ce projet consiste à comprendre comment le fait de vouloir donner un enfant pour une vie meilleure peut être comparable à de la servitude, une réalité moins désirable pour le bien-être de celui-ci.
Mots clés : Restavèk, Haïti, esclavage moderne, domesticité, travail des enfants
Memwa sa a gen pou objektif, konprann ak analize reyalite timoun ki rete kay moun an Ayiti, timoun yo rele restavèk yo. Se yon Pratik sosyal ki jwenn sous li nan zafè paran ki pi pòv k ap voye pitit yo al rete lakay yon fanmiy ki gen plis mwayen ekonomik, nan espwa timoun sa yo pral jwenn yon lavi miyò.
Timoun sa yo vin tounen domestik, se yo menm ki fè tout travay nan kay la, epi yo pa peye yo pou sa. Militan dwa moun ak ONG yo te analize pratik sa a, e yo prezante l tankou yon fòm esklavaj modèn. Se yon sitiyasyon ki montre kijan pouvwa egzèse epi kòman yon moun kapab jwe wòl « opresè » epi « oprime » an menm tan.
An plis, memwa sa vle demontre nan ki kondisyon ak ki kote pratik restavèk la soti. Pratik sa a mare ak istwa esklavaj Ayiti, sa ki pèmèt li ap kontinye. Met sou sa, yon pati nan pwojè sa a, se konprann kijan bay yon timoun nan lide pou li gen yon lavi miyò kapab tounen esklavaj, yon reyalite ki pi mal pou byennèt timoun sa a.
Mo kle : Restavèk, Ayiti, esklavaj modèn, domestisite, travay timoun.
Le travail d’enfant domestique est une réalité qui existe dans le monde entier. Cette pratique fait référence à la situation d’un enfant qui n’est pas en âge de travailler et qui va occuper un emploi dans laquelle des tâches domestiques qui se déroulent dans des conditions analogues à celles de l’esclavage (Organisation internationale du Travail (OIT) 2015).
Les raisons qui font que des enfants sont dans cette situation sont généralement liées à la pauvreté de leurs familles qui vivent souvent en milieu rural. En plus des risques associés aux tâches que doivent effectuer ces enfants, le travail domestique est une violation de leurs droits fondamentaux, car il les prive de l’accès à l’éducation, aux soins de santé, au droit aux loisirs et au repos, ainsi que du droit d’être protégés et d’avoir des contacts avec leurs parents ou d’autres membres de leur fratrie (OIT, 2015).
Bien que le travail des enfants domestiques soit un problème majeur dans le monde, il est difficile de connaître les chiffres exacts, l’organisation internationale du travail (2015), estime cependant qu’il y a plus de jeunes filles qui travaillent comme domestiques. Les enfants qui travaillent dans le service domestique sont généralement exposés à des risques de blessures physiques dus au fait qu’ils doivent transporter des charges lourdes, travailler de longues heures et être exposés à des produits chimiques.
Ils risquent également de subir des dommages psychologiques en raison du manque d’occasion de jouer, et à l’absence d’affection de leurs parents ainsi que « de leurs employeurs ». De nombreux pays n’adressent pas le travail des enfants domestiques, ce qui fait que les défis de ces derniers passent inaperçus (Sommerfelt, 2014).
En Haïti, et depuis le tremblement de terre qui a eu lieu en janvier 2010 et les drames qui sont arrivés au cours des dernières années ont fait en sorte qu’une attention particulière s’est portée sur la réalité des enfants haïtiens en situation de domesticité (Breyer, 2016). Cette catastrophe a fait environ 300 000 morts, déplacé près d’un million de personnes et endommagé près de la moitié de toutes les structures de la capitale du pays (Hearst, 2010).
De plus, le tremblement de terre de 2010 a été suivi d’une épidémie de Choléra qui a entrainé la mort de plusieurs milliers de personnes (Hearst, 2010).
L’effet sur les enfants haïtiens a été dévastateur, car plus de 4000 écoles ont été endommagées ou complètement détruites (Eaton, 2017). Selon le président haïtien de l’époque Jean-Bertrand Aristide, le séisme a gravement affecté l’économie haïtienne qui était déjà fragile. L’impact économique et la destruction des infrastructures ont augmenté la vulnérabilité des enfants et ont contribué à l’augmentation du travail et de la souffrance de ces enfants (Holmes, 2013).
Selon le journal américain The Economist, en 2015, plus de 85 000 personnes vivaient dans des tentes dans la capitale haïtienne. Par ailleurs, le déracinement de 1,5 million d’individus a permis à des trafiquants de s’attaquer aux plus vulnérables, soit les femmes et les enfants (Economist, 2015).
Dans ce paysage global, il existe en Haïti une pratique répondue de placer des enfants comme domestiques dans des familles plus aisées et qui est nommé Restavèk. Restavèk est un mot en créole haïtien qui se traduit par « celui qui reste avec ». Concrètement il désigne la situation des enfants qui sont amenés dans les grandes villes ou dans les zones urbaines par un parent dans l’espoir qu’ils reçoivent une éducation ou de la nourriture.
Les enfants restavèk sont parfois confiés à des proches plus fortunés, vivant dans les grandes villes, d’autres peuvent être vendus comme domestiques parce que leurs familles biologiques n’ont pas les moyens de répondre à leurs besoins de base. Dans certains cas, des enfants orphelins peuvent se retrouver dans cette situation, car le gouvernement n’offre pas beaucoup de services à ces enfants en raison de l’instabilité financière du pays (Bourdreaux, 2015).
Les familles biologiques des enfants restavèk se tournent vers cette pratique parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de nourrir leurs enfants. Pour eux, leurs enfants seront mieux avec les familles qui les accueillent. Ils espèrent qu’ils seraient mieux soignés, et qu’ils auraient accès à une éducation et de meilleures chances dans la vie.
Une fois placés, ces enfants sont loin de leurs familles à cause de la distance, ils se retrouvent à la merci de leurs tuteurs et dans des situations de domesticité (Bourdreaux, 2015) et d’exploitation. Ce système fait partie d’une tradition haïtienne qui demeure très ancrée dans la société actuelle (Chin, 2003).
La présente recherche vise à documenter une réalité haïtienne sur laquelle très peu de recherches ont été effectuées. Cette étude sera divisée en six parties en plus de la préface, l’introduction, un chapitre de recommandations ainsi que la conclusion. La première partie de ce mémoire est consacré à la problématique et permettra d’évoquer les éléments liés à la domesticité chez les enfants en Haïti.
Le chapitre se conclura avec la question de recherche ainsi que sa pertinence. Le chapitre suivant concerne le cadre théorique et conceptuel qui sera utilisé dans la recherche. Il parlera notamment de l’esclavage, du travail invisible ainsi que de la théorie post colonialisme.
Le troisième chapitre vise à documenter l’approche méthodologique qui a été utilisée, soit l’ensemble des étapes. Cette section permettra aussi de ressortir les considérations éthiques ainsi que les limites de la recherche.
Le chapitre quatre permettra d’examiner la pratique de restavèk à l’aide de littérature folklorique haïtienne. Ensuite le chapitre cinq permettra d’examiner la pratique du restavèk avec le concept du travail invisible. Le chapitre six sera la discussion qui permettra de démontrer que le restavèk tire ses racines de la période coloniale du pays.
Enfin nous présenterons la conclusion de cette recherche.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la pratique du restavèk en Haïti?
La pratique du restavèk en Haïti consiste à envoyer des enfants de familles pauvres vivre avec des familles aisées, où ils deviennent des domestiques accomplissant des tâches sans rémunération.
Pourquoi la pratique du restavèk est-elle considérée comme une forme d’esclavage moderne?
Cette pratique est considérée comme une forme d’esclavage moderne car les enfants travaillent sans être payés et sont souvent privés de leurs droits fondamentaux, tels que l’accès à l’éducation et aux soins de santé.
Comment le passé historique d’Haïti influence-t-il la persistance du restavèk?
Les origines du restavèk sont attachées au passé historique de l’esclavage en Haïti, ce qui permet à cette pratique de perdurer malgré les dénonciations des organisations de défense des droits humains.