III. 3. Le positionnement idéologique de Leila Marouane
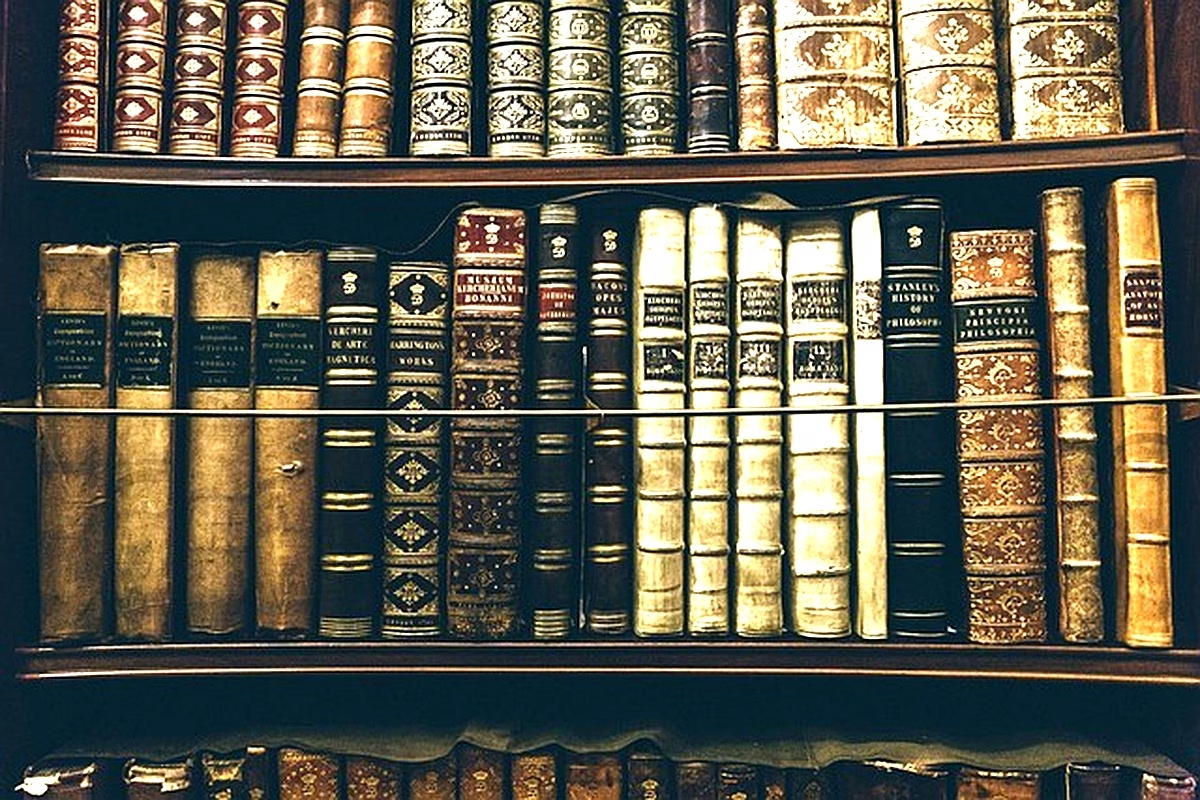
III. 3.1. « La vocation énonciative»
Selon Maingueneau, le positionnement se définit comme une défense d’une esthétique et une qualification requise pour avoir l’autorité énonciative1. Les années 90 ont vu la prolifération de livres qui témoignent de la situation en Algérie. Cette production littéraire est marquée par le phénomène de la violence qui a traversé le pays.
Ce qui a mené Christiane Achour à parler d’une tension entre création « qui demande distance et médiation esthétique » et urgence « qui tire vers l’immédiateté du témoignage et les degrés zéro ou tragique de l’écriture »2
La plupart des écrivains ressentait cette nécessité de témoigner, de dire et de faire agir. Cette littérature produite se voulait « une littérature de sursaut, celle de lutteurs contre la fatalité »3. Leila Marouane fait partie de cette génération d’écrivains qui voulaient raconter la violence, mais
« raconter le tragique sur un ton burlesque » précise-t-elle. Elle croyait avoir « l’autorité énonciative requise pour devenir écrivain »4, et se réclame de la littérature de combat et fait montre de cette idéologie dans son roman. Cette écrivaine est considérée comme la plus rebelle des écrivaines arabes
Cette écrivaine est venue à l’écriture grâce à un père, homme de lettre, marxiste et antireligieux et une mère féministe et anticolonialiste. De ses parents, elle hérite tous ses principes : Leila Marouane se réclame défendre les droits de la femme. Dans son roman elle fait montre de se convictions et réflexions.
Journaliste déjà, elle commençait son combat en écrivant sur la société algérienne ce qui lui a valu d’être convoquée à maintes reprises au ministère pour modifier ses articles « ils m’envoyaient un chauffeur qui me conduisait au ministère où l’on me dictait la mise au point »5 jusqu’au jour où elle fut agressée par des personnes inconnues la laissant pour morte sur le boulevard de Bou Smaïl à Alger.
Elle décide alors de quitter l’Algérie, de s’exiler pour pouvoir écrire, comme elle évoque dans son entretien avec un journaliste algérien « je pense que si j’étais restée en Algérie, vu le thème de mes écrits et le « délit d’opinion » toujours en vigueur, l’idée de publier ne m’aurait même pas effleuré l’esprit.
Lâcheté ou instinct de survie ? Je ne sais… »6. Elle continue de publier ses articles dans des journaux français et allemands.
Mais l’arrivée de Marouane dans le monde des lettres se fait après le décès de sa mère en 1991. Elle avait peur de rentrer en Algérie par crainte des représailles et n’avait par conséquent pas assisté à son enterrement. Elle ressentait le « besoin de partager, d’enfanter » et décide alors de publier ces romans qualifiant son écriture de « littérature de combat ».
Cette « vocation énonciative » s’explique par son désir d’extérioriser la violence qu’elle a vécu mais aussi pour réclamer plus de droit pour ses concitoyennes et de raconter autrement un récit tragique même si elle s’autocensure en taisant son vrai nom7. L’autocensure est associée au positionnement de l’auteur qui ne pouvait dévoiler son vrai nom.
Son roman est un travail sur la violence « C’est essentiellement cette violence tant refoulée et qui trouve dans la littérature un espace de libération, de délivrance. La violence marque le quotidien. Mais nous ne faisons que la refouler, que la dompter en quelque sorte. Ecrire, c’est violenter notre propre corps, lui faire exprimer l’inexprimable.
La littérature devient, malgré elle, un défouloir, un ersatz de la mémoire, d’une mémoire en pointillés, prompte à se réveiller dès qu’on la triture. Nous sommes quotidiennement sujets à de multiples violences, à diverses meurtrissures. Moi-même, j’ai vécu une violence physique concrète qui m’a longtemps marquée. »8
Son positionnement se manifeste dans son écriture qui devient le lieu de la dénonciation et de la contestation. L’écriture devient alors une thérapie et cette blessure sera projetée dans ces romans.
La détermination de l’auteur est de témoigner d’une « « tragédie d’une génération et tragédie de soi »9. Elle explique à ce sujet que
« L’écriture ne soigne rien. La folie ne se saisit que si on lui ouvre nos bras. La folie est une sorte d’ersatz paradoxal de la vie. Michel Foucault a bien raison de signaler ce phénomène dans son « Histoire de la folie ». La fascination de la folie me pousse à l’écriture, comme me fascine ma mère qui n’a pas arrêté de délirer à la fin de sa vie, elle qui a, comme acte politique, donné naissance à dix enfants et qui a vite
rejoint le maquis. Après, c’est la désillusion totale, le désenchantement. Ma mère retrouve ainsi par brides ses souvenirs, se reconstruit sa propre mémoire violentée. D’ailleurs, mon héroïne fonctionne de cette manière. De nombreux traits de ma mère se retrouvent chez mon personnage. Elle est tellement déçue qu’elle prend la place du bourreau.10
« La vocation énonciative» peut se lire dans le roman dans les choix faits par l’auteur. Elle prend comme matière première sa vie privée.Ses pensées traversent la langue des personnages qui s’expriment sur les problèmes de la société algérienne et ses traditions.
La préoccupation de Marouane en tant qu’écrivaine est de ridiculiser les abus de la société ou les travers des personnes dans l’intention de provoquer un changement. L’auteur présente la réalité sous forme exagérée et déformée pour dévoiler sa dimension ridicule et grotesque.
Dans ce sens, le récit de Marouane se présente comme une satire qui selon la définition de Jolies « est une moquerie qui porte sur 1’objet qu’on blâme ou qu’on réprouve et qui nous est étranger. Nous nous refusons à avoir rien en commun avec 1’objet de ce blâme, nos nous y opposons brutalement, nous le dénouons donc sans sympathie ni compassion »11
Ce rôle de satiriste lui accorde la possibilité d’exposer une réalité ou une vérité absurde pour inciter le lecteur à la réflexion et à une prise de position.
Meredith définit ainsi la position du satiriste « le satiriste est un agent moral, souvent un égoutier social, travaillant sur un amas de bile »12
Dès le début du roman, l’auteure use de la satire pour dévoiler les dysfonctionnements de la société algérienne, et ce, pour justifier son retrait, son refus d’adhésion à cette société. D’ailleurs l’auteur refuse de rentrer en Algérie tant que les lois sont en défaveur des femmes.
Elle transpose un univers familial plein d’absurdités (rapports époux/épouse-enfants/parents-fille/garçon) ; elle souligne aussi la condition de la femme soumise et cloîtrée que l’on marie contre son gré.
- Elle m’a bien épousé contrainte et forcée. Et elle n’avait pas seize ans. Ça ne nous a pas empêchés d’avoir les enfants que vous savez et plus de vingt ans de vie commune. (p. 22)
La femme est présentée comme soumise dans une famille où la seule personne ayant droit à la parole est l’homme Un homme qui n’existe que par sa parole d’ordre, d’interdit et de permis. Les autres membres sont condamnés au silence. Le mutisme nous conduit vers un non existence. Au fond de ces personnages et notamment la mère se trame la révolte et le refus de cette vie
Puis elle se penche sur les rapports filles/ mère, les caractérisant de rapports jalonnés de barrières
Consciemment ou non, ma mère avait jalonné nos rapports de barrières. (p.31)
Ma mère ne nous avait jamais entretenues comme une femme entretient ses filles. (p.31)
Et voilà ! Des mots, rien que des mots, mais pas la moindre émotion pour me reprocher mes échecs. Car si ma glorieuse carrière d’infirmière n’avait pas vu le jour, ma mère n’en avait cure. (p.30)
Pour arriver à la discrimination dans l’éducation des enfants dans les années quatre-vingt-dix.
II en allait autrement pour mon frère. p.31
Il était tout naturel à ma mère de créer une proximité avec la lumière de sa vie (…) elle traitait mon frère avec plus d’égards. p.31
Elle s’inquiétait de son appétit, de sa santé, les meilleurs morceaux de viande lui revenaient, et il arrivait que ma mère lui palpât le front plus de dix fois dans une soirée (…) et ne lésinait sur rien pour que son bonheur fut absolu. p.31 -32
- Maman ferait une grève de la faim, dit tout d’un coup Amina. Je fixai ma sœur et me demandai si mon père n’avait pas raison.
- Une grève de la faim pour vous ?
- Pour qu’elle en fasse une, il faut s’appeler Omar ou Mahmoud. (p. 42-43)
L’auteur s’attaque également à quelques pratiques religieuses telles que le mariage temporel et la répudiation qu’elle considère comme des pratiques venues d’ailleurs et ne faisant pas partie des traditions et de la culture algérienne.
- D’aucuns se félicitaient de l’introduction du mariage temporel et de ses bienfaits, en remerciant charitablement ses promoteurs dans notre pays et, bien sur, les chiites, ces Perses décidément plus civilisés que nous autres, rigides sunnites sans imaginations. (p.22)
Toute la maison attendait que l’imam réfutât le destin qui devait unir- de façon brève et éphémère- ma mère et Youssef Allouchi. (p.25)
La vie du couple Aziz et Nayla est présentée sous un aspect extravagant pour inciter le lecteur à rire mais aussi à prendre position vis-à-vis de cette pratique qui assure aux hommes le droit de répudier leurs femmes mais aussi de les reprendre
Le grotesque est un élément satirique qui tend à grossir une réalité mais la déformer également pour présenter sa dimension absurde.
L’auteur critique également la société algérienne représentée par les voisins qui n’apportent aucune aide aux filles d’Aziz au moment où elles en ont besoin.
Lorsque Samira est battue à mort par son père personne n’a répondu aux secours des filles.
- Mes cris réveillèrent mes sœurs. Les jumelles appelèrent à l’aide, s’époumonèrent, ameutèrent le quartier. En vain. Au dehors, les hommes pressaient le pas en ricanant. (…) Noria et Fouzia se précipitèrent dans la rue, implorèrent les voisins de prévenir la police, les pompiers ou l’hôpital. Les hommes continuaient de presser le pas.
- Pauvres créatures, pauvres orphelines.
- C’est ainsi qu’il faut purifier sa maison.
- Ça leur fera du bien, à ces femelles.
- Qu’Il nous protège du Malin. p.112-113
Elle va plus loin en comparant les algériens aux français, pour montrer l’hypocrisie des musulmans.
N’avaient-ils pas le cœur sur la main et la justice dans le sang, les descendants de Lalla Mariam, les héritiers du Massih. p.131 — 132
Pour évoquer l’état et le mal qui ont atteint le pays pendant les années quatre- vingt-dix, la satire sociale se base sur la moquerie et la raillerie.
« Les fragiles installations publiques. » p.26 « Les coupures d’eau nationales.» p.35
Comme le souligne aussi ce discours des voix indistinctes
Attendre la réparation du scanner et la ramener ici. Enfin, si d’ici là elle est encore de ce monde. Des points de suture et un pansement. Tout ce qu’on peut faire. hélas ! Pas de lit disponible. Même pas un oreiller. […]
Après la couture, la ramener à la maison. Puis attendre. Faire boire de l’eau sucrée. Aussi efficace que le sérum glucosé. Rincée la bouche avec de l’eau salée ; ça cicatrise bien les gencives, mieux que le sidi-saint fol…et oui, mes petites, il faudrait s’y faire, au système D. (p. l 17- 118)
Nous constatons aussi l’emploi des qualifiants et d’attributs qui marquent la violence de la satire et son sarcasme. Le père est présenté comme un oppresseur en lui attribuant les caractéristiques suivantes :
« Notre homme de loi », « les yeux d’un bourreau prêt à œuvrer. » p.48 ; « un homme qui n’a plus figure humaine. » p.74 ; « un lion ivre » p. 68
La mère et Khadidja n’échappent pas aux moqueries de la narratrice, elle surnomme la première « la voix de son maître » pour dévoiler sa soumission et la deuxième « la mère des croyants, la sainte » pour noter son attachement hypocrite à la religion. Une soumission qui se transformera en révolte extériorisée par la fuite avec le nouveau mari, et une croyance éphémère qui trépassera dès son exil en Grande Bretagne.
Ravisseur se compose de paroles échangées qui permettent aux personnages féminins de dire directement leur point de vue sur des sujet relevant de la religion (le voile, la pratique de la répudiation) et des traditions les interdits, la claustration de la femme). La parole féminine se fait entendre par le biais des dialogues insérés qui sont adressés au lecteur pour l’informer des conditions de vie douloureuse et difficiles des femmes.
Ces échanges dialogués contiennent une dimension dynamique et vitale, qui contribue à nourrir la trame narrative du roman et sont reproduits en discours direct qui devient majoritaire. L’auteur oriente les dialogues des personnages par un encadrement dialogal implicite qui s’efforce de manipuler l’arrière fond idéologique des lecteurs puisque le dialogue constitue un « instrument perfectionné de persuasion 13» et la multiplicité des voix, détruit l’idée d’une seule idéologie..
L’enjeu du dialogue est explicité au niveau de l’interaction entre les interlocuteurs fictifs du dialogue et l’interaction entre les figures implicites de l’auteur et le lecteur.Ces dialogues font montre de la résistance des femmes
Pour l’auteur, l’origine de la tragédie est la lecture erronée des Textes, l’obscurantisme et l’ignorance. Son roman s’édifie contre l’obscurantisme. L’exemple d’Allouchi en est l’exemple de l’intellectuel qui d’une part subit la menace des intégristes (des balles sifflaient et Khadidja dans son intervention sous-entend qu’il s’agit d’un acte terroriste) et d’autre part la répression de l’état (Allouchi a failli avoir des problèmes à cause d’une pièce de théâtre qu’il écrivait dans le désert. L’histoire tournait autour des origines des séismes). Ce qui signifie l’absence de la liberté d’expression.
________________________
1 Ibid. p. 119 ↑
2 Chaulet Achour Christian. Noun : Algériennes dans l’écriture. 1998. p. 50 ↑
3 Burtscher-Bechter Beate et Mertz Baumgartner Birgit. Subversion du réel : Stratégies esthétiques dans la littérature algérienne contemporaine, études littéraires maghrébines n°16, Paris : L’Harmattan. 2001. ↑
4 Ibid. p. 199 ↑
5 Cité par Benaouda Lebdai dans son article « une littérature de combat ». ↑
6 Rémi Yacine. « Leïla Marouane : sans chaînes ni maître ». www.elwatan.com/Leila–Marouane-sans-chaines-ni-maître ↑
7 Par crainte des représailles, elle publie sous le nom de Leila Marouane au lieu de Leyla Mechentel ↑
8 Entretien avec la romancière réalisé par Ahmed Cheniki, le Quotidien d’Oran, le 18 novembre 2001. ↑
9 Bonn Charles. Paysages littéraires algériens des années 90 : Témoignages d’une tragédie, études littéraires magrébines n°14, L’Harmattan, Paris, 1999. p. 31. ↑
10 Entretien avec la romancière réalisé par Ahmed Cheniki, le Quotidien d’Oran, le 18 novembre 2001. ↑
11 Jolies André. Formes simples. 1936, chapitre 10, ↑
12 Meredith Georges, De l’idée de la comédie et des exemples de l’expression comique, p. 99, cité par Schoentjes Pierre. Poétique de l’ironie. Seuil, 2001, p. 219 ↑
13 Farreras Jacqueline. Les dialogues espagnols du XVIe siècle ou l’expression d’une nouvelle conscience. AtelierNational de reproduction des thèses. Paris : Didier édition. 1985. p. 87 ↑