La contribution des IDE au capital humain en Algérie est limitée par des défis structurels tels que la fuite des cerveaux et la baisse des inscriptions dans les filières scientifiques. Cet article propose des recommandations pour renforcer l’attractivité du pays en s’inspirant de modèles internationaux.
La contribution des IDE au développement du capital humain entre 1990-2010
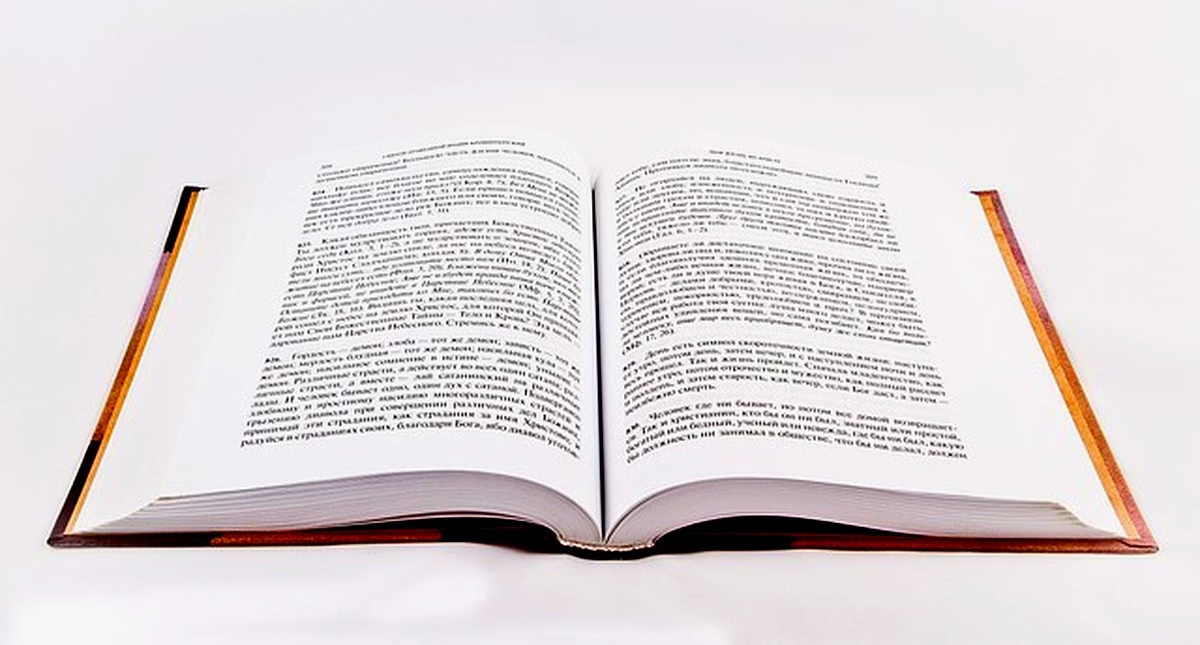
L’Algérie connait autant de problèmes : fuite des cerveaux, la baisse de nombre d’étudiants inscrits dans les filières scientifiques et technologiques dans les universités nationales (en baissant de 65%(fin 1990) à 35% en 2011), la faiblesse de pouvoir d’achat, des salaires très bas, un niveau de vie très bas, du chômage(Rebah.A, 2011).
Mais pour y remédier, les pouvoirs publics, depuis les années 2000, ont entrepris une batterie de reformes, dans le but de développement de l’emploi et de lutte contre le chômage, entre autres la promotion d’une main d’œuvre qualifiée et l’esprit de l’entreprenariat. Ainsi, l’Algérie avait ratifié de nombreuses conventions internationales (UE, bureau international du travail..) et instauré des organismes de suivi et de prospectives, entre autres la considération croissante de l’importance du capital étranger dans le développement national.
Figure 17 : variation des flux d’IDE et les trois composantes de l’IDH en Algérie (1990-2012)
387IMF, « Algeria selected issues », country report no.14/342, 2014, p 23 et 34.
[img_1]
Source : Rapport mondial du Programme d.es nations unies pour le développement humain(PNUD), 2013, p51
Comme le montre la figure 17 ci-dessus, qui porte sur tant les variations annuelles des flux d’IDE que les trois composantes de l’IDH en Algérie ( l’âge prévu et le niveau de vie et de scolarisation), les variations des flux d’IDE entrants sont étroitement liées aux variations produites dans les trois composantes d’IDH en Algérie.
Ainsi, étant donné que les investisseurs étrangers se sont dirigés vers les secteurs de BTPH, et autres secteurs secondaires (distribution, etc.), il serait possible de dire que les investissements contribueraient au développement des infrastructures de base(notamment dans le cadre des plans de relance de la croissance (2001-2014)), et créent des emplois dans le secteur manufacturier, deux aspects fondamentaux pour le bien être et le confort des citoyens.
Reste qu’ une meilleure répartition des IDE entre les trois secteurs (primaire, secondaire et tertiaire) permettrait de renforcer l’impact positif des entrées d’IDE et d’accélérer la réduction de la pauvreté1, et la lutte contre les inégalités des revenus.
IDE et implications sociales, environnementales et spatiales
Pour pouvoir savoir, si les IDE contribuent ou non, à la préservation de l’environnement en Algérie, un bref rappel historique, nous semble en effet plus qu’indispensable. Dans la période postindépendance, en ayant opté sur un modèle de développement2, basé essentiellement sur l’exploitation des ressources énergétiques et minières, l’Algérie n’aurait fait que prolonger le modèle colonial, marqué par le gaspillage des ressources, l’urbanisation croissante, la surexploitation des ressources et des zones côtières et des pollutions diverses.
Comme conséquence : une vraie crise écologique et environnementale, a été observée, accompagnée d’effets négatifs divers et, en particulier socio-économiques.
En effet, même si sans efficacité aurait été leur impact, les efforts des pouvoirs publics au niveau interne, pour réduire leurs implications le plus souvent nocifs sur l’environnement, néanmoins, avec l’arrivée des FMN qui, se conformant aux normes internationales et tenant à leur renommée mondiale, l’Algérie a ratifié de nombreuses conventions liés à la préservation et la protection de l’environnement3. Ceci étant, certaines FMN(British Pertroleum(BP), Djezzy..) auraient contribué à des actions de développement durable et mis à contribution leurs moyens et compétences, au profit de la population et la protection de l’environnement.
Ainsi, la SONATRACH, pour ne citer que celle là, a réalisé avec le géant anglais British Petroleum, un projet de 100M$ pour réduire d’un million de tonnes les émissions des gaz à effet de serre, en plus d’autres projets qui visent la réduction de torchage de gaz lié à la production pétrolière à moins de 7%(220M$, à partir de 2007).
En outre, bien que les entreprises pétrolières soient essentiellement installées au sud de pays où les besoins des populations locales se font sentir, un programme social a été mis en place conjointement entre le ministre des énergies et des mines et les compagnies étrangères. Beaucoup de domaines prioritaires dans l’investissement social sont lancés : l’aménagement d’infrastructures pour la communauté, l’éducation, la culture.4 Une bibliothèque multimédia, l’équipement des écoles en réseau Internet, différents aides dans les équipements des hôpitaux et toutes les aides à la population lors des inondations du 10/11/2001, sont autant d’exemples d’investissement social en Algérie.
Il importe cependant de garder présent à l’esprit, que les investisseurs étrangers ont aussi leurs part dans les inégalités régionales comme sociales et ce, en se concentrant notamment dans un nombre réduit de Wilayas. Comme causes, la disponibilité des ressources, de foncier et densité démographique. Ainsi, selon les statistiques de l’ANDI(2007), les projets d’investissements se localisent le plus souvent aux Centre et le Sud, et à degré moindre l’Est et l’Ouest. De son coté, A. BENACHENHOU, en traitant les forces et les faiblesses des IDE, il conclut qu’ils n’ont pas produit suffisant : des secteurs restent ignorés, des régions sont délaissés, l’intégration économique locale est faible et le réinvestissement des profits n’est significatif.5 A titre d’illustration, les IDE de l’agroalimentaire s’installent surtout dans le centre de pays, qui est le marché de consommation le plus important puisque plus de 50% de revenu national y sont dépensés.6 A l’Est, le groupe Orascom s’engage en Ciment en y ayant délibérément installé pour servir un marché régional très dynamique, et récemment, le complexe sidérurgique de Bellara(Jijel), qui sera réalisé pour un montant de 2Mds$, résultat d’un partenariat entre le groupe algérien Sider, qui détiendra 51% des parts et son homologue qatari, Qatar Steel (49%)7, nommé Algerian Qatari Solb(AQS).
A l’Ouest aussi, pour ne citer que l’investissement récent de Renault, entre autres. Mais quel puisse en être l’impact de cette dynamique régional, la cause serait la fragilité des politiques de développement locales, en particulier, celle lié à la répartition inégale des acteurs de développement dans les quatre coins de l’Algérie.
Autres effets des IDE entrants en Algérie
D’autres effets des IDE entrants, éventuellement, en Algérie, et non des moindres mériteraient par ailleurs mention à savoir: l’impact sur le fonctionnement des marchés en termes de disponibilité, de qualité et prix des produits et services (cas de la concurrence dans la téléphonie mobiles, le marché de ciment et le secteur bancaire par l’amélioration de taux de bancarisation et la maitrise de la marge bancaire) et le renforcement de la transparence(le développement du marchés hypothécaire dans le financement des entreprises et la présence en Algérie des sociétés appartenant à des groupes internationaux dont les comptes sont, par définition, surveillés internationalement est un plus pour la bonne gouvernance d’entreprises, en sus la présence des banques étrangers et cabinets d’audit et de conseil en Algérie serait un facteur non négligeable de transparence).8
Conclusion
L’Algérie semble présenter une triple spécialisation en ce qui concerne les IDE reçus : une spécialisation des secteurs attractifs (notamment énergie et mines), une spécialisation de type d’investissements (filiales commerciales, partenariats) et enfin une spécialisation de types de sociétés (de grandes taille en hydrocarbures et d’autres commerciales)
Par ailleurs, en dépit de la diversification longtemps prônée et les incitations et codes d’investissements plus soucieux d’attractivité, force est, cependant, de constater que les IDE reçus n’ont pas crée la diversification attendue. En effet, d’après l’analyse faite et si nombreuses sont les observations, les effets des IDE sur l’économie et le développement national sont peu perceptibles et inefficaces.
Ainsi, les données chiffrées font apparaitre plutôt que l’apport des IDE demeure faible quantitativement et moins efficace qualitativement et la croissance de nouveaux secteurs productifs est relativement faible. Ce dernier constat pourrait être attesté par la structure sectorielle des IDE entrants (non diversifié), faibles en potentiel d’entrainements. Qui plus est, l’appréciation quantitative exacte de l’impact des IDE demeure insuffisante du fait de point croissant des hydrocarbures dans l’économie.
Mais, s’il est difficile de quantifier l’impact réel des IDE sur la base de quelques données chiffrés sur les différentes périodes d’étude, l’Algérie semble toutefois enregistrer des retombées, même si disproportionnées et minimes, relativement positives à la fois en termes de transfert de technologies et la création de richesses et d’emploi.
Plus encore, quelque soit la lecture que nous puissions faire des données statistiques, il n’en demeure pas moins que l’Algérie intéresserait surtout par ces richesses naturelles et les IDE y sont spécifiques au secteur des hydrocarbures (sans de véritables effets de report et sans lien direct ni évident avec la croissance du pays).
En clair, il convient d’avancer que la part desIDE dans le PIB d’un pays ne constituerait pas l’élément important à considérer, ce qui est déterminant du point de vue de l’impact sur l’économie serait la qualité de l’IDE, à savoir le secteur concerné, les partenariats et les conditions de transferts de connaissance et de technologies prévus.
C’est l’interrogation à laquelle nous ne saurons, cependant, apporter des éléments de réponse, sans une étude approfondie. A cet effet, pour vérifier cet état de fait, nous nous livrerons dans le chapitre suivant à l’analyse de l’impact potentiel des IDE sur la croissance économique ainsi que les variables (sur et/ou à travers) lesquelles les IDE pourraient influencer, ou non, cette dernière et partant l’économie nationale de façon globale et ce, en nous appuyant sur un des modèles de la théorie de la croissance endogène.
________________________
1 Kolster.J, ‘L’IDE améliore-t-il le bien être des citoyens dans l’Afrique du nord ? », BAD, document de travail, 2015, P30. (www.afdb.org) ↑
2 Pour n’évoquer que la politique des « industries industrialisantes » adoptée, et se caractérisant par des modèles techniques fortement budgétivores et énergétivores. ↑
3 A titre d’exemples la ratification de la convention-cadre sur les changements climatiques, signée en juin 1992, qui s’est concrétisé par l’élaboration de plan national de lutte contre le gaz à effet de serre et la création de l’agence nationale des changements climatiques. De nombreuses mesures à prendre, ont été énoncées et, en particulier dans les secteurs vulnérables pour réalisés les actions : agriculture, eau, énergies et industrie. ↑
4 BOUALEM.F, “un état de responsabilité sociale des entreprises mondialisés et politiques publiques en Algérie », Université de Montpellier, 2008, P12. ↑
5 BENACHENHOU.A « les entrepreneurs algériens », éd. Alpha Design, 2007, P18. ↑
6 BENACHENHOU.A, 2006, P231. ↑
7 Le ministre de l’industrie et des mines sur la chaine de radio internationale (26/02/2015). ↑
8 BENACHENHOU.A, 2006, idem, P208-214. ↑