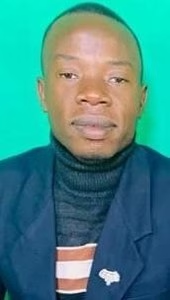La théorie d’expédition d’affaires courantes est essentielle pour comprendre la continuité des services publics, notamment en cas de démission d’une autorité administrative. Cet article explore ses fondements et principes, soulignant son importance dans le cadre juridique et administratif.
Chapitre I. GENERALITE SUR LA THEORIE D’EXPEDITION D’AFFAIRES COURANTES
Section 1 :
FONDEMENT DE LA THEORIE D’EXPEDITION D’AFFAIRES COURANTES
L’expédition des affaires courantes peut naître à la suite d’une démission (§1) et se justifie par le principe de continuité de l’État ou de continuité des services publics (§2).
§1. La démission
La désinvestiture intervient lorsqu’un acte ou un texte met fin à la fonction d’une autorité administrative qui était investie. Elle se concrétise soit par l’annonce officielle ou la passation de pouvoirs et par conséquent entraîne sa désinvestiture1. Ceci dit, la démission est l’acte par lequel on renonce à une fonction ou un mandat2.
Par ailleurs, pour Antoine MAZEAUD, la démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié, qui suppose une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin au contrat du travail3. Il découle de cette définition que tout salarié sous un contrat à durée indéterminée a le droit de démissionner de son poste de travail.
Cependant, cela doit se faire en respectant certaines conditions, notamment le préavis de démission. En cas de non-respect, le salarié risque de se rendre coupable de démission abusive. Tels que, une démission accompagnée de tentatives de débauchage de collègue ; un salarié passe au service d’une société concurrente à l’insu de son employeur et avant sa démission pour prospecter la même clientèle sur le même secteur.
Ce qui dans ce cas d’espèce pourrait pousser l’employeur à réclamer des dommages et intérêts au salarié4.
En Droit du travail, la démission s’agit donc de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Ainsi, la démission constitue avant tout l’expression d’un droit : celui de pouvoir résilier unilatéralement le contrat de travail. C’est pourquoi l’article 61 du Code du travail congolais dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou travailleur »5. Cependant, le législateur social congolais ne parle nulle part de la démission dans le Code du travail. Pour se faire, on se réfère au droit du travail français où la volonté du salarié doit être claire, certaine et non équivoque.
Ainsi, ayant été conclue dans toute volonté, la démission ne peut être rétractée par le salarié qu’en présence d’un vice du consentement. Ainsi, la Cour de cassation française souligne que dans le cas où la démission découle d’une volonté claire et non équivoque, elle est définitive. Et par conséquent, la rétractation du salarié est sans effet6. Par ailleurs, une démission donnée à l’issue d’une entrevue avec l’employeur au cours de laquelle des reproches avaient été fait au salarié sur la qualité de son travail suivi dès le lendemain d’une rétractation rend équivoque la volonté de démissionner7.
Notons également que la volonté de démissionner ne se présume pas. À ce point de vu, la non-reprise du travail par un salarié à l’expiration de ses congés payés, suivie de trois lettres adressées à l’employeur pour solliciter le bénéfice d’un licenciement économique, évoquant un engagement antérieur de ce dernier, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Ainsi, est sans effet l’imputation au salarié l’initiative de la rupture du contrat ou de sa démission suite à ses absences8. Par ailleurs, pour ce qui est de la destination de la lettre de démission, contrairement à la fonction publique et la fonction politique, en droit du travail, il n’existe aucun destinataire privilégié de la démission.
Elle produit tous ses effets, qu’elle soit remise au chef de service, au directeur du personnel ou à l’employé qualifié pour recevoir les arrêts de travail ou encore au supérieur hiérarchique, peu important que le destinataire ait ou non reçu délégation de pouvoir du chef d’entreprise9.
Il est impérieux de noter que la démission peut être d’office, volontaire et en blanc (I).Cela étant, nous pouvons analyser les effets de la démission (II).
Démission d’office, volontaire et en blanc
- Démission d’office
La démission d’office est une démission forcée dans les cas définis par les textes juridiques en vigueur10. C’est le cas de la démission découlant d’une motion de censure contre le Gouvernement ou le Collège exécutif puis que le Gouvernement ou le Collège désavoué par l’organe délibérant est non seulement réputé démissionnaire, mais aussi forcé à présenter sa démission dans les quarante-huit heures après le dépôt de la motion. C’est ce qui découle de l’article 147 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, qui dispose in fine:
« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire »11. C’est également le cas, dans l’Administration publique où la démission d’office est une cause de cessation définitive de service, qui est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ainsi, la loi impose deux conditions d’ordre public pour que la démission d’office soit valable : Sa procédure doit être écrite et contradictoire en ce sens que l’agent incriminé doit être notifié au préalable des faits qui lui sont reprochés12.
Démission volontaire
À l’opposé de la démission d’office, la démission volontaire advient motu proprio ou à la demande expresse de l’agent. La loi dispose que cette volonté doit être non équivoque et inconditionnelle. En outre, elle doit être acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par son délégué13. Toutefois, dans l’intérêt du service, la démission peut être retardée et l’agent est tenu de continuer ses services jusqu’à l’acceptation expresse de sa démission14.
Par ailleurs, pour le cas du Président de la République démocratique du Congo, lorsqu’il démissionne, il revient à la Cour constitutionnelle de déclarer toute vacance de la présidence. Et c’est bien d’elle de recevoir sa démission volontaire même si cela n’est pas clairement précisé par la Constitution, c’est ce qui découle de son article 76, al.1er : « La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement »15.
Démission en blanc
La démission en blanc c’est une démission présentée sous forme d’une lettre signée, mais non datée, remise à ses électeurs par le candidat à une élection, à titre de garantie de la fidèle exécution de ses engagements. Ainsi, il appartient aux électeurs de le soulever en cas de non- respect des engagements du candidat lorsqu’il sera aux affaires. Ainsi, en l’opposant cette démission préalablement établie par le candidat lui-même, il est réputé démission16. En RDC, cette pratique est prohibée, car contraire au principe de l’interdiction du mandat impératif17.
Effets de la démission
L’agent qui a déposé sa démission auprès de l’autorité habilitée qui l’accepte, cesse d’exercer ses fonctions. Il est désinvesti et perd, en principe, le pouvoir qu’il détenait, car le pouvoir d’une autorité administrative cesse avec sa désinvestiture. À cet effet, l’autorité démissionnaire, après sa démission, s’il agissait comme en temps normal, ses actes seront censurés pour incompétence ratione temporis car ne pouvait plus encore exercer sa compétence. C’est ce qu’affirme Félix VUNDUAWE que la compétence de l’autorité administrative s’exerce à l’intérieur d’une limite de temps c’est-à-dire de son investiture, son entrée en fonction, à sa désinvestiture18.
Toutefois, une exception à cette incompétence temporaire ou ratione temporis de l’autorité démissionnaire résulte de la nécessité d’expédier les affaires courantes, ou de satisfaire aux exigences de la continuité de service public19. À ce point de vu, l’autorité démissionnaire continue à gérer les activités journalières de sa juridiction.
En fin de compte, l’incompétence ratione temporis de l’auteur d’un acte pris en période d’expédition d’affaires courantes et la violation du principe général de droit selon lequel la compétence de l’exécutif est limitée aux affaires courantes en cas de la démission du Gouvernement, peut être soulevée devant le juge compétent20.
________________________
1 BOTAKILE BATANGA, Précis du contentieux administratif congolais, tome 2, 1ère éd., Bruxelles, Academia, 2017, p.129. ↑
2 S. GUINCHARD et T. DEBARD., Lexique -des-termes juridiques, 25 ème Ed. 2017-2018, p.379. ↑
3 A. MAZEAUD, Droit du travail, Paris, LGDJ-Montchrestien, 4e éd., 2004, p. 380. ↑
4 Ibid. ↑
5 Art.6, Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que modifiée à ce jour, in J.O.RDC, 43e Année, Numéro spécial, 25 octobre 2002. ↑
6 Cass., chambre sociale, 19 mars 1981, pp. 78-40. ↑
7 Cass., chambre sociale, Affaire Lamy, 10 juillet 2013, p. 19. ↑
8 Idem, p.25. ↑
9 Cass. , Chambre sociale, 20 juillet 1967, no 66 40.455, Bull. civ. V, no 597. ↑
10 S. GUINCHARD et T. DEBARD., Op.cit., p.379. ↑
11 Art. 147, Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, in J.O. RDC, 52e année, Kinshasa, n° spécial, février 2011, p.50. ↑
12 Art. 65 et art. 77, point 3, Loi n° 16/ 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, in J.O.RDC, première partie, 57 ème année, numéro spécial, 3 août 2016, p.28. ↑
13 Art.79, Loi n° 16/ 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, in J.O.RDC, première partie, 57 ème année, numéro spécial, 3 août 2016, p.29. ↑
14 Ibid. ↑
15 Art. 76, al.1er, Constitution du 18 février 2006, Op.cit., p. 29. ↑
16 S. GUINCHARD et T. DEBARD., Lexique -des-termes juridiques, 25 ème éd. 2017-2018, p.379. ↑
17 Art. 101, al.5, Constitution du 18 février 2006, Op.cit., p.35. ↑
18 F. VUNDUAWE te PEMAKO, Op.cit., pp.682-683. ↑
19 Ibid. ↑
20 Ibid. ↑