Les stratégies de mise en œuvre révèlent que la présence d’enseignantes et la qualité pédagogique influencent significativement la performance scolaire des filles en Côte d’Ivoire. Ces résultats, basés sur des données officielles, soulignent des leviers essentiels pour améliorer l’éducation féminine dans le pays.
- Théorie de « l’effet- maître »
Du point de vue théorique, les performances des élèves varient d’un enseignant à l’autre ou d’un groupe d’enseignants à l’autre. Ces différences de performance semblent s’expliquer par la différence des niveaux de la qualification de l’enseignant, la méthode pédagogique appliquée et ses expériences. La qualification de l’enseignant réfère à sa formation académique tant au niveau disciplinaire qu’au niveau pédagogique.
En effet, Bressoux (2006) fait une classification des enseignants en deux catégories. Les enseignants efficaces et peu efficaces. Selon l’auteur, les enseignants peu efficaces, négligent les élèves faibles et ces derniers sont souvent l’objet de critique. Au lieu d’aider les élèves en difficulté d’apprentissage, les enseignants peu efficaces préfèrent diminuer le contenu du programme et s’en tenir uniquement aux éléments simples. Ils n’incitent pas ces catégories d’élèves aux exercices de réflexion.
Bressoux (2006) a fait remarquer que le jugement des maîtres joue aussi un grand rôle dans la performance scolaire, surtout chez les filles. Lorsqu’un enseignant développe des stéréotypes sexués à l’endroit des élèves, la progression de ces derniers peut être affectée très fortement.
En revanche, les chercheurs s’aperçoivent que les enseignants les plus efficaces sont ceux qui ont reçu une formation adéquate et qui ont une certaine expérience. Ils sont munis de matériels didactiques. Ils préparent leurs cours et planifient les apprentissages en fonction du temps qui leur a été imparti.
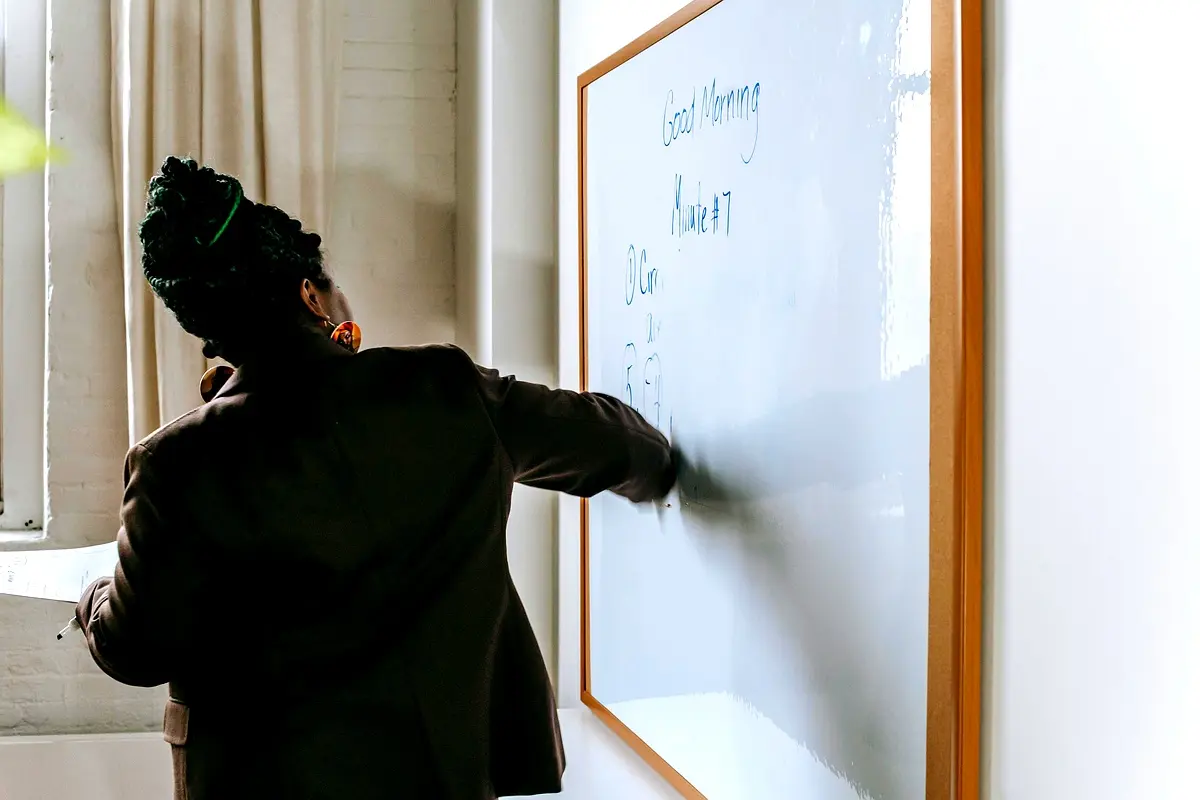
Ils organisent des travaux individuels, des discussions en classe, des travaux de groupe, des séances de questions/réponses, fournissent des explications, et accordent un encadrement spécial aux élèves présentant des difficultés d’apprentissage (Rajohnson, 2006 ; Duru-Bellat, 2003, Robin, 2009).
Les enseignants efficaces donnent régulièrement des devoirs de maison aux élèves et qu’ils corrigent en classe. Ils voient toujours les contenus des programmes pédagogiques prévus. Ils organisent de petites évaluations formatives de manière périodique afin de pouvoir ajuster les apprentissages.
Les enseignants efficaces ne croient pas que les garçons sont plus doués pour les disciplines scientifiques et techniques ni les filles pour les matières littéraires.
S’il est révélé que dans de nombreux systèmes éducatifs, les garçons excellent mieux en mathématiques que les filles, c’est souvent parce que les maîtres exposent davantage les garçons aux notions exigeant des réponses conceptuelles plutôt que des restitutions de savoirs souvent exigées des filles.
Les garçons sont plus souvent félicités pour leurs performances et réprimandés pour leur comportement, alors que les filles sont le plus souvent félicitées pour la qualité de la présentation de leurs écrits ou leur comportement.
Cette différenciation pédagogique crée la confiance chez les garçons et réduit celle des filles qui acceptent au départ qu’elles ne sont pas douées pour les activités hautement intellectuelles ou qu’elles ne peuvent pas réussir au même titre que les garçons (Bressoux, 2006 ; Robin, 2009).
En outre, il a été démontré que les maîtres performants sont ceux qui valorisent leurs élèves par la parole, des sourires et des regards. Ils sont patients avec les élèves qui ne comprennent pas et ils ne les qualifient pas de « mauvais ».
Les enseignants efficaces ont une meilleure pratique pédagogique et un niveau d’attentes plus élevé vis-à-vis des élèves, ce qui influe positivement sur les résultats (Lautier, 2008).
- Théorie de « l’effet -classe »
La théorie de l’effet-classe explique la performance scolaire par la composition sociale de la classe. Cette théorie, construite à partir des travaux de Hanushek (1971), cherche à analyser les différences de performances entre des classes d’une même école. Hanushek (1971) a observé que les résultats des élèves dépendaient de la classe à laquelle ils appartiennent.
Veldman et brophy (1974) arrivent à la conclusion qu’une classe qui est composée uniquement d’enfants issus des familles aisées, garantit un niveau de performance plus élevé. En revanche une classe composée en majorité d’enfants défavorisés, accuse un taux de réussite plus faible.
Néanmoins, cette théorie suggère qu’une classe mixte profite mieux aux enfants défavorisés sans pour autant nuire aux enfants des familles plus aisées.
D’autres courants théoriques ont cherché à déterminer les effets de constitution de groupes d’élèves par niveau ou par groupe homogène tant du point vu scolaire qu’au niveau social (Robin, 2009 ; Kerckoff, 1986). Il s’ensuit que les performances sont d’autant meilleures que le niveau scolaire initial de la classe est élevé.
Les classes où les groupes sont homogènes, augmentent les écarts de performance entre les élèves. Les élèves doués qui sont regroupés dans des groupes homogènes progressent plus que s’ils étaient scolarisés dans un contexte hétérogène.
Mingat (1984) a fait remarquer qu’en France les résultats sont meilleurs pour les classes hétérogènes. L’effet bénéfique de l’hétérogénéité étant plus marqué pour les élèves de niveau inférieur à la moyenne alors qu’un contexte hétérogène s’avère nuisible aux élèves ayant un niveau très supérieur à la moyenne de la classe.
Par contre, Duru-Bellat et Mingat (1997) ont fait ressortir que les pertes des forts évoluant dans une situation d’hétérogénéité semblent moins importantes que les gains des plus faibles. Les effets divergents, générateurs de plus d’inégalité, d’un mode de groupement par niveau, sont plus marqués dans l’enseignement secondaire.
- Théorie de l’agence
Développée par Jensen et Meckling (1976), la théorie d’agence expose le problème d’asymétrie informationnelle confrontée par l’entreprise évoluant sur la base des contrats passés entre les différentes parties prenantes (actionnaires, créanciers, dirigeants, etc.).
La préoccupation fondamentale consiste à expliquer comment maximiser les intérêts de chacun dans ce contexte contractuel ? Ainsi, les dirigeants, ont l’obligation de gérer l’entreprise conformément aux intérêts du principal, les actionnaires.
Cependant, sous l’effet de leur opportunisme, dû au problème d’asymétrie d’information, ils peuvent s’engager de préférence dans des actions qui maximisent leurs propres intérêts au détriment du principal.
En effet, Niskanen (1971) a montré que les employés d’une bureaucratie ne cherchent pas à maximiser l’utilité que les usagers pourraient tirer des biens publics (problème principal- Agent).
Or, le principal (l’Etat ou les parents) confie aux chefs d’établissements scolaires la mission de maximiser ses intérêts qui sont de transmettre une éducation de qualité aux élèves et leur permettre d’avoir leur diplôme en consommant le nombre d’années-élève qui réponde aux normes du cycle d’études en question (Scheerens, 2000).
En gardant à l’esprit que des programmes de renforcement de l’autonomie des écoles ont été envisagés pour permettre d’améliorer la performance des écoles, le problème du principal agent va intervenir pour atténuer le niveau de performance attendu.
Selon la théorie d’agence, le principal (l’État, la famille ou la communauté) est confronté à deux problèmes avec son agent (le chef d’établissement ou l’enseignant).
Le principal peut être victime de l’aléa moral du chef d’établissement qui peut ne pas faire une bonne allocation des ressources pour pouvoir maximiser les outputs dans le cas d’une école publique.
Mais dans le cas d’une école privée, le directeur peut être intéressé uniquement par la recherche du profit maximum, sans se soucier trop de la réussite des élèves ni de la qualité de l’enseignement dispensé.
Le chef d’établissement peut aussi s’intéresser uniquement aux élèves présentant une grande capacité d’apprentissage, alors que le principal souhaiterait qu’il fasse acquérir un certain niveau de compétence à tous les élèves quel que soit leur niveau à l’entrée.
Dans les mécanismes de recrutement, le chef d’établissement peut s’arranger aussi pour sélectionner uniquement les élèves issus des milieux sociaux aisés ayant une culture déjà favorable au système d’apprentissage, alors que le principal peut vouloir chercher l’équité dans l’accès et dans la qualité.
L’agent peut dans ce cas consacrer très peu d’effort à atteindre l’objectif du Principal (Duru-Bellat et Meuret, 2001 ; Johnes, 1993 ; Trannoy, 1999).
Questions Fréquemment Posées
Comment les enseignants influencent-ils la performance scolaire des filles en Côte d’Ivoire?
Les enseignants efficaces sont ceux qui ont reçu une formation adéquate, qui organisent des travaux individuels et de groupe, et qui valorisent leurs élèves, ce qui influe positivement sur les résultats scolaires.
Quelle est la théorie de l’effet-maître dans le contexte de l’éducation en Côte d’Ivoire?
La théorie de l’effet-maître explique que les performances des élèves varient d’un enseignant à l’autre en fonction de la qualification de l’enseignant, de la méthode pédagogique appliquée et de son expérience.
Quels facteurs affectent la performance scolaire des filles en Côte d’Ivoire?
Le nombre d’enseignantes, la proportion de filles dans les classes et certaines régions influencent positivement les résultats scolaires des filles.