L’analyse comparative de la socialisation révèle des dynamiques surprenantes dans l’éducation des adolescents en Haïti. En examinant les normes genrées au sein des établissements scolaires, cette recherche met en lumière des inégalités qui façonnent les rapports pédagogiques, avec des implications cruciales pour l’avenir éducatif.
Chapitre II- La socialisation comme processus d’intégration sociale de l’individu
Compte tenu de l’importance du concept de socialisation dans notre travail, nous consacrons ce chapitre à nombreux de ses théoriciens en mettant l’accent sur leurs différentes approches. De la socialisation primaire à la socialisation secondaire en passant par les différentes méthodes d’inculcation des normes sociales, nous passons en revue ce processus impératif dans la construction sociale de l’individu. Nous analysons l’articulation entre l’environnement et le processus d’assimilation chez l’enfant.
La part qui revient à l’école est apportée par les fondateurs.trices de la sociologie de l’éducation qui permettent d’approfondir le développement de l’enfant jusqu’à l’âge d’adolescence proprement dit qui concerne notre objet d’étude.
Construction sociale de l’individu
2.1- Normes et règles sociales
2.1.1- Moments clés du processus de socialisation
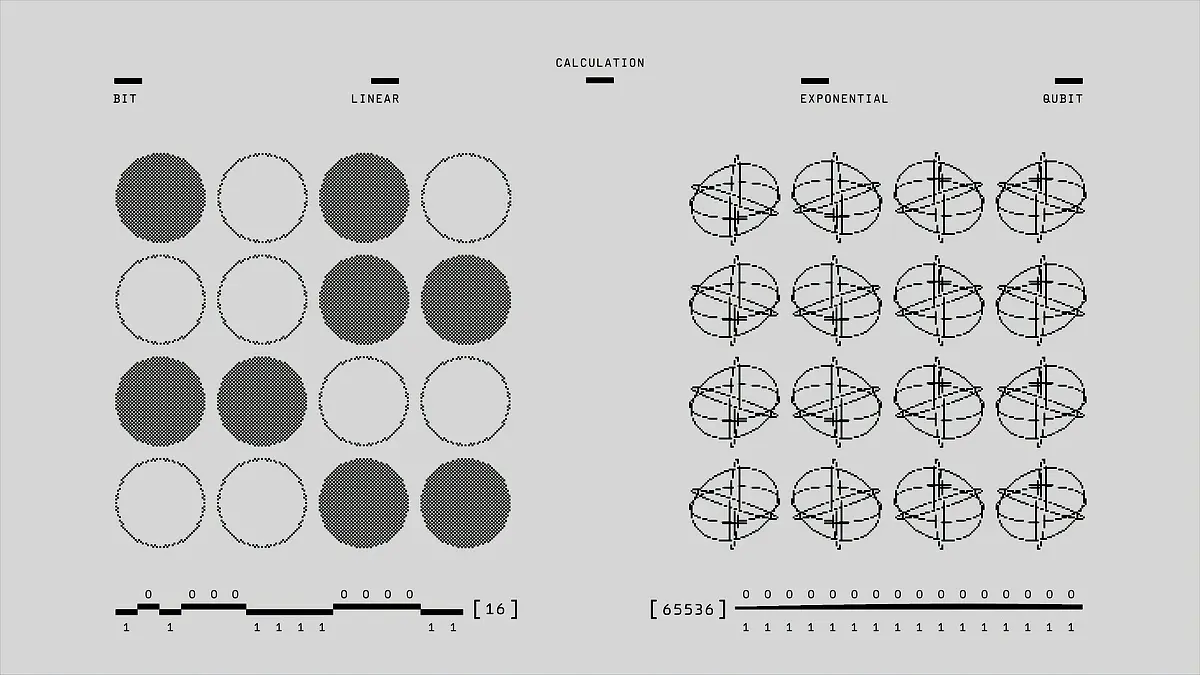
La socialisation est un processus qui débute à la naissance ; d’une manière plus précise à la tendre enfance et qui prend fin à la mort de l’individu. La socialisation peut être perçue également au niveau micro comme incorporation à une structure sociale donnée comme (Berger et Luckmann,1996). Peter Berger et Thomas Luckmann ont mis l’accent sur le processus cognitif de la socialisation chez l’enfant.
Pour eux, la socialisation consiste en l’intériorisation des normes sociales par l’apprentissage progressif, dès la petite enfance, d’un ensemble de significations ; la signification n’est autre que la représentation objective de la réalité. Ils avancent : « C’est seulement quand il aboutit à ce degré d’intériorisation que l’individu devient un membre de la société » (Berger, Luckmann, 1996 : 52).
Ils continuent pour dire que : « Le processus ontogénétique qui permet ce phénomène est la socialisation, qui peut être définie comme « l’installation consistante et étendue d’un individu à l’intérieur du monde objectif d’une société ou d’un secteur de celle-ci » (Berger, Luckmann, 1996 : 36).
L’approche de ces auteurs permet de comprendre la socialisation comme une étape obligatoire de la vie sociale. L’idée de contrainte qu’elle sous-tend prend forme dans l’interaction entre les individus supposés aptes à afficher des comportements compréhensibles entre eux.
Cette conception n’est pas éloignée de celle de Pierre Bourdieu, qui définit la socialisation comme :
« Un processus d’intériorisation par l’individu des manières de pensée propres à son groupe primaire » (Bourdieu, 1997). Elle produit un habitus, c’est-à-dire :
« Un ensemble de dispositions profondément incorporés, qui orienteront durablement les pratiques, les goûts, les choix, les aspirations des individus. Elle contribue ainsi à la reproduction sociale, d’autant qu’elle transmet d’une génération à l’autre, de manière active ou par imprégnation, un capital culturel (manières de parler, gouts, connaissances, etc.) à la fois très inégal suivant les groupes sociaux, et décisif pour la réussite scolaire- donc sociale- des individus » (Bourdieu, 2000 : 57).
Cette définition permet de cerner l’enjeu de la pérennisation des normes et règles sociales à travers la socialisation, via la reproduction sociale. Elle met l’accent sur l’importance des groupes primaires et des milieux sociaux différents dans la construction de l’identité sociale de l’individu ; aussi comment les choix, les goûts, les aptitudes apparemment naturelles peuvent être déterminés par des routines mentales inconscientes.
Mais, mises à part ces influences à cette étape spécifique de la vie de l’individu, impératif pour son intégration sociale, ces premiers échanges sont censés marquer l’individu, pendant toute sa vie, d’après Bourdieu ; donc si les valeurs connues dans l’enfance tendent à perdurer, quand est-ce que commence l’autonomisation particulièrement caractéristique du moment d’adolescence ?
Quand la socialisation secondaire débute t- elle vraiment ?
Peter Berger et Thomas Luckmann apportent une réponse assez intéressante à ce sujet en nous permettant d’établir les frontières propres à ces deux moments. Leur approche se rapproche en effet de celle de Bourdieu. Donc, nous pouvons également conclure que dans le processus de socialisation s’opère l’assimilation d’un corpus de valeurs.
Si la socialisation a une telle force dans le façonnage des individus ; les agents de la socialisation dont parle Durkheim sont assez déterminants dans la facilitation de cet apprentissage et le rendent réel.
Dès la tendre enfance, l’éducation fondamentale reçue dans la famille contribue à façonner l’enfant de telle sorte qu’il/elle assimile les règles de conduites que lui inculque celle-ci. En effet, il/elle se retrouve de fait, avec des parents qu’il n’a pas « choisis » et qui l’éduqueront suivant leur propre éducation.
Le processus de la socialisation primaire considérée comme très cruciale dans la vie de l’individu, est un processus imposé, responsable de son intégration progressive dans la société, propre à sa classe, à sa race et son genre. La socialisation primaire est alors considérée comme le foyer d’expression primaire du caractère.
2.1.2- Le caractère normatif de la socialisation
En effet, la socialisation représente à nos yeux un processus bien complexe qui permet de cerner comment les normes et valeurs sont inculquées à l’individu et reproduites par celui- ci ; avec une certaine autonomie certes, mais toujours sur les traces établies par les générations présentes et antérieures.
Tous les comportements individuels doivent être vus à travers cette grille, car c’est à travers un apprentissage social et continu que l’individu saisit son incorporation au corps social. C’est dans ce sens que le sociologue Guy Rocher avance :
« Les modèles culturels représentent ce caractère essentiel de n’être pas inscrits à la naissance dans l’organisme biologique de l’être humain ; ils ne sont pas transmis héréditairement d’une génération à l’autre. Chaque nouvelle génération doit apprendre les modèles de la société dans laquelle elle est appelée à vivre ».
À propos des modèles culturels, nous voyons avec lui qu’ils sont « un ensemble de valeurs et de normes qui déterminent les règles de conduites correspondant aux rôles des individus » (Bourdieu, 2000 : 57).
Donc, pour comprendre les comportements des adolescent.e.s, il faut considérer les apports des différents apprentissages opérés à plusieurs niveaux, notamment à l’école.
En effet, l’une des fonctions inhérentes à la socialisation est la production des normes et des valeurs. La valeur peut être définie comme « une manière d’être ou d’agir qu’une personne ou une collectivité reconnaissent comme idéale et qui rend désirables ou estimables les êtres ou les conduites auxquels elle est attribuée » (Guy Rocher, cité par Germain Julien, 1994 :5).
Le lien entre les valeurs et les modèles sociaux est très serré en ce sens que l’un donne sens à l’autre et vice versa. Pour comprendre les conduites des acteurs sociaux, il revient de considérer les valeurs auxquelles ils/elles adhèrent et le degré « d’attachement passionnel » qu’ils/elles y tendent.
Ce sont ces mêmes conduites imprégnées des valeurs qui définissent l’identité des acteurs, les différencient ou les rassemblent.
Donc, au cours de sa socialisation, s’opère simultanément cet apprentissage des valeurs attribuées aux modèles. Ces valeurs qui sont en même temps mobiles et inspiratrices d’actions représentent une certaine vision du monde ; donc les normes et les valeurs ne sont pas neutres ; les valeurs dominantes ont habituellement la voix au chapitre.
Comme toute société, la société haïtienne peut favoriser l’adhésion à certaines valeurs spécifiques comme le patriotisme, le respect des biens d’autrui, l’hospitalité, etc.
Ces valeurs peuvent être de divers ordres (religieux,) et se retrouvent à plusieurs niveaux dans diverses institutions et peuvent faire l’objet de plusieurs types/formes d’appropriation par les institutions et par les individus eux-mêmes.
À ce propos, Guy Rocher argue que les valeurs qui se retrouvent dans les institutions sont les mêmes qui se retrouvent « à l’intérieur des individus » (Rocher, 1924 : 6).
Aussi, dans cette même optique d’affirmation de non-discontinuité entre l’individu et la société, il montre que les institutions deviennent les principales courroies de transmission des valeurs et qui veillent au respect des normes sociales par l’entremise des sanctions, en grande partie.
Donc, cet idéal que représentent les valeurs sociales est rendu palpable pour l’individu à travers ses propres conduites et son désir de conformité aux normes sociales.
Les valeurs dominantes sont reproduites par les différentes structures sociales. Or, l’école est un pilier incontournable de la socialisation secondaire. Comment l’école facilite-elle l’adhésion aux valeurs et normes de genre ? Quelles sont les contributions des normes et valeurs véhiculées à la compréhension des rapports sociaux de sexe ?
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la socialisation selon Berger et Luckmann?
La socialisation consiste en l’intériorisation des normes sociales par l’apprentissage progressif, dès la petite enfance, d’un ensemble de significations.
Comment Pierre Bourdieu définit-il la socialisation?
Pierre Bourdieu définit la socialisation comme un processus d’intériorisation par l’individu des manières de pensée propres à son groupe primaire.
Quel est l’impact de la socialisation sur la réussite scolaire?
La socialisation contribue à la reproduction sociale, transmettant un capital culturel qui est décisif pour la réussite scolaire des individus.