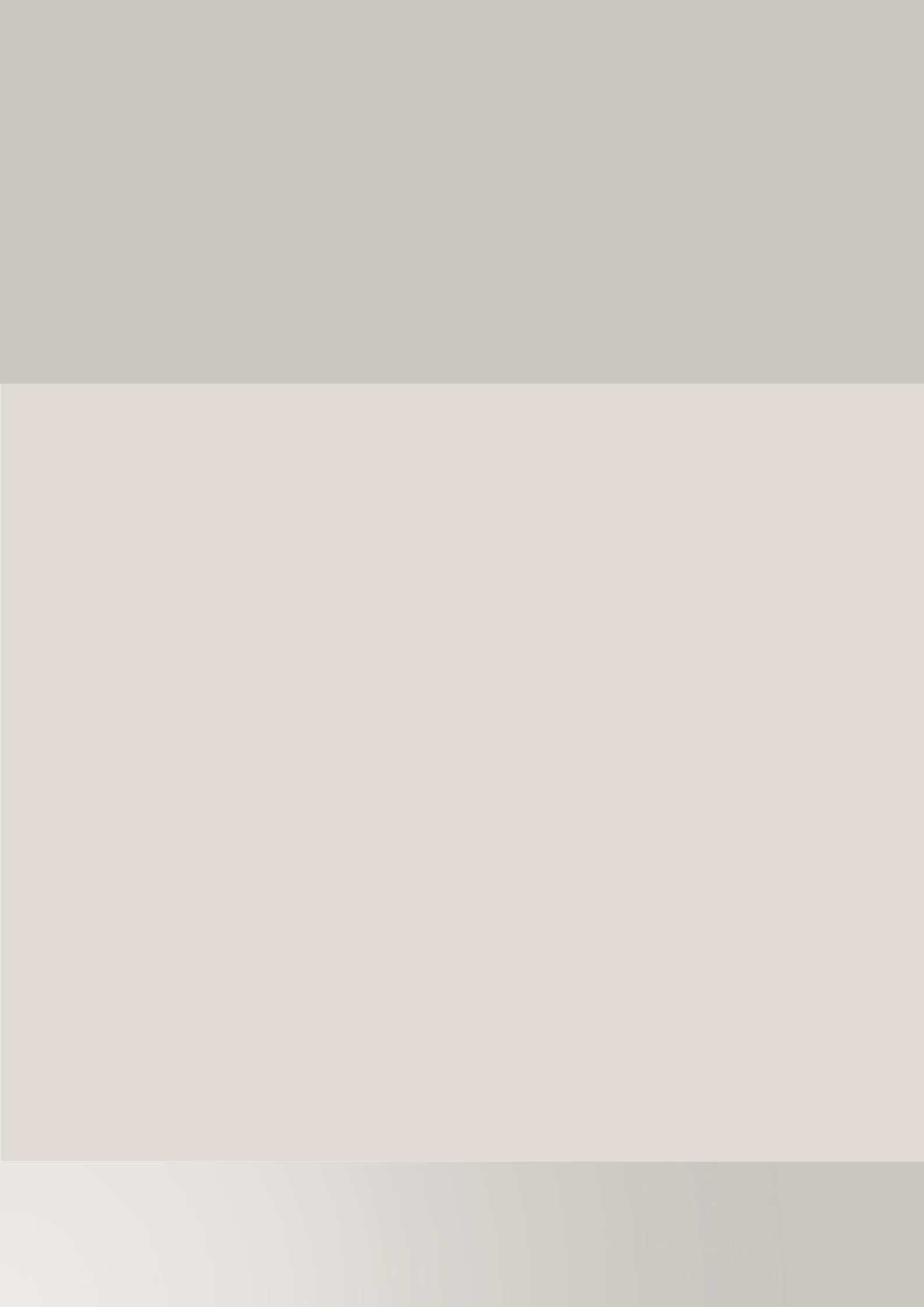Les risques environnementaux en entreprise nécessitent des mesures préventives et de protection pour atténuer leur impact. Cet article explore les stratégies d’un responsable QSE pour intégrer ces enjeux dans un système de management, tout en tenant compte des normes juridiques et de l’économie circulaire.
Section III :
Mesures des risques environnementaux

Le risque environnemental peut se matérialiser par une pollution de l’eau, de l’air ou encore des sols, des sous-sols ou des eaux souterraines du site lui-même.
Pour gérer ce type de risque, l’entreprise doit prendre différentes mesures :
Des mesures préventives : réduire la probabilité que le risque environnemental ne se réalise
- Analyse du cycle de vie
- Cartographie des risques
- Procédures SSE
Des mesures de protection : agir sur la gravité et l’impact du risque s’il survient
- Demande de classement ICPE
- Gestion des déchets
- Plan d’opération Interne
ANALYSE DU CYCLE DE VIE 55:
[10_img_1]
Source : ISO 14001 v2015
Selon l’ISO 14001 v2015 l’évaluation du cycle de vie est le processus utilisé pour mesurer l’incidence environnementale d’un produit à tout moment pour toute activité ou utilisation durant toute la durée de sa vie.
L’ACV est un outil d’aide à la décision, dont les résultats permettent de comparer les impacts environnementaux de deux solutions ou produits ; souvent utilisé en éco-conception.
Il comptabilise sous forme d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs les principales caractéristiques environnementales du produit.
En choisissant celui à faible impact, l’entreprise minimise donc le risque environnemental.
- BOITE A OUTILS SSE – OUTIL 23 – L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (Reproduction autorisée)
- [10_img_2]CARTOGRAPHIE DES RISQUES :
[10_img_3]56
57
- http://risquesenvironnementaux.oree.org/notre-methodologie//demarche-proposee.html
- BOITE A OUTILS SSE – OUTIL 24 – LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES (Reproduction autorisée)
La cartographie des risques permet de visualiser et de hiérarchiser les risques majeurs existants dans une entreprise, il est recommandé de l’utiliser sur le périmètre global SSE ; même si très utilisé pour la réalisation du document unique. (voir p 48 #RISQUESPRO)
Les actions de protection et de prévention doivent permettre de diminuer le risque à un niveau acceptable ; de comprendre les risques majeurs et d’agir significativement sur sa probabilité.
Il est très important de mobiliser les interlocuteurs grâce à une Direction impliquée, et des cotations comprises de tous.
PROCÉDURES SSE :
Avant d’aborder l’intérêt d’une procédure SSE, il convient de rappeler quelques définitions et nuances :
- Mode opératoire: Il correspond à la description détaillée des actions nécessaires à l’obtention d’un résultat, cad les actions à mener pour effectuer une tâche précise et à un poste donné. (le « comment faire? » d’un processus)
Il est souvent relié au document unique d’évaluation des risques, et il peut être revu en cas d’audit des autorités de régulation d’audit client.
- Processus: Pour reprendre la définition de l’EFMQ (European Foundation for Quality Management), le processus correspond aux « moyens à l’aide desquels l’organisation met en œuvre et déploie les compétences de son personnel pour produire des résultats ».
De manière plus globale, le processus désigne autant l’enchaînement des activités dans la chaîne de valeur de l’entreprise que les ressources (moyens humains et matériels) mises en œuvre pour les réaliser.
Il décrit visuellement l’ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie, qui répond à la question « quoi faire » ?
- Procédure : Document qui apporte des éléments de cadre, c’est-à-dire des marches à suivre pour resituer la ressource dans son contexte de travail. La procédure permet de règlementer la vie de la société.
C’est un ensemble de règles destinées à informer le salarié sur ce qu’il peut faire et ne pas faire.
La procédure décrit l’organisation, l’ensemble des règles propres à une activité. Elle décrit la méthode de travail, ainsi que les différents acteurs (opérateurs et services) appelés à réaliser les tâches, elle répond donc aussi à la question « qui fait quoi ? ».
Les normes ISO 45001 et ISO 14001 imposent l’écriture d’informations documentées jugées nécessaires pour le fonctionnement du système de management SSE d’une entreprise.
Le responsable RSE doit partager la rédaction des procédures avec les opérationnels, et le contenu de celles-ci doit être utile, cohérent, adapté et simple (pas de détails, réservés aux modes opératoires).
Une procédure SSE garantit la maîtrise des risques et l’atteinte des objectifs fixés, et permet la bonne marche de l’activité de l’entreprise, que ce soit en mode normal en mode dégradé ou en mode d’urgence.
DEMANDE DE CLASSEMENT ICPE :
La nomenclature ICPE décrit les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement tels que définis à l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
Les sites classés ICPE varient en termes de secteur d’activité, de taille et de type de risques encourus : il peut s’agir de tous sites industriels comme agricoles pouvant engendrer un risque pour l’environnement ou des nuisances pour les riverains.
L’objectif du dispositif d’autorisation ICPE vise essentiellement à la protection de l’environnement et de la santé, la prévention des pollutions, la préservation de la nature, la prévention des nuisances, la prévention des risques accidentels ; ou encore la conservation des sites et des monuments (art L.511.1).
La nomenclature ICPE distingue 3 régimes juridiques pour les installations ICPE 58
[10_img_4]
(avec une procédure propre à chacune) :
- le régime d’Autorisation (A)
- le régime d’Enregistrement (E)
- le régime de Déclaration (D)
Des seuils quantitatifs sont aussi associés à chaque rubrique : soit en termes de volumes stockés soit en termes de volumes transitant journalièrement dans l’installation.
Cette notion de seuils et de volumes est importante à plusieurs titres car certaines installations ICPE peuvent également être soumises à tout ou partie des obligations relatives à la directive Seveso (cas des établissements qui remplissent les critères « Seveso seuil haut » ou « Seveso seuil bas »)
Une entreprise doit déterminer si son installation est une ICPE et savoir quelles sont les différentes exigences associées (dossiers, études, analyses…), afin de répondre à la conformité légale concernant la gravité des risques de son activité ; et afin d’éviter des amendes très lourdes.
Il est recommandé de consulter la nomenclature en groupe de travail, afin de ne pas oublier une rubrique, et de consulter le classement sur le site dédié.
( http://www.ineris.fr/aida/ ).
La nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations.
GESTION DES DÉCHETS :
Gérer les déchets, c’est réduire les risques pour le personnel et pour l’environnement.
La gestion des déchets inclut le tri, le stockage, le transport, l’élimination et la traçabilité associée.
Elle induit aussi une réflexion et des actions concrètes pour leur réduction, auquelle l’ensemble des salarié(e)s doit être associé ; afin d’en comprendre les enjeux.
Chaque entreprise est responsable de l’élimination de ses déchets et doit s’assurer qu’elle est conforme à la réglementation (décret n°2011-828 du 11 Juillet 2011).
[10_img_5]
Des actions peuvent permettre de réaliser des économies importantes : 59
- réduction à la source de la quantité ou de la nocivité de déchets,
- réemploi, réutilisation des déchets dans l’activité,
- recyclage des déchets sur site,
- tri et valorisation des déchets.
Les déchets dangereux ne doivent pas être mélangés aux non dangereux, sinon l’ensemble serait assimilé dangereux, et le coût du traitement plus élevé
Comment respecter les obligations liées aux déchets :60
[10_img_6]
- https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/dossier/combien-coutent-dechets/calculer-cout-complet-dechets
- BOITE A OUTILS SSE – OUTIL 10 – LA GESTION DES DÉCHETS (Reproduction autorisée)
PLAN D’OPÉRATION INTERNE : 61
[10_img_7]
Le POI est un plan d’urgence, élaboré par l’exploitant, qui organise les moyens, équipements et méthodes d’intervention en cas de sinistre dans une installation. (Article R 512- 29 du Code de l’environnement.)
Il est obligatoire pour les installations à risques importants, mais peut être un véritable outil pour les autres entreprises, car il permet de se préparer en cas de crise.
En cas d’accident à l’intérieur d’un établissement, le POI permet de définir les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens déployés pour protéger le personnel, les populations et l’environnement ; et ainsi minimiser la gravité de l’impact.
C’est en s’appuyant sur une organisation de secours et d’urgence efficace, que l’on garantit l’efficacité de la sécurité.
Dans le cas où les effets d’un incident risquent de dépasser l’enceinte de l’établissement, il convient de prévenir le préfet, afin de déclencher le plan particulier d’intervention (PPI).
Le PPI est un plan départemental d’urgence, qui a pour vocation de protéger les populations des effets du sinistre. (le préfet prend la main sur la direction des opérations de secours).