L’approche keynésienne de l’épargne est essentielle pour comprendre les déterminants de l’épargne en République Démocratique du Congo entre 1960 et 2020. Cet article met en lumière les faibles taux d’épargne et leur impact sur l’investissement et la croissance économique dans le pays.
Chapitre II : L’ANALYSE THÉORIQUE ET EMPIRIQUE DE L’EPARGNE
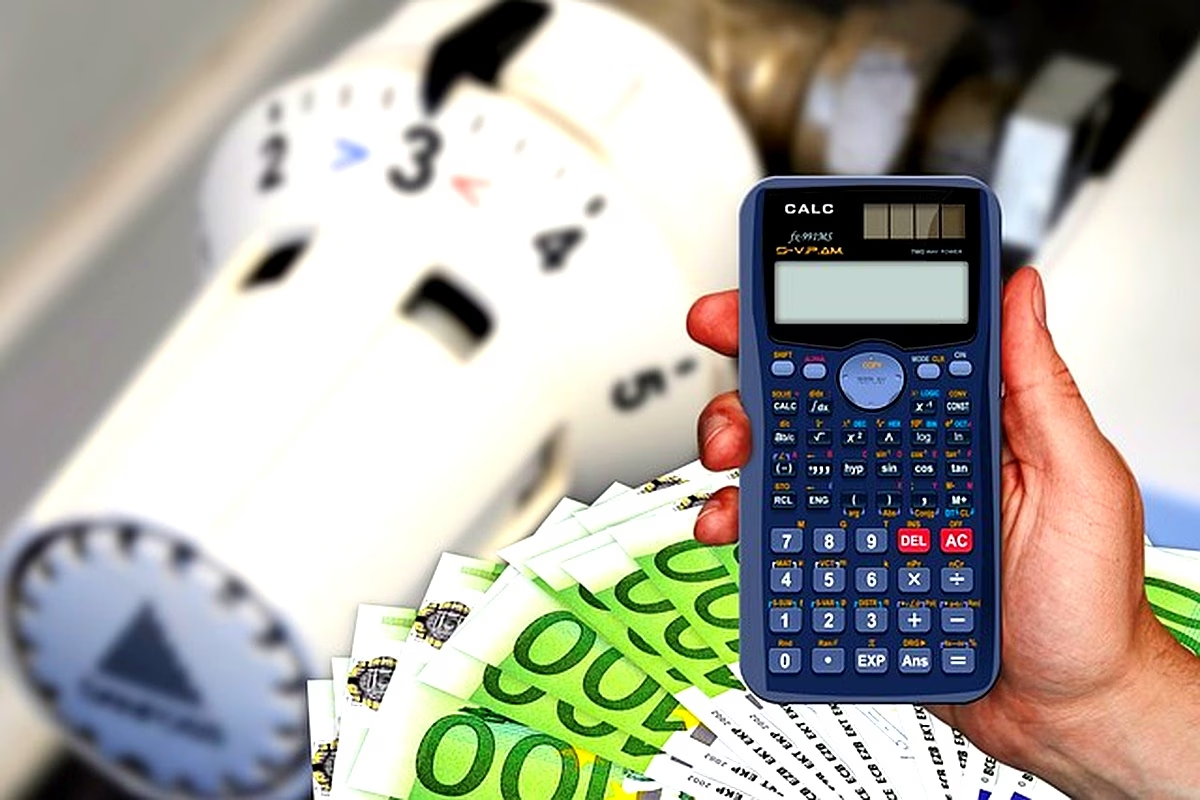
Section 1 :
DE L’ANALYSE THÉORIQUE
Les Keynésiens et les classiques ont des approches méthodologiques et conceptuelles différentes dans leur démarche de formulation de la fonction de consommation et d’épargne.
- Chez les Keynésiens, la variable explicative de l’épargne est le revenu courant, qu’il soit absolu ou relatif alors que les néoclassiques lui préfèrent le patrimoine entendu au sens de la richesse.
- Les Keynésiens déduisent le comportement de l’épargne à partir des données macroéconomiques pendant que les néoclassiques partent de l’analyse microéconomiques des fonctions individuelles de consommation des ménages à l’agrégation macroéconomique.
1.1. L’APPROCHE KEYNÉSIENNE
Elle va se développer dans deux directions :
- Le revenu courant de Keynes établit en fonction de la loi psychologique1 fondamentale un parallélisme entre les fluctuations du revenu et celles de la fonction de consommation ;
- Le revenu relatif et l’effet de mémoire. DUESENBERRY va plutôt mettre en exergue le phénomène de l’égalisation inter temporelle des utilités et l’idée d’interdépendance des consommations fondée sur l’effet de démonstration ou d’imitation. Pour BROWN, le passé n’intervient plus de façon discontinue par le biais du plus haut revenu jamais atteint, mais de façon continue par la consommation de la période précédente.
La Théorie Du Revenu Absolu
Selon Keynes, lorsque le revenu augmente, la consommation s’accroît, mais dans des proportions moins importantes parce que les ménages épargnent une part croissante de leur revenu au fur et à mesure que celui-ci s’accroît (l’épargne est une fonction croissante du niveau de revenu). Un ménage qui reçoit le SMIC peut difficilement épargne. La plus grande partie du revenu sera consacrée à la consommation. En revanche un ménage gagnant 10 fois le SMIC pourra plus facilement épargner, on peut même penser qu’il serait étonnant qu’il dépense la totalité de son revenu.
+cY(t)
C est consommation de l’ensemble des ménages, Y est le revenu des ménages et c est la proprension marginale à consommer comprise entre 0 et 1. Co est la consommation incompressible.
La propension moyenne est ici : elle est donc décroissante quand le revenu augmente.
La proprension marginale est ici : , c’est une constante la relation entre consommation et revenu exprime la tendance à consommer, la propension à consommer. Cette propension peut être calculer en moyenne ou/et à la marge. La propension moyenne à consommer le revenu c’est le rapport de la consommation des ménages à leur revenu.
La propension marginale à consommer c’est le rapport de la variation de la consommation entrainée par celle du revenu à cette variation du revenu. La fonction keynésienne de consommation est généralement exprimée de la façon suivante parce que la propension marginale à consommer c est supposée être constante (en réalité Keynes fait l’hypothèse que la propension marginale à consommer aurait tendance à diminuer avec la hausse du revenu) :
L’analyse de Keynes repose sur quatre idées :
- La consommation est principalement fonction du revenu réel beaucoup plus que le revenu nominal.
- La propension marginale à consommer (part d’un éventuel supplément du revenu qui sera affecté à la consommation) est positive et inférieure à un en vertu de la loi psychologique fondamentale16(*) qu’il énonce ainsi : « en moyenne et pour la plupart de temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que les revenus croissent mais non d’une quantité aussi grande que l’accroissement des revenus ». Ainsi une hausse (resp. Baisse) du revenu entraîne un accroissement (resp. Baisse) plus marquée de l’épargne.
- La propension moyenne à consommer (fraction du revenu dépensé qui est égale au rapport de la consommation totale au revenu) est inférieure à la propension marginale à consommer
- La fonction de consommation est stable à court terme.
[img_1]
Graphique N°9 : L’expression de la fonction de la consommation keynésienne
La Fonction Keynésienne Epargne :
Puisque le revenu a une double utilisation, à savoir la consommation et l’épargne (Y = C + S), la fonction de consommation peut également être exprimée par la fonction d’épargne. Keynes définit l’épargne (S) comme une renonciation à l’acte de consommer et non comme un transfert de consommation vers le futur.
[img_2]
Graphique N°10 : la fonction de l’épargne Keynésienne
La fonction de consommation devient alors :
Il se dégage les caractéristiques suivantes :
- Même si le revenu (Y) est nul, il existe un montant positif de consommation Co appelé consommation incompressible. Cette consommation autonome n’est pas fonction de revenu ;
- Lorsque la PMC 1 i.e. (C2 > Y2), l’épargne dans ce cas est négative. Toute valeur du revenu comprise entre 0 et Y1 correspond à la zone de désépargne ;
- Lorsque la PMC = 1 i.e. (C1 = Y1) au point E, l’épargne est nulle ;
- Lorsque la PMC < 1 (pour toute valeur de revenu supérieur à Y1), l’épargne est positive et cela veut dire que plus le revenu croit, plus la PMC diminue.
La Théorie de l’effet de démonstration (d’imitation) Et de l’effet De Mémoire
Nous présenterons successivement la théorie de l’effet de démonstration (d’imitation) développé par James DUESENBERRY (1949) et celle de l’effet de mémoire de BROWN (1982) qui se constitue comme prolongement de la première.
2.1. La théorie du revenu relatif (l’effet de démonstration (d’imitation)
Les hypothèses de la théorie du revenu relatif se partagent entre deux vérifications, l’une orientée vers les caractéristiques en coupes transversales de la population des consommateurs et l’autre orientée vers les séries chronologiques.
L’interprétation des observations de courtes périodes montre l’absence de parallélisme entre les fluctuations du revenu et celles de la consommation.
DUESENBERRY considère que le taux d’épargne des ménages est variable. Il diminue pendant les phases de récession et augmente pendant les phases d’expansion.
Il formule cette idée en posant :
= a Yt/Ym – b
St est la variable dépendante qui représente l’épargne des ménages au cours de la période t. a et b sont des constantes positives.
Yt et Ym sont respectivement le revenu disponible des ménages au cours de la période t et le revenu disponible le plus élevé atteint dans le passé.
Ainsi, le taux d’épargne est une variable dépendante de la position du revenu relativement au plus haut niveau de revenu atteint dans la passé YM. Il y a alors une visibilité dans le temps des décisions de consommation. Cet effet de cliquet ou effet crémaillère explique qu’en cas de baisse de l’activité économique et des revenus, la baisse de la consommation des ménages est freinée du fait de l’égalisation inter temporelle des utilités. Une fois un certain niveau de vie atteint, ce dernier est mis en mémoire par les ménages et tend, comme par un cliquet, à s’opposer à la baisse de la consommation résultant de la diminution du revenu.
La fonction de consommation de DUESENBERRY2 :
Principe
L’effet de démonstration constitue la base de la théorie du revenu relatif. L’auteur affirme que les agents d’un groupe social donné ont tendance à imiter la consommation d’un groupe au revenu supérieur, en voulant faire une « démonstration » de leur statut social. Cette volonté induit un accroissement de leur propension à consommer.
Duesenberry explique que les ménages se répartissent en groupes, des plus pauvres aux plus riches, et adoptent des habitudes de consommation qui les amènent à imiter les individus du groupe supérieur. C’est précisément cela qu’il appelle l’effet de démonstration et qui a pour conséquence que la propension à consommer est généralement peu sensible (inélasticité) aux fluctuations du revenu. Ainsi les choix de consommation dépendent certes du niveau de revenu, mais sont modulés en fonction de l’image que le consommateur veut présenter aux autres membres de la société. En conséquence, toute personne d’une catégorie socio-professionnelle donnée aurait tendance à adopter les comportements de consommation de la catégorie supérieure.
[img_3]
Soient deux groupes, les riches R et les pauvres P. Y est le revenu, C la consommation et c la propension à consommer.
L’arbitrage entre la consommation et l’épargne pendant la période de récession et reprise :
Temps t0 t1 t2
La forme de la fonction de consommation à laquelle conduit la théorie du revenu relatif se présente comme suit :
Yt b/Ym×Yt avec Yt = YM
En période de récession, le revenu disponible réel régresse mais la consommation diminue moins fortement, les ménages maintiennent leur niveau de consommation en réduisant leur épargne S. La fonction de consommation devient :
A la reprise et pendant l’expansion, la consommation s’élève mais plus lentement que le revenu, car l’accroissement de celui-ci permet aux ménages de reconstituer leur épargne. La fonction de consommation devient :
Ct = [1 + b – a (1+Ω)] Yt
Ω est assimilé au taux de croissance de l’économie
La consommation redevient proportionnelle au revenu lorsque ce dernier retrouve le niveau le plus élevé atteint dans le passé A.
L’interprétation des observations en coupes instantanées de la théorie du revenu relatif débouche sur l’abandon de l’un des postulats de la théorie classique de la consommation, à savoir l’indépendance de la consommation d’un agent de celle des autres agents. DUESENBERRY va développer l’idée d’interdépendance des consommations fondée sur l’effet de démonstration ou d’imitation.
Les agents du groupe p auront une propension à consommer plus forte que celle des agents du groupe supérieur à p soit r parce qu’ils chercheront à imiter la consommation de ceux ayant un niveau de vie supérieur. Ceci explique pourquoi la croissance du revenu au cours du temps n’entraîne pas la diminution de la propension à consommer.
En somme, les individus sont plus sensibles à leur consommation relative et comparent régulièrement leur dépense à celle des autres consommateurs. Ainsi, pour un même niveau de revenu, une famille appartenant à la population noire aux Etats-Unis aura une PMC plus faible que celle d’une famille appartenant à la population blanche.
L’explication que propose DUESENBERRY est qu’à revenu égal, la famille noire sera, à l’intérieur du groupe social formé par la population noire relativement plus riche que la famille blanche à l’intérieur du groupe social formé par la population blanche.
La théorie du revenu relatif permet ainsi d’expliquer que la croissance du revenu des ménages au cours du temps n’entraîne pas de diminution de la PMC bien que, en coupes instantanées, l’élévation du revenu s’accompagne d’une baisse de celle-ci.
Les développements de DUESENBERRY appellent les remarques suivantes :
- S’il a raison de mettre l’accent sur les phénomènes de longues périodes, il convient en revanche de remarquer qu’il n’explique pas vraiment pour quelle raison les PMC globales des différents groupes sociaux demeurent constantes en longue période.
- La conception qu’il se fait de la mémorisation est critiquable dans la mesure où celle-ci fait abstraction du temps. Ainsi, le revenu maximum Ym agira sur la relation entre la consommation et le revenu durant toute la période comprise entre to et t2 quelle que soit la longueur de cette période. On peut valablement penser que l’influence de Ym diminuera au fur et à mesure qu’on s’éloigne de to et en particulier, qu’elle sera plus faible que la période de récession sera longue.
- On peut aussi reprocher le fait que DUESENBERRY ait traité d’une façon symétrique la phase de dépression et la phase de reprise qui présentent la même liaison entre la consommation et le revenu. Or, il est probable que cette liaison ne soit pas la même au cours de ces phases.
________________________
1 Concernant la consommation, Keynes met en avant une « loi psychologique fondamentale », selon laquelle « lorsque le revenu croît, la consommation aussi mais pas dans la même proportion. Soit la ropension marginale à consommer : PmC = c = ΔC/ΔY, ou dC/dY quand ΔY tend vers 0 (c > 0 et < 1). ↑
2 DUESENBERRY, J. Income, saving and the theory of consumer behaviour, Havard UP, 1949 ↑