L’universalisme républicain en francophonie est au cœur de l’analyse du Dictionnaire des francophones, considéré comme un outil politique et linguistique. Cet article explore les tensions entre les intérêts français et francophones, ainsi que les implications de cette scission sur la gouvernance linguistique.
Chapitre 2 :
Considérer la scission entre les intérêts français et francophones
Section 1.
Posture du DDF à l’égard de l’universalisme républicain
[img_1]
Source : Fourneau, J. (2022a, 10 avril). « Il faut se méfier des mots. » [Photographie]. Œuvre de street art conçue par l’artiste Ben. Place Fréhel, Belleville, Paris 20e.
A-L’universalisme disputé dans la sphère publique
La notion d’universalisme est complexe. C’est un visage à multiples facettes qui suscite de vifs débats. Pour Mona Laroussi, tout comme un ouvrage est tributaire du regard de son lecteur, « Les valeurs universelles dépendent de la personne qui perçoit les choses » (2022, p. 46). Ainsi, différents points de vue se côtoient au sein du même mot.
Dans le cadre de notre analyse du DDF, nous avons passé en revue les courants de pensée qui s’en saisissent. Afin de faciliter l’état de l’art, le paradigme est scindé en trois niveaux : celui de l’universalisme républicain en tant que principe institutionnel, celui des désaccords formulés par les théoriciens postcoloniaux, et celui du postulat appliqué à la sociolinguistique.
1. Le principe d’intégration républicaine soumis à controverse
Au premier niveau, l’universalisme républicain est un attribut de la République française. « Principe régulateur, il se traduit « dans des institutions et dans des pratiques sociales » (Leclair, 2015). On doit sa naissance à la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ce qui l’inscrit, par voie de conséquence, dans la lignée de l’esprit des Lumières.
Lui sont prêtés le plein respect des droits de l’homme et les valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité. Symboles de l’idéal universel, elles ont vocation à s’appliquer à tous les citoyens. La République a pour projet de fédérer la population autour d’une identité commune, au détriment des singularités propres à chacun (Coutel, 2022).
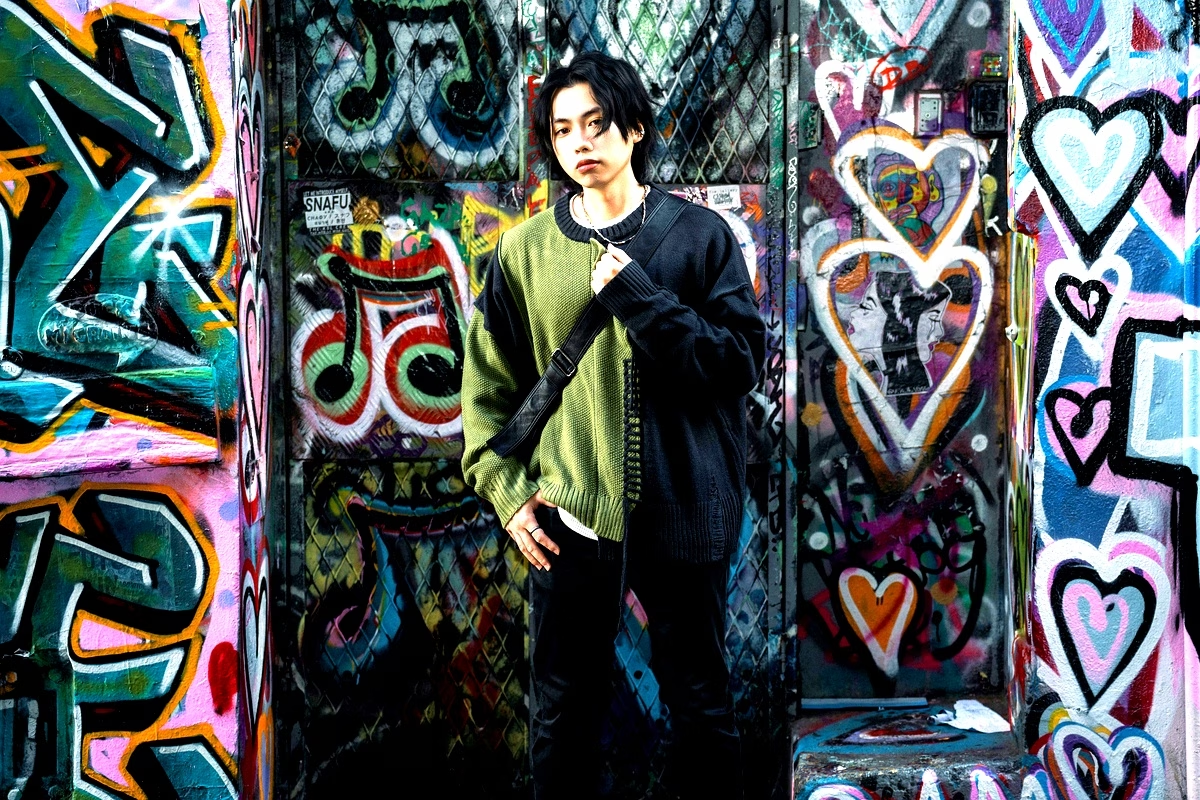
Les dictionnaires en ligne Le Robert ainsi qu’Encyclopédie universalis s’accordent à dire que le paradigme conçoit la cohésion citoyenne par l’unité et l’indivisibilité. Le dictionnaire en ligne Toupie souligne, quant à lui, la prédominance de la « nature commune » des individus, promulguée comme la condition nécessaire à « l’unité fondamentale du genre humain ».
L’universalisme républicain est un « principe d’intégration » et non une « description de la réalité » (Leclair, 2015), ce qui assoit l’idéal d’un citoyen abstrait.
Cet universalisme – à la fois philosophique et politique – est aujourd’hui remis en cause. Est critiqué le fonctionnement endogame de l’appareil d’État. L’indivisibilité de la République est apparentée au jacobinisme, régissant l’organisation étatique française. Pour Blanchet, le système jacobin n’est pas le fait de tous les citoyens mais d’une poignée « de gens se reproduisant entre eux, dans un certain nombre de grandes écoles » (2022, p. 115). Il en résulte un eurocentrisme contesté par « une bonne partie de la population française » (Idem) et qui a été porté sur la scène médiatique.
2. Un ethnocentrisme latent dénoncé par les théoriciens postcoloniaux
L’universalisme républicain n’est pas favorable à l’affichage de signes distinctifs dans l’espace public. C’est une des raisons pour lesquelles il fait débat. Se pose la question de la cohabitation entre la diversité propre à une société et son besoin d’unité.
Orban fait valoir, dans son article Universalisme, entre reconnaissance de la diversité et unité de la nature humaine, l’ambiguïté de la notion, « synonyme tantôt de progrès occidental, tantôt de code moralisateur, tantôt de métissage contraint, tantôt de monde utopique, tantôt de culture mondiale homogène et insipide » (2015). La dimension abstraite du paradigme est vivement critiquée, ainsi que sa propension à assimiler socialement tout individu – prérequis pour faire corps avec la nation –.
La pensée postcoloniale s’attelle à dénoncer la partialité et les failles du principe régulateur. Selon Vergès, Diagne et Sudeau, la sève de l’universalisme n’est autre que le fruit d’une volonté impérialiste orchestrée par l’aire culturelle occidentale pour assoir son hégémonie (2018, 2022).
Tour à tour, ils le qualifient d’« universalisme blanc », « universalisme européen qui impose une uniformité à partir de son particularisme » et qui n’est pas un « projet pour l’humanité, mais une idéologie de l’universel au service de la supériorité européenne » (Diagne et Sudeau, 2022, p. 14). Et de rajouter que l’universalisme serait un « eurocentrisme » (Ibid., p. 44) au service de « sa propre particularité » (Ibid., pp. 68-69).
La condamnation du biais positionnel européen se retrouve également chez Tzvetan Todorov, qui qualifie l’universalisme – dans Nous et les Autres. La réflexion française sur la diversité humaine (1992) – d’« ethnocentrisme qui s’ignore ».
Parmi les reproches imputées à l’universalisme : celui de n’inclure, sous couvert d’unité, qu’une certaine frange de la population. C’est ce que pointent Niang et Sudeau lorsqu’ils expriment l’interrogation suivante : « Pourquoi ceux qui se pensent et se disent universalistes sont-ils convaincus qu’il n’en existe qu’une seule forme – celle qu’ils professent ? » (2022, p. 6)
Ils empruntent la grille de lecture bourdieusienne scrutant les mécanismes de la reproduction sociale pour avancer que « la fiction pseudo-universaliste permet à un nouveau type d’héritiers de maintenir leur monopole sur l’universel. Ce sont ces rentiers de la République qui s’arrogent le droit de dire ce qui est ou n’est pas universaliste » (Ibid., pp. 34-35).
Opinion partagée par Leclair, qui s’interroge : « affirmer l’universalité de nos valeurs n’est-ce pas faire preuve d’ethnocentrisme ? » (2015) Selon lui, le risque serait « d’invoquer l’universel pour justifier des discriminations » (Idem).
Forts de ce constant, Niang et Sudeau se proposent de déconstruire cet « humanisme euro-centré » (2022, p. 36) sans pour autant rejeter sa dénomination. Pour ce faire, le néologisme d’« universalisme postcolonial » est avancé (Ibid., p. 14). On retrouve dans leur critique engagée des similitudes avec la typologie de l’universalisme proposée par Souleymane Bachir Diagne & Jean-Loup Amselle dans leur ouvrage En quête d’Afrique(s) (2018).
Selon eux, deux types d’universels cohabitent au sein du même terme : l’universel « de surplomb » – qui appréhende la diversité au prisme d’un point de vue central inquestionné – et l’universel « latéral » – qui promeut une vision horizontale, délestée de centre de référence et davantage ouverte à l’appréhension du particulier –.
L’universalisme « latéral » fait écho à la définition proposée par Niang et Sudeau de l’universalisme postcolonial. Ils empruntent la métaphore de la « mosaïque » pour imager leur ambition « d’appréhender la notion d’identités non pas comme un ensemble homogène et immuable, mais comme la somme de pièces rapportées, d’éléments nombreux et disparates, qui contribuent à créer une structure singulière tirant sa force et son originalité de la diversité de sa composition » (2022, p. 10).
Une posture complémentaire est celle de Philippe Blanchet, qui effectue un distinguo entre l’universalisme de facto et l’intention universaliste. Il enjoint de différencier le constat éventuel d’un « phénomène […] universel » et « le fait de vouloir qu’un phénomène soit universel » (2022, p. 114). La propension de l’universalisme républicain à « plutôt vouloir que de constater » est à ce titre relevée et qualifiée « d’autoritarisme, voire de colonialisme » (Idem).
En résumé, la priorité est-ici de soutenir une concertation citoyenne plus forte. Elle vise à taire le biais de complaisance selon lequel « on affirme que quelque chose est universel sans demander aux autres s’ils sont d’accord pour le partager » (Idem).
La posture postcoloniale n’est pas dépourvue d’opposition. Les particularismes – perçus comme le terreau du communautarisme – sont pointés du doigt dans l’essai Oser l’universalisme. Contre le communautarisme. (Heinich, 2021) L’autrice soutient que l’universalisme doit être pensé comme un idéal à poursuivre et non comme une réalité à constater : « Une valeur […] ne peut donc être invalidée par le constat de son non-accomplissement […]. » (Idem)
L’effacement des particularismes s’oppose à la vision anglo-saxonne qui, ouverte aux différences culturelles et à la protection des minorités, est disséminée dans l’ensemble des déclarations internationales contre les discriminations (Coutel, 2022). Elle part du constat que coexistent sur un même territoire des personnes et des groupes se reconnaissant dans des cultures diverses.
La préconisation est d’instituer le multiculturalisme en norme sociale, préférable – à leurs yeux – aux conceptions républicaines universalistes (Leclair, 2015).
Dans le cadre de notre analyse du DDF, nous postulons que le dictionnaire est dans le sillage de « l’universalisme postcolonial » – tel que présenté par Niang et Sudeau (2022) – et de « l’universalisme horizontal » – proposé par Diagne et Amselle (2018) –.
3. Réfuter la fable de l’unité linguistique
Appliqué au domaine des langues, l’universalisme suscite également la discussion. Cet élément de langage est attribué au français dès 1784, où l’Académie de Berlin accueille un concours littéraire dédié à son « universalité » (Rey, 2007, p. 91). Le sujet sur lequel discourir est alors le suivant : « Qu’est-ce qui a fait la langue française la langue universelle de l’Europe ? » (Calvet, 1999, p. 71)
Si le thème sert de support à l’eurocentrisme dénoncé par le courant postcolonialiste, il pose la question de la relation – prétendue ou réelle – entre la langue et l’universalisme. D’après l’ouvrage éponyme de Hoedt et Piron, « le français n’existe pas » (2020), et sa dimension universelle non plus.
Afin d’affirmer ou d’infirmer ce postulat, nous avons confronté les discours des linguistes interviewés. Il ressort de notre analyse comparative l’inadéquation du qualificatif « universel ». Sa présence active dans les discours donne à voir une intention politique dissimulée derrière la langue plutôt qu’un constat linguistique.
Michel Francard et Maxime Somé nous concèdent tous deux qu’il s’agit d’un élément de langage : « […] il ne faut pas mettre sur le dos d’une langue – que ce soit par métaphore ou par souci politique – des caractéristiques qui sont celles des locuteurs. Une langue n’est pas plus universelle qu’une autre. » (Francard, 2022, p. 134) Bien que disposant d’un pouvoir symbolique puissant, l’universalisme n’est pas à souhaiter :
L’universalisme, ça ne peut pas être une seule langue et une seule norme. Pour toute langue qui meurt, il y une culture derrière. Si vous défendez cet universalisme linguistique où nous devrions tous parler la même langue, vous imaginez toutes les cultures que nous pourrions perdre. (Somé, 2022, p. 74)
L’état de l’art corrobore notre enquête empirique. Tandis que Coutel plaide pour une « réaffirmation de la normativité du langage » – citant Jacques Muglioni qui avait déploré que « l’école actuelle apprend à parler comme on parle au lieu d’apprendre à parler comme on devrait parler » (2021) –, d’autres entendent cesser de faire la part belle à l’unicité de la langue française.
C’est ce constat qui est avancé par Niang et Sudeau lorsqu’ils expriment que « tout comme l’Académie française n’entend pas partager la définition du bon usage de la langue, les vigies du pseudo-universalisme exercent une police idéologique sur les valeurs » (2022, p. 18).
Klinkenberg les rejoint en mettant en garde contre l’hypostase de la langue, i.e. « en faire un objet allant de soi » (2007). Il se réfère à la notion de « culture nationale » – établie par Johann Gottfried Herder, précurseur du romantisme – pour étayer la thèse selon laquelle il faut « combattre l’hégémonie de la culture française des Lumières et leur commune prétention à l’universalité » (Ibid., p.).
L’argument majeur est donc le suivant : aucune culture nationale n’est comparable à une autre – la valeur de chacune étant imputée à sa singularité –. C’est en ce sens qu’ Alain Rey fustige le « délire universaliste de Rivarol » (2007, p. 116) ainsi que le mythe de la « clarté » (Ibid., p. 93).
Le travail de Barthes permet de faire remonter qu’il s’agit d’un « langage politique inventé par les classes supérieures pour « renverser la particularité de leur écriture en langage universel » » (1966, dans Rey, 2007, p. 93). Klinkenberg en convient. La langue, « synecdoque du peuple » – puisqu’assignée à un emblème –, est dépeinte « dans son unité, et non dans sa diversité » (2007).
Dès lors, le débat actuel peut se résumer à l’interrogation suivante : « Comment faire en sorte que l’universalisme, comme le dit l’historien Pap Ndiaye, soit valable pour tout le monde ? » (Niang, 2018, p. 61). En ce qui concerne le DDF, la discussion se déporte. La question n’est pas de savoir s’il s’agit d’un outil universaliste mais plutôt de déterminer quelle définition de l’universalisme il revêt.
