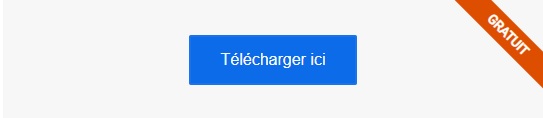Universalité et communauté
Le débat autour du vocabulaire de l’information et de la connaissance recoupe partiellement la tension existant entre les notions d’universalité et de communauté.
En effet, considérer le logiciel en tant qu’objet purement informationnel revient à dire que celui-ci est séparable des collectifs qui le produisent : point n’est besoin de faire partie des développeurs du noyau Linux ou d’être membre de la Free Software Foundation pour installer un système d’exploitation GNU/Linux chez soi.
Un logiciel libre peut être utilisé par tous, sans considération d’appartenance au mouvement du logiciel libre. Ses droits d’usage, c’est-à-dire les quatre libertés, sont distribués de manière universelle, et cela a toujours été le cas. Dans les premiers temps du mouvement, les débats pour savoir si le nombre de bénéficiaires de ces libertés devait être limité furent toujours conclus par la réaffirmation d’un principe d’universalité.
L’argument du caractère non rival de l’information apparaît ici pertinent. Puisque le fait que trois personnes ou trois millions utilisent un logiciel ne change rien à la possibilité pour moi de m’en servir1, puisque je ne « perds » rien au fait qu’il en existe un grand nombre de copies, il n’y a aucune raison de limiter l’étendue des droits d’usage, si l’on se place du point de vue de la préservation de la ressource2.
Cela n’est évidemment plus vrai lorsque l’on considère des biens rivaux : une forêt peut être détruite par sa surexploitation, et il n’est pas possible d’en recréer une pour la gérer différemment, comme il est possible de dupliquer le code source d’un logiciel libre pour lancer un projet de développement dans une autre direction.
Au sein du large spectre désormais couvert par la notion de « biens communs », la limitation des droits d’usage à une communauté particulière apparaît à l’évidence comme une option plus séduisante dans le cas des ressources physiques rivales, que dans le cas des objets informationnels.
L’exemple des semences, que nous avons déjà évoqué, vient cependant compliquer la réflexion. Il s’agit d’un objet que l’on peut considérer (en suivant sur ce point Philippe Aigrain) comme étant « à base informationnelle ».
Pourtant, il entretient un lien étroit avec un territoire, des connaissances et des savoir-faire particuliers, lorsqu’il n’est pas transformé en produit purement industriel et marchand.
C’est là ce que soulignent avec force les partisans des semences paysannes. Ces derniers réclament par conséquent la plupart du temps des droits d’usage limités à des communautés particulières, et la reconnaissance des savoirs propres ce celles-ci.
Ils se distinguent ainsi du discours universaliste sur l’accès de tous à l’information, qui est celui des partisans du logiciel libre1, quand bien même ils s’occupent d’un objet qui peut être considéré comme ayant une composante informationnelle forte.
1 En réalité, le fait qu’un plus grand nombre de de personnes utilisent un logiciel constitue même un avantage et une incitation à l’adopter, en vertu de ce qu’on appelle souvent un « effet de réseau ».
2 Bien entendu, si l’on se place d’un point de vue économique, la réponse est moins évidente. Le modèle économique du logiciel propriétaire repose ainsi sur la limitation des droits d’usage, essentiellement le contrôle de la copie et des conditions d’utilisation.
Si l’on dépasse la question des droits d’usage, on remarquera que la production de logiciels libres repose en revanche souvent sur des ressorts et des dynamiques communautaires.
Rappelons que la fondation du mouvement du free software par Richard Stallman tenait à une volonté de recréer un collectif avec ses pratiques et ses valeurs propres, à l’image de la communauté qui existait au sein du laboratoire d’intelligence artificielle du MIT avant qu’elle ne soit détruite par l’essor de l’industrie du logiciel (cf. chapitre 1). Aujourd’hui, certains grands collectifs du logiciel libre affirment fortement cette dimension communautaire : Debian par exemple (cf. chapitre 4).
Dans ce dernier cas, on pourrait presque parler de « mille-feuille communautaire ». La communauté dans son ensemble est soudée autour de principes généraux, énoncés dans des documents fondateurs (« constitution », « contrat social », « principes du logiciel libre selon Debian ») et mis à l’épreuve lors du New Maintainer Process.
Mais on y trouve également des sous-structures, qui rassemblent des membres partageant une proximité professionnelle, amicale ou géographique.
Or, comme le remarque Christophe Lazaro, « c’est précisément ce type de sous-structures qui incite les agents à étendre leur coopération avec d’autres », et qui évite que les contributions individuelles au projet apparaissent à leurs auteurs comme « autant de dons faits à des inconnus »2.
Il existe donc au sein du logiciel libre aussi bien une dynamique universaliste, liée à la volonté de s’adresser à un nombre d’utilisateurs potentiellement illimité, qu’une dynamique communautaire, liée à l’ethos spécifique des hackers et aux conditions de production dans des collectifs de techniciens, dont les frontières sont souvent précisément délimitées en dépit de l’ouverture du code source.
En ce sens, la formule d’André Gorz, qui parlait de la « communauté virtuelle, virtuellement universelle des usagers-producteurs de logiciels et de réseaux libres »3, semble assez bien choisie, dans la mesure où elle rassemble dans une même phrase ces deux dimensions : universalité et communauté.
1 On pourra toutefois noter que certains « libristes » soutiennent que le principe du copyleft, en adjoignant aux quatre libertés l’obligation de conserver celle-ci, est une manière d’en réserver la jouissance à ceux qui en reconnaissent les conditions. Dans cette perspective, « Linux et Dotclear ne sont pas des logiciels universels, ils sont tout à fait réservés à ceux qui acceptent et se conforment à la GPL » [BORNEO, commentaire posté le 28 décembre 2010 à 08h15, en ligne : http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/12/26/Lrsquo%3Baffaire-ldquo%3Bla-carte-et-le-territoirerdquo%3B (consulté le 16/09/2011)]. Pour le dire autrement, les droits d’usage sont octroyés d’une manière qui n’est que potentiellement universelle, puisqu’elle l’est sous condition d’acceptation du principe du copyleft.
2 Christophe LAZARO, La liberté logicielle, op. cit., p. 167.
3 André GORZ, L’immatériel, op. cit., p. 92
Deux « récits »
Dans quelques pages remarquables, Isabelle Stengers a pour sa part remarqué que le mouvement du logiciel libre, en tant qu’il a suscité l’intérêt appuyé de nombre d’activistes et d’intellectuels, a donné naissance à deux « récits ».
Il faut entendre par là qu’il existe deux grandes manières de faire sens de ce qu’ont réalisé les informaticiens du « libre », et que chacune d’entre elles renvoie à un projet de transformation sociale particulier.
Le premier récit insiste sur la dimension d’universalité. Il « met en scène un renouvellement du théâtre conceptuel marxiste »1 autour des notions de « capitalisme cognitif » et de « prolétariat immatériel ».
Le mouvement du logiciel libre y est doté d’une valeur « exemplaire et annonciatrice »2; il est considéré comme emblématique des transformations du capitalisme, et des nouvelles potentialités d’émancipation qui y sont liées.
Il est abordé comme producteur d’un « commun foncièrement anonyme », d’une « sorte d’universel humain » qui fait signe vers un au-delà de la société actuelle, posé « à long terme, voire à terme indéfini »3.
Le second récit – qui est celui adopté par Isabelle Stengers – affirme en revanche que le commun constitutif du mouvement du logiciel libre n’est nullement universel et anonyme, mais est au contraire le commun propre aux informaticiens qui se sont engagés pour le défendre.
Ce récit implique donc de penser des collectifs concrets et situés, qui élaborent des pratiques spécifiques et se distinguent par là de « l’ensemble indéfini de ceux qui […] utilisent, voire téléchargent, ce qui a été produit »4, en vertu de l’universalité des droits d’usage attachés au logiciel libre.
L’accent est ici mis sur la notion de communauté, non pas la communauté virtuellement universelle des utilisateurs, mais bien plutôt la communauté délimitée des créateurs de logiciels, « réunis par ce qui les fait penser, imaginer, créer sur un mode où ce que fait chacun importe aux autres, est ressource pour d’autres »5.
La distinction entre ces deux récits fait ressortir de manière particulièrement éclatante la tension entre universalité et communauté qui anime le mouvement du logiciel libre.
Elle indique surtout que la signification attachée au logiciel libre dans les milieux militants et intellectuels qui s’y sont intéressés a pu varier dans des proportions importantes.
Le premier récit correspond en effet, dans ses grandes lignes, à la réception du logiciel libre par la gauche intellectuelle radicale en France, notamment autour de la revue Multitudes.
Il s’agit d’une approche néo-marxiste, notamment en ce qu’elle reprend le concept de general intellect développé par Marx dans les Grundrisse.
Le deuxième récit est lui assez conforme aux idées mises en avant au sein de la « coalition des biens communs », dans un style de pensée davantage marqué par l’expérience des différents « terrains » d’activisme et, sur le plan théorique, par le libéralisme anglo- saxon et les travaux de l’économiste Elinor Ostrom.
1 Isabelle STENGERS, Au temps des catastrophes, op. cit., p. 105.
2 Ibid., p. 106.
3 Ibid. p. 107.
4 Ibid. p. 109.
5 Ibid. p. 110. Isabelle Stengers nomme les créateurs de logiciels libres « usagers », en référence notamment aux « mouvements d’usagers » comme celui des malades du sida.
Nous consacrons les deux prochains chapitres à l’exposé détaillé de ces deux récits. Ceux-ci figurent en effet deux grandes manières d’altérer l’utopie du logiciel libre, c’est-à-dire de la transformer en un projet général de transformation sociale allant au-delà de l’idéal de libre circulation de l’information revendiqué par les hackers.