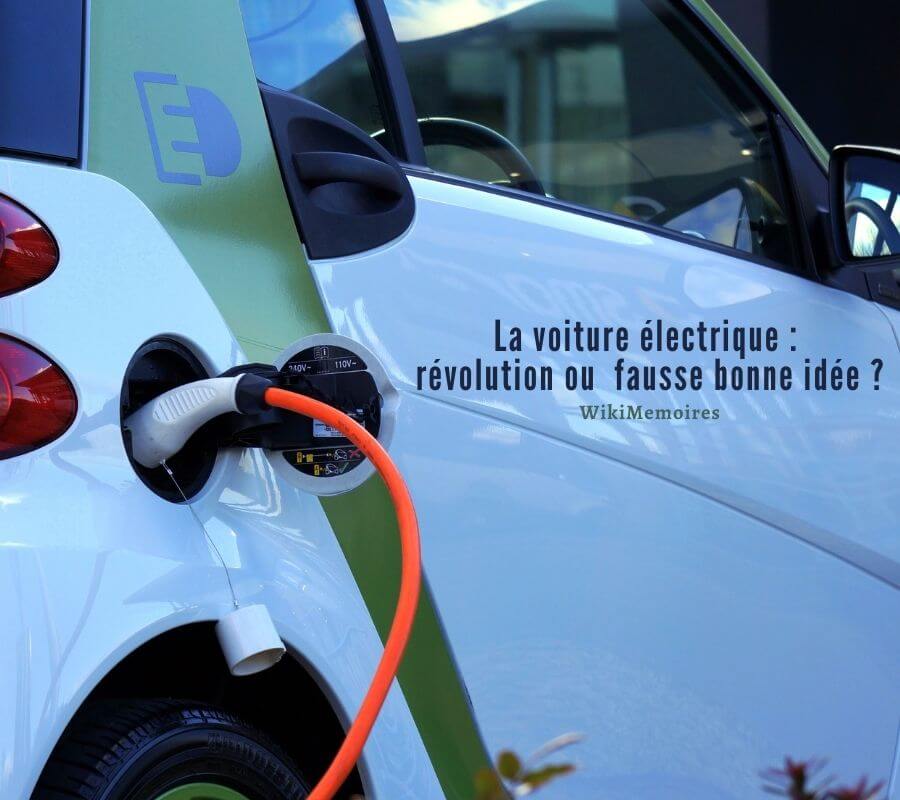La voiture électrique : révolution ou fausse bonne idée ?
Mémoire de Master (ULB) sur la voiture électrique : bilan énergétique et environnemental, enjeux des batteries, impacts sur le réseau, politiques publiques et perspectives de mobilité durable.
Analyse approfondie de Damien Sury (Université Libre de Bruxelles) sur la voiture électrique : efficience énergétique, émissions de GES, effets positifs et limites, rôle du Vehicle-to-Grid (V2G) et nécessité d’un changement de paradigme de la mobilité.
Université Libre de Bruxelles
Institut de Gestion de l’Environnement
et d’Aménagement du Territoire
Faculté des Sciences
Master en Sciences et Gestion de l’Environnement
Mémoire de fin d’études présenté en vue de l’obtention du grade académique de Master en Sciences et Gestion de l’Environnement

La voiture électrique : révolution ou fausse bonne idée ?
par SURY Damien
Directeur : Frédéric DOBRUSZKES
Co-directeur : Michel HUART
Année académique
2010-2011
Liste des acronymes et abréviations
Note préliminaire : dans le cadre de cette liste, le terme « véhicule » est utilisé au sens restreint de voiture, et sera utilisé comme tel tout au long de ce mémoire, conformément à ce que l’on trouve souvent dans la littérature.
Pour autant, le véhicule électrique peut tout aussi bien être un deux-roues électrique ou un camion électrique et dans ce cas sera spécifié comme tel.
ACV : analyse cycle de vie.
CO2e : CO2 équivalent, potentiel de forçage radiatif total d’une activité prenant en compte l’ensemble des gaz à effet de serre GES et en les ramenant à l’unité du potentiel de forçage radiatif du CO2.
CE : Commission européenne.
Charb. : Charbon.
DG : direction générale (de la commission européenne).
EPA : Environmental Protection Agency, agence américaine de protection de l’environnement.
Ess. : Essence dans le sens de carburant pour moteur à combustion interne issu principalement de la distillation du pétrole.
FAP : filtre à particules.
GES : gaz à effet de serre, ensemble des gaz responsables de l’effet de serre au nombre desquels on compte principalement le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4).
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.
MPG : en anglais miles per gallon, mile par gallon, sert de référence de consommation permettant de comparer les voitures au Etats-Unis. Le mile correspond environ à 1,6 km et le gallon environ à 3,78 l.
PM : en anglais particule matter, particules fines.
UE : Union Européenne.
VE : véhicule électrique, en anglais electric vehicule (EV), dans la pratique on l’utilise au sens restrictif de véhicules électriques à batteries (VEB) alors qu’un véhicule à pile à combustible peut aussi être considéré comme un véhicule électrique bien que dépourvu de batteries.
VEB : véhicule électrique à batterie, en anglais battery electric vehicule (BEV).
VEH : véhicule électrique hybride (non rechargeable), en anglais hybrid electric vehicule (HEV), même si le nom hybride pourrait faire croire qu’on se réfère à tout type d’hybridation, dans la pratique le nom ne désigne que les hybrides thermiques-électriques. Il s’agit de voitures dont la batterie est rechargée en roulant (lors de phases de décélération et de freinage) et non sur une prise de courant (par opposition au VEHR).
VEHR : véhicule hybride électrique rechargeable, en anglais plug-in hybrid electric vehicule (PHEV), c’est- à-dire qu’il se recharge sur une prise de courant. Même si le nom hybride pourrait faire croire qu’on se réfère à tout type d’hybridation, dans la pratique le nom ne désigne que les hybrides thermique-électrique.
VT : véhicule thermique (parasynonyme de véhicule à moteur à combustion interne ou à explosion) désigne les véhicules à essence et au diesel. En anglais le terme Internal Combustion Engine Vehicule (ICEV) est plus souvent utilisé.
V2G : vehicule to grid, système qui permet à la voiture électrique de communiquer avec le réseau électrique afin de recharger sa batterie ou d’injecter de l’électricité sur le réseau de façon « intelligente ».
WWF : World Wide Fund for Nature (voir http://www.wwf.org/).
Table des matières :
Introduction
Partie I. Le système actuel de transport individuel motorisé : contexte et nuisances
I.1. Contexte
I.1.1. Importance de la voiture individuelle et ordres de grandeur
I.1.2. Type de carburant utilisé par le secteur des transports routiers
I.1.3. Puissance et consommation des véhicules
I.1.4. Lien entre voiture individuelle et dispersion de l’habitat et des activités économiques
I.1.5. Peak Oil : la fin du pétrole bon marché
I.2. Nuisances du système de transport individuel motorisé actuel fondé sur la voiture particulière
I.2.1. Nuisances environnementales
I.2.1.1. Flux de matière et d’énergie
I.2.1.2. Émissions de gaz à effet de serre
I.2.1.3. Pollutions
I.2.1.4. Aménagement et occupation de l’espace
I.2.1.5. Bruit
I.2.2. Nuisances économiques et sociales
I.3. Question de recherche
Partie II. Analyse critique des connaissances existantes
II.1. Les batteries
II.1.1. Comparaison des technologies
II.1.2. Le lithium comme facteur limitant
II.1.3. Solutions à la limite d’autonomie
II.1.3.1. Bornes de recharge
II.1.3.2. Solutions technologiques
II.1.3.3. Solutions Comportementales
II.1.4. Bilan environnemental et recyclage des batteries au lithium
II.1.5. Conclusion
II.2. Énergie et émissions
II.2.1. Questions méthodologiques
II.2.2. Solutions proposées pour répondre à ces questions méthodologiques
II.2.3. Efficience comparée voiture électrique et voiture thermique
II.2.4. Émissions de GES
II.2.5. Émission de polluants atmosphériques
II.2.6. Perspectives d’amélioration
II.2.7. Demande supplémentaire en électricité et craintes pour le réseau
II.2.8. Effet positif sur le réseau, sur la production d’énergie « verte » et v2g
II.2.9. Conclusion
II.3. Avantages, limites et possibles effets négatifs de la voiture électrique
II.3.1. Pollution, changement climatique et bruit
II.3.2. Diversité des sources d’approvisionnement
II.3.3. Utilisation de l’espace en ville
II.3.4. Coût d’achat et d’utilisation
II.3.5. Spécificités de fonctionnement pour l’automobiliste : recharger la batterie
II.3.6. Possibles effets négatifs
II.3.6.1. Effet rebond
II.3.6.2. Effet d’aubaine
II.3.6.3. Effet d’addition
II.3.6.4. Effet de substitution
II.3.7. Conclusion
II.4 Politiques publiques
II.4.1. Catégorisation des types de politiques publiques
II.4.1.1. Incitants financiers
II.4.1.2. Incitants non financiers
II.4.1.3. Législation
II.4.1.4. Financement et coordination de l’infrastructure
II.4.1.5. Standardisation
II.4.1.6. Comportement du consommateur
II.4.2. Exemples de politiques publiques
II.4.2.1. Subsides à l’achat
II.4.2.2. Soutien à l’industrie
II.4.3. Politiques de l’Union Européenne
II.4.3.1. La règlementation sur les rejets de CO2
II.4.3.2. European Union Emissions Trading Scheme EU-ETS
II.4.3.3. Livre blanc des transports
II.4.4. Conclusion
Partie III. Vers un changement de paradigme ?
III.1. Théorie de la transition : une grille de lecture du système actuel de mobilité individuelle motorisée
III.2. Constructeurs Traditionnels : Renault et Nissan
III.3. Constructeur émergent : Tesla
III.4. La voiture devient un téléphone portable : le projet Better Place
III.5. Économie de fonctionnalité : Car Sharing Clubs
III.6. Conclusion : comment repenser la mobilité ?
Conclusion