Le cadre théorique de l’éducation révèle des inégalités surprenantes dans les établissements scolaires haïtiens, où le sexisme influence les rapports pédagogiques. Cette étude essentielle met en lumière comment les constructions sociales du genre désavantagent les filles, transformant notre compréhension des dynamiques éducatives en milieu scolaire.
Chapitre I- Orientations théoriques et épistémologiques
Pour rendre plus intelligibles les idées directrices de ce mémoire, il est impératif pour nous de faire une revue de littérature des travaux déjà réalisés sur les thèmes centraux de notre sujet de recherche. D’où l’importance de ce cadre théorico-conceptuel à ce stade du présent travail. Ceci nous servira grandement dans l’opérationnalisation et l’appréhension des concepts-clés tels que l’adolescence, les rapports sociaux de genre, l’identité et autres.
Vu l’immensité des débats que ces termes et notions ont suscité dans les sciences humaines et sociales, il ne sera pas possible de tout relater ici. Toutefois, nous allons nous en tenir à certaines théories et l’apport de certains auteurs tels que, Françoise Dolto, Jean-Claude Quentel, Christine Delphy, Pierre Demeulaire, Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Elsa Dorlin, Elisabeth Badinter, Danièle Kergoat, Françoise Héritier etc.
Les orientations théoriques retenues s’articulent autour de la théorie du genre et des rapports sociaux de sexe de Danièle Kergoat, des théories sur l’éducation, du système éducatif et la construction identitaire à l’adolescence. Ces théories sont des outils d’appréhension et d’analyse dans un contexte d’apprentissage de normes et de valeurs précises transmises par l’école et qui influencent les rapports entre les sexes dans la société haïtienne.
Beaucoup de sociologues, psychologues, éducateurs et éducatrices et autres chercheur- e-s, ont développé des théories pour expliquer les rapports sociaux de sexe, ses traces et son influence dans la construction identitaire dans les sociétés. Haïti a toujours été considérée comme un pays traversé par des inégalités de genre criantes. En effet, des études, des essais ou encore des romans à défaut d’un centre de recherche spécialisé relatent le phénomène.
Mirtha Gilbert, Mirtho Célestin-Saurel, Marlène Thélusma Rémy, Mireille Neptune Anglade ont traité cette question. Le peuple haïtien, dans sa majorité, développe une culture qui nourrit des stéréotypes de genre interpellant des théories psychologiques et sociales. Cette situation particulière montre qu’Haïti peut nous révéler des éléments très novateurs sur le processus d’éducation différentielle des adolescent-e-s à l’école secondaire mixte.
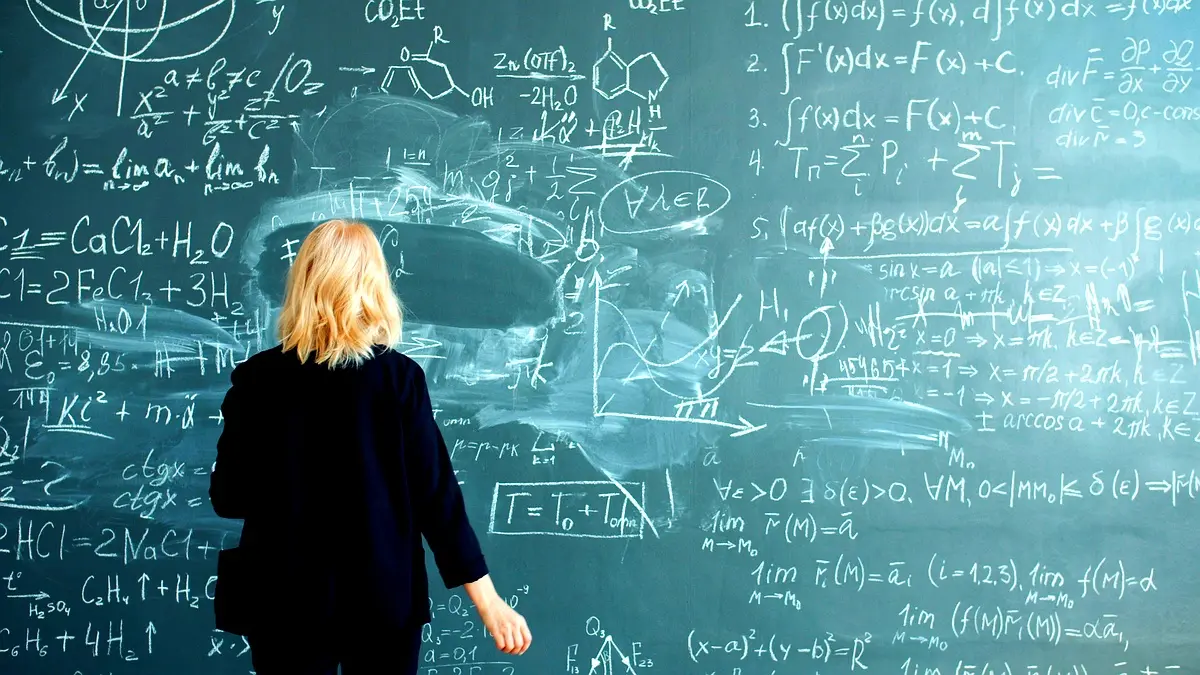
I – Cadrage théorique
1.1.- Dimensions théoriques de la recherche
1.1.1- Le naturalisme et l’infériorisation de la femme
La question féminine a toujours eu une place de choix à travers les écrits globalement et dans la recherche spécifiquement. Elle est inscrite dans des approches qui campent leur vision et l’interprétation du rapport de la femme à l’homme et des rôles qu’ils/elles sont souvent appelés à jouer dans toutes les sphères, qu’elles soient privées ou publiques.
D’où les tenants de l’approche naturaliste qui considèrent les femmes purement et simplement comme un être inférieur, incomplet se positionnant toujours de manière désavantageuse par rapport à l’homme, se confinant majoritairement dans sa fonction reproductive. Depuis l’antiquité et bien avant l’émergence de la problématique de genre proprement dite, des philosophes ont fait valoir leur conception naturaliste de la gent féminine.
Faut-il rappeler que Platon considérait la femme comme une dégénération de la nature humaine et un être totalement inférieur à l’homme. Je cite en référence à ce sujet une citation du philosophe :
« Ce sont les mâles seulement qui sont créés directement par les dieux et à qui l’âme est donnée. Ceux qui vivent des vies sans rectitude retournent vers les étoiles, mais pour ceux qui sont lâches, on peut supposer avec raison qu’ils ont acquis la nature des femmes à la seconde génération. Cette régression peut continuer pendant des générations successives à moins qu’elle ne s’inverse. Dans cette situation, ce sont évidemment seulement les hommes qui sont des êtres humains complets et qui peuvent espérer l’accomplissement ultime ; ce qu’une femme peut espérer au mieux est de devenir homme » (Platon, Timée 90e)3.
3 « La philosophie grecque sur l’infériorité des femmes », traduction de Françoise Bourguignon, http://womenpriest.org/fr/tradition/infe gre.asp, consulté le 20 décembre 2019.
Les hommes sont dotés d’une nature supérieure selon Platon, ils sont constitués différemment, possédant une âme qui surement les habilite d’un plus grand pouvoir. Platon ne fait pas en effet de réserve sur cette différenciation grossière qu’il établit sortant tout droit de la métaphysique et de son imagination. Pire, il fait intervenir les dieux pour parler de prédestination ; ce qui illustre combien le philosophe associe des éléments les plus hétéroclites et surprenants pour prouver l’infériorité des femmes. Tout est bon pour réduire les femmes à une quelconque nature inférieure.
Cette conception naturaliste et discriminante trouve aussi un écho favorable chez Jean Jacques Rousseau, pour qui la femme est tout aussi secondaire :
« Les hommes, par la prérogative de leur sexe et par la force de leur tempérament sont naturellement capables de toutes sortes d’emplois et d’engagements ; au lieu que les femmes, à cause de la fragilité de leur sexe et de leur délicatesse naturelle, sont exclues de plusieurs fonctions et incapables de certains engagements »4.
4 Colette Piau-Gillot, « Le discours de Jean Jacques Rousseau sur les femmes et sa réception critique », https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1981_num_13_1_1346, consulté le 20 décembre 2019.
Pour Rousseau, il y a une frontière nette entre caractère masculin / féminin. Il tente de justifier les rapports inégaux entre les sexes en se basant sur une prétendue différence qui, pour lui, est une donnée naturelle. À travers ses écrits, il campe un modèle féminin passif, dissimulé, instable en reprenant des idées vieilles depuis des siècles qui entrent en contradiction avec l’Égalité qu’il prône, notamment à l’époque des lumières.
Sa conception sur les rapports entre les sexes ne se démarque pas de la métaphysique du XVIIIe siècle, qui se fonde sur la dualité et les rapports opposés entre les sexes.
Il convient de souligner que ces idées tenaces d’une subordination naturelle de la femme persisteront en dépit des acquis de la révolution française ayant vu les femmes se battre de même que les hommes, mais qui après ne sont pas considérées comme des citoyennes au même titre qu’eux. Les conceptions sur la femme XIXe siècle ne sera pas non plus favorable pour les femmes qui peinent à émerger en tant que sujets en dépit de l’évolution dans les pensées et l’industrialisation qui les propulse sur les lieux de travail.
1.1.2- Genre, sexe et sexualité : Une nécessaire interrelation ?
Si la conception de la bicatécorisation sexuelle n’avait jusque-là réveillé trop de soupçons dans les études scientifiques des siècles précédents, le XXe siècle va offrir l’occasion d’une révision et d’une refonte en profondeur de certaines théories. Dans les années 1860-1940, les premières bases d’un avancement réel sont jetées dans les efforts faits dans les études en médecine, en sexologie et autres disciplines scientifiques ou connexes pour déconstruire les idées préconçues visant à établir un certain déterminisme entre « les structures anatomiques, la sexualité et le rôle social » (Dorlin, 2008 :40).
En effet, c’est dans la science médicale que les premières études sont réalisées pour une véritable réflexion sur la sexualité. Quand des médecins, face aux cas d’ « hermaphrodites » de naissance au XXe siècle, vont administrer à ces enfants un traitement médical pour pouvoir leur assigner un sexe unique ; car, ne pouvant pas les classer suivant le schéma bicatégoriel mâle/femelle.
En effet, cette entreprise visera non seulement une pure assignation de sexe, mais aussi, tiendra en vue un comportement hétérosexuel. Les idées acceptées sur le prétendu déterminisme entre sexe biologique, rôles sexuels et identité sexuelle vont davantage préoccuper les sciences sociales avec l’expérience Bruce/Brenda de John Money.
En effet, un petit garçon dénommé Bruce a perdu son sexe accidentellement suite à une intervention chirurgicale ; les parents de celui-ci se donnent une solution plausible en lui faisant changer de sexe grâce à l’administration d’hormones.
Cette expérience a permis à John Money (1960) d’arriver à la conclusion que le sexe biologique ne représente pas un facteur déterminant de l’identité sexuelle des individus. L’expérience Bruce/Brenda tend en même temps à redéfinir les catégories de sexe et repenser non seulement des thématiques fondamentales telles que la façon dont la sexualité a été conçue depuis Freud, mais aussi le sexe et l’identité sexuelle.
D’autres avancées dans les sciences sociales vont s’appuyer ultérieurement sur ces expériences pour redéfinir l’identité sexuelle.
S’appuyant sur cette nouvelle expérience, les auteur.e.s féministes anglo-saxon.ne.s arriveront, les premiers/premières, dans les années 70-90, à la problématisation des rapports entre sexe et genre. L’appréhension du terme genre est dès lors prise dans la foulée des courants marxistes de l’époque et s’entend comme un rapport de domination.
Une acceptation du genre comme une caractéristique incontestable de l’identité individuelle propre suivra. Il faut attendre les années 1970 pour concevoir le genre en termes de rapport de domination, avec à l’avant-garde le texte de Ann Oakley, « Sex, Gender and Society » (1972), qui établit une nette frontière entre sexe entendu comme les propriétés biologiques innées et genre comme processus d’attribution sociale, de construction de la féminité et de la masculinité.
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux thèmes de l’éducation différentielle en Haïti ?
Les principaux thèmes de l’éducation différentielle en Haïti incluent l’adolescence, les rapports sociaux de genre, et la construction identitaire.
Comment le cadre théorique influence-t-il l’éducation en Haïti ?
Le cadre théorique influence l’éducation en Haïti en fournissant des outils d’appréhension et d’analyse des normes et valeurs transmises par l’école, qui influencent les rapports entre les sexes.
Quelles théories sont utilisées pour analyser les rapports sociaux de sexe en Haïti ?
Les théories utilisées pour analyser les rapports sociaux de sexe en Haïti incluent la théorie du genre de Danièle Kergoat et d’autres théories sur l’éducation et la construction identitaire à l’adolescence.