Les implications politiques de l’audit fiscal révèlent des enjeux cruciaux pour les PME, souvent méconnus. En explorant les risques fiscaux, cette recherche propose une démarche novatrice pour les experts-comptables, transformant ainsi leur approche et renforçant la valeur ajoutée pour leurs clients.
§ 1. L’audit fiscal repose sur une classification des choix fiscaux
L’efficacité fiscale de l’entreprise est la résultante de décisions fiscales, ou d’implications fiscales de décisions juridiques qui contribuent chacune, mais de façon inégale, à l’efficacité fiscale.
59 Op. cit, page 71.
60 Op. cit, page 71.
61 Op. cit, page 72.
62 M.Chadefaux, L’audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.72.
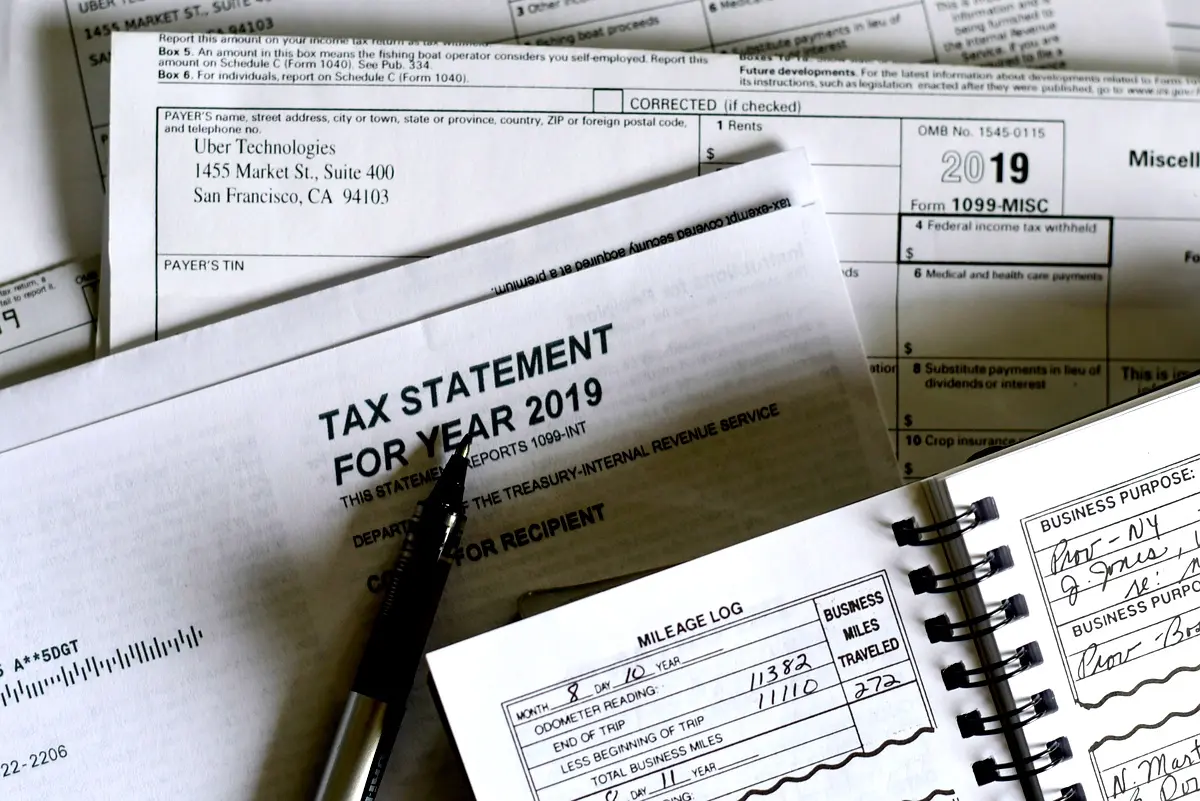
Dans le cadre d’un audit contractuel, compte tenu des contraintes de temps et de l’impossibilité matérielle de passer en revue l’ensemble des choix exercés par l’entreprise, l’auditeur accordera en priorité son attention aux décisions de l’entreprise à forte incidence fiscale.
L’intérêt aussi de la distinction entre choix stratégiques et choix tactiques réside dans la détermination de l’approche d’audit à appliquer.
En s’inspirant de l’audit financier, l’auditeur fiscal devrait appliquer pour les opérations non courantes une stratégie corroborative (techniques d’audit de compliance et d’opportunité extensifs ou étendus) du fait que le risque lié au contrôle est maximum ou très proche de ce maximum.
Pour les choix fiscaux tactiques, l’approche à adopter par l’auditeur fiscal varie en fonction de la fiabilité du système de contrôle interne fiscal. En effet, si l’auditeur fiscal estime que les mécanismes de contrôle sont effectivement efficaces et appliqués d’une façon qui justifie le faible niveau du risque lié au contrôle, il pourrait prévoir des tests d’audit de compliance et d’opportunité restreints ou limités.
Toutefois, si l’auditeur fiscal estime que les contrôles sont inefficaces ou inexistants, il devrait appliquer une stratégie corroborative.
On peut donc, dans ces conditions, différencier les choix fiscaux en fonction de leur portée, en distinguant ainsi les décisions qui correspondent au choix des orientations fiscales majeures de l’entreprise, c’est-à-dire les choix qui détermineront les caractéristiques fiscales de l’entreprise, des choix de gestion courante, de portée fiscale plus limitée mais qui peuvent ponctuellement procurer un avantage à l’entreprise.
Deux niveaux de choix se dégagent alors des choix stratégiques et des choix tactiques.
- Choix stratégiques
Les choix fiscaux stratégiques sont des choix dont la portée fiscale est importante. Parmi les choix stratégiques, on retrouvera notamment:
-le choix du régime de l’intégration des résultats prévu par l’article 49 bis du code de l’IRPP et de l’IS63;
-le choix du régime applicable aux opérations de transmission et de restructuration64;
63 Toute société qui détient directement ou indirectement au moins 75% du capital d’autres sociétés peut opter en sa qualité de société mère pour son imposition à l’impôt sur les sociétés sur la base de l’ensemble des résultats réalisés par elle et par les autres sociétés.
Le bénéfice du régime de l’intégration des résultats est subordonné à la satisfaction des conditions prévues par la section 5 prévue par l’article 30 de la loi de finances n°2000-98 du 25 décembre 2000.
64 Le régime d’avantages fiscaux prévu pour les opérations de restructuration est prévu par les articles suivants:
-Article 49 decies du code de l’IRPP et de l’IS,
-Article 9-IV-4 du code de la TVA,
-Article 5, alinéa 3 de la loi n°88-62 du 02 Juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation,
-Article 23-I du CDET.
-l’implantation d’une entreprise dans une zone de développement régional pour le bénéfice des avantages accordés auxdites zones65;
-le choix de l’admission pour les sociétés de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse sous certaines conditions66;
-la possibilité laissée aux entreprises à une réévaluation libre de leurs bilans67.
L’exercice de tels choix présente différentes caractéristiques. En premier lieu, ces choix peuvent être de nature purement fiscale mais peuvent emprunter à d’autres domaines du droit et tout particulièrement le droit des sociétés.
De ce point de vue, si le but à atteindre est fiscal, il peut dans certaines situations être atteint en exerçant des choix fiscaux mais également en exerçant des choix de nature strictement juridique dont les effets fiscaux sont cependant conformes au but poursuivi68.
Ensuite, les choix stratégiques, compte tenu de leur portée, ne sont pas généralement exercées par la fonction fiscale de l’entreprise ou la direction financière, mais par la direction de l’entreprise.
Le choix stratégique produit des effets au-delà du seul champ fiscal (implications juridiques, financières, économiques, etc.). C’est pourquoi la solution finalement adoptée ne sera pas nécessairement la solution fiscalement la plus judicieuse pour l’entreprise.
Enfin, l’exercice de choix fiscaux stratégiques commande de procéder de manière systématique à l’évaluation proprement dite du choix. Quelles sont les contreparties ou les engagements qui en résultent pour l’entreprise ? L’entreprise a-t-elle les compétences internes pour maîtriser les obligations
65 Les avantages accordés aux zones de développement régional sont prévus par les articles 23, 24, 25 et 26 du Code d’Incitations aux Investissements.
La liste des zones d’encouragement au développement régional est fixée par le décret n°99-483 du 1er Mars 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n°2008-387 du 11 Février 2008.
66 Le taux de l’IS prévu par le paragraphe I de l’article 49 du code de l’IRPP et de l’IS est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse à condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de l’année d’admission.
Les modalités et conditions de la réduction du taux de l’IS sont prévus par la loi n°99-92 du 17 Août 1999.
67 La réévaluation libre n’est pas interdite du point de vue juridique. Toutefois, elle entraîne les conséquences fiscales suivantes:
-La plus-value dégagée par une réévaluation libre, n’ayant pas le caractère d’un bénéfice réalisé, est exclue de l’assiette de l’impôt au titre de l’exercice de sa constatation comptable.
Néanmoins, si l’entreprise procède à l’incorporation de la réserve de réévaluation libre ou à sa distribution, cette dernière devient soumise à imposition.
En outre, les pertes d’exploitation imputées sur la réserve de réévaluation libre demeurent reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs s’il existe d’autres réserves d’un montant équivalent à la dite imputation. En cas d’absence de réserve de réévaluation libre, l’imputation des reports déficitaires sur la réserve de réévaluation libre rend imposable ladite réserve à concurrence du montant imputé.
-Le bénéfice imposable en cas de cession d’un bien ayant subi la réévaluation libre est constitué pour les éléments amortissables par la différence entre le prix de cession de l’élément considéré et sa valeur comptable nette sans tenir compte des effets de la réévaluation.
Néanmoins, dans le cas où la réserve de réévaluation libre a subi l’impôt, le plus ou moins-value de cession s’apprécie par rapport à la nouvelle valeur réévaluée et non pas par rapport à la valeur historique.
-L’amortissement pris en compte fiscalement est l’amortissement de la valeur avant réévaluation libre.
68 J.L.Rossignol, Tran Thi Kim Anh, « La gestion du risque fiscal inhérent à l’implantation d’une entreprise dans un pays émergent: le cas Français au Vietnam » , 2008.
nouvelles qui résulteront du choix exercé au plan fiscal mais aussi dans le domaine comptable ou financier? Le choix envisagé est-il irrévocable ou l’entreprise conserve-t-elle la possibilité de rétablir la situation antérieure? Le choix envisagé est-il sûr et l’entreprise ne risque-t-elle pas une remise en cause de la part de l’administration fiscale sur le terrain par exemple de l’abus de droit ou de l’acte anormal de gestion ? En d’autres termes, le choix fiscal retenu ne risque-t-il pas d’alimenter l’insécurité fiscale de l’entreprise? Autant de critères qui doivent être pris en considération dans le processus d’évaluation des choix fiscaux stratégiques de l’entreprise.
- Choix tactiques
Les choix fiscaux tactiques sont des choix qui sont de nature à procurer un avantage financier à l’entreprise, généralement à brève échéance, mais dont la portée reste limitée. Il s’agit pour l’essentiel de choix qui procèdent de la technique fiscale.
Leur importance ne doit cependant pas être négligée car leur exercice systématique et réfléchi peut à terme procurer un avantage distinctif à l’entreprise concernée69.
Les choix tactiques sont les choix de la gestion courante procurant à l’entreprise des avantages sans pour autant être déterminants des caractéristiques fiscales de l’entité. Leur contrôle est rapide, souvent technique et limité au seul domaine fiscal.
Nous citons à titre d’exemple, le choix d’une méthode d’amortissement, etc.
Généralement, ces choix tactiques résultent de l’exercice d’options explicitement contenues dans la loi fiscale. C’est le législateur qui, en pleine connaissance de cause, offre une possibilité d’option aux entreprises70.
Dans d’autres cas, l’option offerte relève non d’une disposition de la loi mais d’une tolérance de l’administration fiscale qui admet une application assouplie de tel ou tel dispositif.
Dans le même ordre d’idée, il faut également prendre en considération les silences éventuels de la réglementation fiscale sur le traitement de telle ou telle opération, silences qui peuvent être utilisés par l’entreprise au mieux de ses intérêts.
Finalement, entre des choix stratégiques dont l’enjeu est particulièrement important et des choix tactiques fort nombreux, et que l’entreprise maîtrise pour cette raison plus difficilement, le maniement des choix fiscaux se révèle très délicat.
Ces difficultés justifient que l’entreprise confie à un spécialiste le contrôle des choix fiscaux afin de s’assurer de l’opportunité des décisions fiscales de l’entreprise. L’efficacité fiscale appelle un contrôle des choix fiscaux.
§ 2. Le contrôle des choix fiscaux
69 J.L.Rossignol, Tran Thi Kim Anh, »La gestion du risque fiscal inhérent à l’implantation d’une entreprise dans un pays émergent: Le cas Français au Vietnam », 2008.
70 J.L.Rossignol, La gestion fiscale de l’entreprise, 2008.
L’existence de choix fiscaux est à rapprocher du comportement de l’entreprise. Si l’entreprise ignore les possibilités que lui offre directement ou indirectement la législation fiscale, il en résulte un comportement passif qui peut lui être préjudiciable.
Si en revanche, l’entreprise manifeste une attitude active devant les choix fiscaux, elle peut alors exercer de bons ou de mauvais choix71.
Le rôle de l’audit est précisément de mettre en évidence les carences qui résultent d’un comportement passif de l’entreprise ou de signaler les erreurs liées à des choix a priori exercés en connaissance de cause.
L’audit fiscal doit ainsi permettre de sensibiliser l’entreprise à l’importance de l’écart existant entre l’efficacité fiscale potentielle et l’efficacité fiscale atteinte72.
De cette façon, l’entreprise doit adopter des mesures qui doivent lui permettre de tendre vers l’optimisation de ses choix fiscaux, d’améliorer graduellement son efficacité fiscale.
Progressivement, l’entreprise doit devenir, selon la formule de M.Cozian, un contribuable avisé qui manie la fiscalité « à un niveau supérieur ».
En consentant un tel effort, l’entreprise évite une déperdition de ses ressources qui serait due à une sous optimisation de ces décisions fiscales.
Le contrôle des choix fiscaux ne se limite pas à un simple constat sur le niveau d’efficacité fiscale dont fait preuve l’entreprise.
Comme le contrôle de la régularité a des vertus préventives, le contrôle de l’efficacité contribue au renforcement de l’efficacité fiscale de l’entreprise.
Il y contribue non seulement en vérifiant l’aptitude de l’entreprise à exercer le bon choix fiscal, mais aussi en mettant en évidence les choix méconnus de l’entreprise.
De cette façon, l’audit enrichit l’éventail des choix à la disposition de l’entreprise, et par voie de conséquence, le potentiel d’efficacité fiscale.
Le contrôle des choix fiscaux apparaît ainsi comme un facteur d’efficacité73.
Ce second volet de la mission d’audit fiscal doit mettre en exergue les opérations que l’entreprise pourrait ou aurait pu traiter fiscalement de façon plus opportune.
L’efficacité fiscale de l’entreprise repose sur la recherche de trois types d’avantages distincts74 (fiscaux, financiers ou de fonctionnement) au travers des choix stratégiques ou des choix tactiques qu’exerce l’entreprise.
________________________
62 M.Chadefaux, L’audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.72. ↑
63 Toute société qui détient directement ou indirectement au moins 75% du capital d’autres sociétés peut opter en sa qualité de société mère pour son imposition à l’impôt sur les sociétés sur la base de l’ensemble des résultats réalisés par elle et par les autres sociétés. ↑
64 Le régime d’avantages fiscaux prévu pour les opérations de restructuration est prévu par les articles suivants: ↑
65 Les avantages accordés aux zones de développement régional sont prévus par les articles 23, 24, 25 et 26 du Code d’Incitations aux Investissements. ↑
66 Le taux de l’IS prévu par le paragraphe I de l’article 49 du code de l’IRPP et de l’IS est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse à condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de l’année d’admission. ↑
67 La réévaluation libre n’est pas interdite du point de vue juridique. Toutefois, elle entraîne les conséquences fiscales suivantes: ↑
68 J.L.Rossignol, Tran Thi Kim Anh, « La gestion du risque fiscal inhérent à l’implantation d’une entreprise dans un pays émergent: le cas Français au Vietnam » , 2008. ↑
69 J.L.Rossignol, Tran Thi Kim Anh, »La gestion du risque fiscal inhérent à l’implantation d’une entreprise dans un pays émergent: Le cas Français au Vietnam », 2008. ↑
70 J.L.Rossignol, La gestion fiscale de l’entreprise, 2008. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les choix fiscaux stratégiques dans l’audit fiscal?
Les choix fiscaux stratégiques sont des choix dont la portée fiscale est importante, tels que le choix du régime de l’intégration des résultats, le régime applicable aux opérations de transmission et de restructuration, et l’implantation d’une entreprise dans une zone de développement régional.
Comment l’auditeur fiscal détermine-t-il son approche d’audit?
L’auditeur fiscal détermine son approche en fonction de la fiabilité du système de contrôle interne fiscal et de l’importance des choix fiscaux, en appliquant des stratégies corroboratives ou des tests d’audit de compliance et d’opportunité.
Pourquoi est-il important de distinguer entre choix stratégiques et tactiques en audit fiscal?
Il est important de distinguer entre choix stratégiques et tactiques pour déterminer l’approche d’audit à appliquer, car les choix stratégiques ont une portée fiscale plus importante que les choix tactiques.