L’impact du rapport d’audit sur le marché révèle des insights surprenants sur la prise de décision financière. Cette recherche met en lumière comment les réserves dans ces rapports influencent les choix d’investissement, transformant ainsi la perception des acteurs du marché.
Les études de réaction concernant l’impact du contenu informatif du rapport d’audit sur le marché financier
Le rapport d’audit a fait l’objet de plusieurs études de réaction. Elles révèlent que ce rapport a un contenu informationnel et donc utile à la prise de décision d’investissement notamment quant il contient certaines réserves.
En dépit de l’intérêt de ces études qui tentent de présenter la communication établie par le rapport d’audit, elles traitent cependant des problématiques assez diversifiées.
Etant donné que ces études sont construites à partir d’une méthodologie de recherche reconnue en finance : la méthodologie des études d’événement, nous allons présenter notre revue de littérature en suivant cette démarche généralement poursuivie par les auteurs.
Par conséquent, on présentera d’abord la problématique de chaque étude et la question à laquelle elle essaye de répondre. Ensuite on va définir la méthodologie de recherche employée par les auteurs. Enfin, on procédera à la synthèse des résultats obtenus par ces différents travaux de recherche.
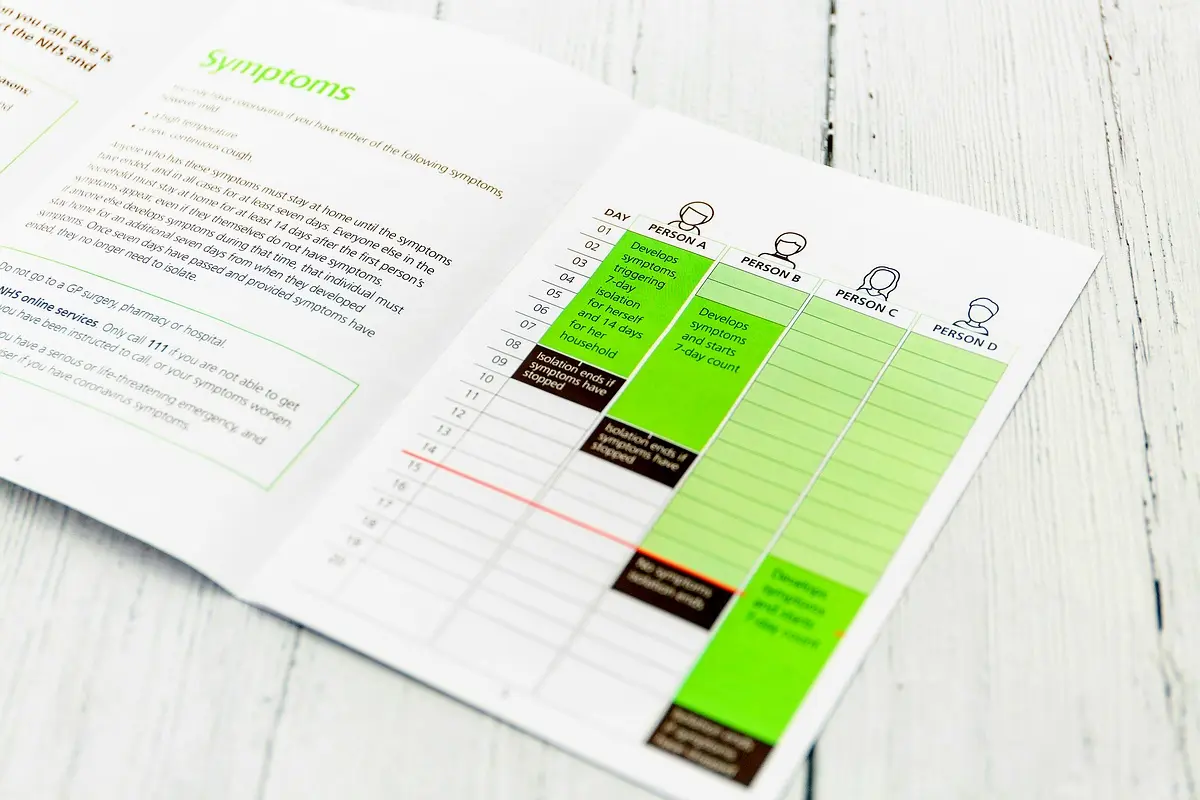
Principes et problématiques
Le principe de ces études est de tester la réaction du marché financier à la divulgation de l’opinion de l’auditeur, qui est le plus souvent publiée avec réserves, étant donné que le déroulement normal de la vie des affaires s’accompagne par l’émission de la part de l’auditeur d’un rapport sans réserves.
La mesure de cette réaction est fournie par la différence entre la rentabilité du titre concerné et sa rentabilité attendue en l’absence de l’événement, c’est à dire si aucune réserve d’audit n’est formulée. Ces recherches permettent ainsi de comparer la réaction des investisseurs face aux différentes opinions qui peuvent être exprimées par les auditeurs.
Il est à noter que la démarche de ces études est basée sur l’hypothèse faite à priori que la publication par l’auditeur d’un rapport avec réserves doit avoir un impact sur les cours boursiers des titres de la société concernée.
En effet, une réserve fournit aux investisseurs des éléments nouveaux d’appréciation de la situation financière réelle de l’entreprise. Elle peut aussi indiquer aux utilisateurs des états financiers que la société aura à engager un certain nombre de frais pour régulariser une pratique comptable contestable, ou procéder à une réorganisation. On s’attend ainsi à observer une réaction plutôt négative du marché à la publication d’une réserve.
Le principe de cette approche relève de l’hypothèse d’efficience des marchés (Fama 1970) qui prévoit qu’un marché efficient est celui qui réagit rapidement à l’information nouvelle rendue publiquement disponible à tout investisseur à un coût relativement bas.
En matière de contenu informationnel du rapport d’audit, de nombreuses voies d’investigation ont été adoptées.
Certains auteurs ont concentré leurs travaux sur une seule catégorie de réserve.
En effet, certains chercheurs ont consacré leurs travaux à l’analyse de l’impact de la réserve liée aux changements de méthodes ou de principes comptables : une question ayant fait l’objet de débats très controversés aux Etats-Unis.
Ainsi, Baskin (1972) a mené une recherche empirique sur la bourse de New York, en recensant toutes les entreprises ayant opéré un changement de méthode comptable entre 1966 et 1969. Afin d’examiner le contenu informationnel perçu relatif aux changements de méthodes comptables, sous l’hypothèse du marché efficient, l’auteur a sélectionné les firmes dont le rapport d’audit portait la mention de cette exception.
De même, Mittelstaedt et al. (1992) se sont intéressés à l’incidence de la révélation d’un changement de méthode comptable. Ils ont analysé l’évolution des cours en bourse de deux échantillons d’entreprises classées selon qu’elles avaient fait l’objet d’une réserve ou non.
Parallèlement, plusieurs recherches s’inscrivent dans le débat touchant au contenu informationnel de la réserve « subject to » dans laquelle l’auditeur exprime l’opinion que les états financiers sont fiables en dépit de certaines incertitudes dont l’effet n’a pas été correctement intégré lors de l’établissement des comptes de l’entreprise.
Elliott (1982) a classé les réserves « subject to » en quatre catégories :
- Continuité d’exploitation (going concern) souvent émise à la suite d’événements économiques défavorables (problèmes de production, perte de contrats …).
- Réalisation des actifs (asset realization) qui signifie que l’auditeur est en désaccord avec la direction sur la valeur de réalisation d’un actif.
- Litige (litigation) pour lesquelles l’incertitude est liée à l’issue d’un procès.
- Réserve concernant le niveau de consommation d’énergie (utility rate) dans le cas des sociétés de gaz et d’électricité.
Dodd et al. (1984), quant à eux, ont classé les réserves « subject to » comme suit :
- Litige (litigation)
- Evaluation des actifs (asset realization)
- Incertitudes multiples (multiple uncertainty) : dans de tels cas, les auditeurs et managers sont en désaccord sur plusieurs points.
- Mode de financement (future financing) : qui exprime un doute sur les possibilités pour l’entreprise de se procurer des fonds à l’avenir.
Dans ce sens, Elliott (1982), et Loudder et al. (1992), se sont intéressés exclusivement à l’impact des réserves « subject to » rendues publiques sur le marché américain, respectivement entre 1973 et 1978, et de 1983 à 1986.
Dans une étude comparable à celle d’Elliott (1982), Davis (1982) a essayé de vérifier si la réserve « subject to » peut contenir une information additionnelle utile à la prise de décision d’investissement.
Dopuch et al. (1986), quant à eux, ont tenté d’examiner l’association entre les rendements boursiers anormaux négatifs et la divulgation dans la presse de la réserve « subject to » sur la période 1970-1982.
D’un autre côté, l’étude de Chen et Church (1996) a eu pour objectif de tester le pouvoir de la réserve « going concern » de prédire la faillite de la société concernée.
Dans une étude différente des précédents, Banks et Kinney (1982) ont essayé de fournir une preuve empirique de la distribution des prix de marché des actions conditionnées par l’aspect quantitatif et qualitatif des résultats comptables.
Cette recherche prend en considération deux variables supplémentaires non retenues par les autres études : le signe des résultats (bénéfice ou perte) et la présence éventuelle de la réserve dite « d’incertitude » dans l’annexe alors que le rapport d’audit ne la contient pas.
D’autres chercheurs, ont comparé l’influence sur les rendements boursiers de différents rapports d’audit contenant divers types de réserves.
Parmi les premiers à traiter cette question, Firth (1978) qui a réalisé une étude dont l’objectif est de mesurer l’impact de la divulgation de l’opinion de l’auditeur avec réserves sur le prix des actions dans l’environnement britannique.
Pour atteindre cet objectif, l’auteur a observé les rendements des titres de toutes les sociétés britanniques cotées ayant fait l’objet d’une réserve entre 1974 et 1975. Il a ainsi pu analyser l’influence des six réserves les plus couramment exprimées en Grande-Bretagne :
- Image fidèle : les auditeurs doivent apprécier si les comptes présentés aux actionnaires donnent une image fidèle de l’état des affaires de l’entreprise à la date de l’arrêté des comptes et si les postes de charges et de produits donnent une image fidèle des pertes et profits de la période couverte par les états financiers présentés.
- Audit des filiales : ce type de réserve se justifie si les comptes d’une filiale n’ont pas été contrôlés, ou l’ont été par un cabinet sans renom.
- Non-conformité avec les principes comptables : cette réserve signale que les comptes de l’entreprise n’ont pas été établis conformément aux normes imposées pour les sociétés cotées : les SSAP, émises par l’IASC.
- Répétition de réserves : si les états financiers des deux exercices précédents avaient déjà donné lieu au même commentaire de la part de l’auditeur, il doit en faire mention dans son rapport.
Continuité d’exploitation
- Valorisation des actifs
- Selon une démarche comparable, Ball et al. (1979) ont examiné l’effet de la publication des rapports d’audit avec réserves dans le marché australien sur les jugements que portent les investisseurs sur les valeurs boursières. Ils ont émis l’idée que les auditeurs hésitent souvent à émettre des réserves dans la mesure où ils pensent que la publication de celles-ci aura un effet négatif sur les décisions des investisseurs.
- Leur analyse a porté sur l’ensemble des différentes formulations de rapports avec réserves des sociétés cotées entre 1965 et 1972 que les auteurs ont classé en sept catégories distinctes :
- Dépréciation des bâtiments : la norme D5 publiée par L’ICAA en novembre 1970 a imposé aux entreprises de pratiquer un amortissement sur les constructions, contrairement à la pratique australienne : ceci explique que de nombreuses réserves concernant cette règle comptable aient été formulées sur la période de référence pour cette étude.
- Provision pour imposition différée : un grand nombre de cas de désaccords entre auditeurs et dirigeants d’entreprises sont nés de la norme D4 publiée elle aussi en novembre 1970, et précisant les recommandations de l’ICAA en matière de calcul de provision pour imposition différée.
- Evaluation des titres détenus ou créances vis à vis des filiales
- Provision pour dépréciation des créances douteuses
- Changement des méthodes comptables
- Valorisation des actifs
- Réserves multiples
Dodd et al. (1984) sont parvenus, quant à eux, à trouver une solution en développant une méthodologie originale. Cette méthodologie a consisté d’une part, à identifier avec une grande précision la date d’annonce, et d’autre part, à choisir un échantillon leur permettant d’analyser les effets sur les cours des divers types de réserves émises par l’auditeur sur deux principales places boursières Américaines (NYSE et ASE) entre 1973 et 1980.
L’objet de l’étude est d’examiner les rendements anormaux des actions survenus pendant la période d’annonce des principales catégories de réserves prévus par les normes d’audit américaines. Sont ainsi envisagées les réserves suivantes :
- Disclaimers of opinion : ces réserves correspondent aux « refus de certifier » (ou dénégation de responsabilité) des normes françaises de commissariat aux comptes.
Elles sont prononcées s’il y a une incertitude relevée ayant des effets potentiels tels que l’auditeur ne s’estime pas en mesure de certifier les comptes.
- Subject to : Litige, Evaluation d’actif, Incertitudes multiples et Mode de financement.
Plus récemment, Soltani (1996) a réalisé une recherche similaire sur le marché français en observant les conséquences boursières de toutes les réserves publiées par les commissaires aux comptes des sociétés cotées à Paris entre 1980 et 1990.
Dans cette recherche, les opinions exprimées par les auditeurs sont réparties en quatre grands groupes : les rapports sans réserves et sans observations ; les rapports avec réserves ; les rapports avec observations, remarques et constatations ; et enfin les rapports avec « refus de certification ».
Il est à noter que Soltani (1996) a intégré dans sa recherche les réserves pour :
- Incertitudes : suivant Soltani (1996) « Dans certaines circonstances, les dirigeants de l’entreprise ne disposent pas d’informations suffisantes pour prendre une décision concrète, par exemple en cas de risques provisionnés avec approximation, le commissaire aux comptes ne peut pas, dans cet exemple, obtenir des éléments probants suffisants pour justifier la décision des dirigeants en matière de provision. En outre, un risque concernant la continuité d’exploitation peut constituer un cas particulier d’incertitude ».
- Limitation des travaux : suivant Soltani (1996) « selon les normes de la CNCC, il y a lieu d’émettre cette réserve lorsqu’il y a impossibilité pour le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les diligences qu’il a estimé nécessaires et notamment celles qui concernent la collecte d’éléments probants ».
- Désaccord sur les principes comptables : Suivant Soltani (1996) « cette réserve est émise lorsque le commissaire aux comptes ayant mis en œuvre les diligences qu’il a jugé nécessaires, constate une irrégularité comptable que la direction refuse de corriger. Ce désaccord est suffisamment significatif pour avoir un impact sur la certification ».
Non-comptabilisation d’opérations et provisions
- Non-conformité avec les principes consolidés.
L’auteur a ainsi pris en compte dans son étude, non seulement les anomalies ou désaccord ayant fait l’objet de réserves, mais aussi ceux qui ont simplement été relevés par des observations ou des remarques. Toutefois, il est intéressant de rappeler que les réserves les plus présentes dans les rapports étudiés lors de cette recherche sont les trois premières citées ci-dessus.
Dans une recherche différente de celles exposées précédemment, Melumad et Ziv (1997) ont tenté d’observer la réaction du marché financier à la publication des réserves. La particularité de cette étude réside dans le fait que les auteurs ont distingué entre deux types de réserves seulement :
- Les réserves non évitables : qui sont celles que le manager ne peut pas éviter par la rectification ou la correction des états financiers. Elles visent notamment les réserves quant à la continuité d’exploitation et les financements futurs des entreprises en difficultés.
- Les réserves évitables : qui désignent celles qui peuvent être évitées par correction des états financiers avant approbation par l’assemblée des actionnaires et donc elles font l’objet de négociation entre l’auditeur et le dirigeant. Concrètement, il s’agit des réserves autres qu’inévitables.
Il est à signaler que cette approche a le mérite d’une part, d’intégrer le dirigeant en tant qu’élément déterminant de la problématique « opinion d’audit-réaction du marché financier » et d’autre part, de classer d’une autre façon les opinions de réserve et sortir du classement classique prévu par les organismes professionnels : « subject to »; « disclaimer of opinion » « going concern ».
Dans une étude fondée sur une méthodologie originale, Mutchler (1985) examine la relation entre la réserve « going concern» et l’information publiquement disponible. L’auteur a cherché à déterminer dans quelle mesure les décisions des auditeurs d’émettre cette réserve peuvent être anticipées en utilisant l’information publiquement disponible.
Pour compléter cette présentation, il convient d’évoquer les travaux de Fields et Wilkins (1991) qui ont choisi d’orienter leur recherche selon une direction opposée à l’ensemble des études que nous venons de citer.
Au lieu de mesurer l’impact sur les cours de la « mauvaise nouvelle» que constitue à priori la publication d’un rapport d’audit avec réserves, ils se sont intéressés aux conséquences boursières d’une information a priori favorable à l’entreprise, la publication d’un rapport d’audit sans réserves après un ou plusieurs exercices d’opinion réservée. Les auteurs ont recensé pour cela tous les retraits de réserves annoncés entre 1978 et 1987.
Après ce rapide aperçu des principales études menées au sein de ce courant de recherche, il convient d’étudier de plus près la méthode de recherche employée pour ces travaux.
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quel est l’impact du rapport d’audit sur le marché financier ?
Le rapport d’audit a un contenu informationnel utile à la prise de décision d’investissement, notamment lorsqu’il contient certaines réserves, ce qui peut influencer la rentabilité des titres concernés.
Comment le marché réagit-il à un rapport d’audit avec réserves ?
La publication d’un rapport d’audit avec réserves est attendue pour avoir un impact négatif sur les cours boursiers, car elle fournit aux investisseurs des éléments nouveaux d’appréciation de la situation financière réelle de l’entreprise.
Quelle méthodologie est utilisée pour étudier l’impact du rapport d’audit ?
Les études sur l’impact du rapport d’audit sont généralement basées sur la méthodologie des études d’événement, qui teste la réaction du marché à la divulgation de l’opinion de l’auditeur.