Les mouvements sociaux en Haïti révèlent des dynamiques complexes souvent méconnues. Cette étude met en lumière des photographies emblématiques de l’occupation américaine (1915-1920), offrant une perspective inédite sur les représentations sociopolitiques et les engagements collectifs de l’époque, avec des implications cruciales pour notre compréhension actuelle.
La notion de mouvement social
Tout d’abord, à notre sens, parler du mouvement social c’est faire référence à un vaste mouvement d’un groupe (ensemble) d’individus défendant un objectif ou des intérêts communs. Cela aurait rapport à un engagement collectif en évolution. En effet, aborder le mouvement social comme concept scientifique sans faire référence aux travaux du sociologue Alain Touraine, vers la fin du XXème siècle, serait un non-sens. Selon Touraine, « les mouvements sociaux expriment une volonté collective ». Ils parlent d’eux même comme « agents de la liberté, de légalité, de la justice sociale ou de l’indépendance nationale ou encore comme appel à la modernité ou à la libération
des forces nouvelles dans un monde de traditions, de préjugés et de privilèges et ceux qui s’intéressent à eux se sentent portés par le même mouvement à l’assaut de l’ordre établi. Les mouvements sociaux ne sont pas des évènements dramatiques et exceptionnels : ils sont de manière permanente au cours de la vie sociale. Ils sont la trame de la société »111.
Celui-ci affirme en premier lieu : « Je définis les mouvements sociaux comme des conduites socialement conflictuelles mais orientées et non pas comme la manifestation des contradictions objectives d’un système de domination ». En second lieu, l’action des mouvements sociaux n’est pas dirigée fondamentalement vers l’Etat, ne pas être identifiée à une action politique pour la conquête du pouvoir, elle est une action de classe, dirigée contre un adversaire proprement social. Enfin, un mouvement social n’est pas le créateur d’une société plus moderne ou plus avancée que celle qu’il combat, il défend, dans un champ culturel et historique donné, une autre société112.
Le mouvement social est la conduite collective organisée d’un acteur luttant contre son adversaire pour la direction sociale de l’historicité dans une collectivité concrète, poursuit-il113. La représentation des mouvements sociaux que nous a léguée la société industrielle est la suivante : une domination impose des lois, des croyances et un régime politique autant qu’un système économique ; le peuple les subit mais se révolte contre eux quand ils le menacent dans son existence physique et culturelle114.
Une telle vision s’oppose à l’idée de mouvement social, telle que je le définis sur deux points essentiels. En premier lieu, il n’introduit jamais l’image d’un acteur historique, c’est-à-dire guidé par des orientations normatives, par un projet, c’est-à-dire par un appel à l’historicité. L’acteur populaire n’est que l’expression de contradiction sociale ou le porteur des forces naturelles, il n’est pas un acteur social115.
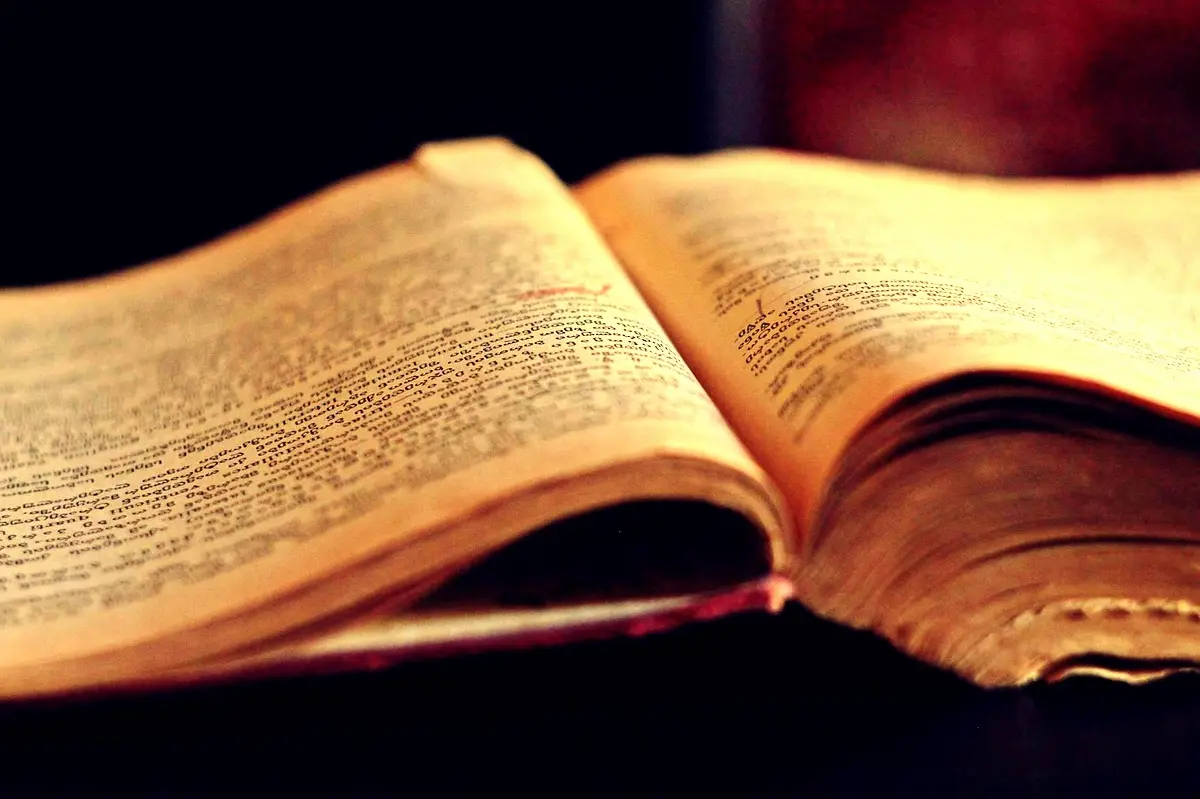
Il est vrai qu’un mouvement populaire n’est pas un héros armé, cavalcadant à la tête d’une armée sur un champ de bataille où les adversaires se heurteraient presque à armes égales ; il est vrai aussi que la domination décompose la capacité d’action et d’organisation du dominé. Mais, il faut reconnaitre d’abord l’existence d’une action orientée, celle d’une classe qui n’est pas seulement dominée, qui participe à un champ
d’historicité, qui lutte pour le contrôle et pour se réapproprier la connaissance, les investisseurs et le modèle culturel que la classe dirigeante a identifié à ses propres intérêts.
En second lieu, les conduites collectives reconnues par la pensée sociale de l’époque industrielle sont définies historiquement ou naturellement. Leur sens ne se trouve pas dans la société présente mais celle de l’avenir116.
Entre autres, Touraine affirme : « Le mouvement social y est présenté comme la combinaison d’un principe d’identité, d’un principe d’opposition et d’un principe de totalité. Ce qui caractérise un mouvement social c’est d’abord que l’enjeu y est historicité elle-même et non pas la décision institutionnelle ou la norme organisationnelle et que les acteurs sont donc les acteurs historiques définis par leurs rapports conflictuels à historicité ; c’est ensuite que l’interdépendance des enjeux et des acteurs marquée dans la forme triangulaire du schéma y est
totale, alors qu’elle ne l’est jamais dans les autres types de conduites collectives117. En outre, il a apporté des précisions sur ce que le mouvement social n’est pas pour aboutir à ce qu’il est. Selon lui, « Un mouvement social ne peut jamais être défini par un objectif ou un principe.
Un mouvement social ne peut être défini comme l’agent d’un changement bloqué. Il se situe à l’intérieur d’un système social dont ils contestent les forces dominantes et leurs appuis politiques ou culturels. Il vise davantage un renversement qu’un changement118.
Un mouvement social n’intervient donc pas seul, n’est jamais complètement séparé de revendications et des pressions, de crises et de ruptures qui donnent naissance à des types de différents luttes. J’appelle, déclare Touraine, luttes toutes les formes d’actions conflictuelles organisées menées par un acteur collectif contre un adversaire pour le contrôle du champ social. Les caractéristiques d’une lutte : d’abord elle doit être menée au nom d’une population concernée. En second lieu, les luttes doivent être organisées et ne pas exister seulement au niveau de l’opinion… en troisième lieu, il doit combattre un adversaire qui peut être présenté par un groupe social, même si, l’adversaire est défini en termes plus abstraits : capitalisme ou l’état119. Selon
Touraine, La première composante des luttes et la plus visible est la défense du pays. Ce qui se défend est une collectivité concrète120…
Michel Hector a utilisé la notion de mobilisation populaire. Selon lui, cette notion, comprise dans le sens de mouvement populaire, prend d’ordinaire une dimension considérable. Plusieurs éléments doivent être pris en considération par exemple le nombre, la composition, l’organisation, l’orientation idéologique, les revendications, aussi que l’origine sociale de la direction, les formes et les terrains de lutte, tous éléments que l’on doit, cas par cas, déterminer, mesurer et pondérer dans le déroulement des évènements.
D’une manière générale, la mobilisation populaire se réfère aux types d’action collective, réalisée de façon violente ou pacifique par des ensembles importants de citoyens ou d’aspirant – citoyens, lesquels, dans leur grande majorité, proviennent de secteurs défavorisés et/ou subalternes de la population et visent à exprimer en commun leurs griefs, leur mécontentement et matérialiser leurs vœux.
A ce compte, la mobilisation populaire comme phénomène socio-historique implique une grande disponibilité de participation, une intense circulation ainsi qu’un vaste brassage de personnes et d’idées, le tout aboutissant à la construction d’un fort sentiment d’identité retrouvée et partagée121. Selon Touraine, les politiques appliquées dans cette démarche visent : le renforcement de l’indépendance nationale, la réalisation de l’intégration sociale et la défense des intérêts populaires122.
La résurgence de la mobilisation paysanne dans la région du Nord-Est est conférée aux convulsions du système politique une évidente dimension sociale123. D’après Benoit Joachim :« […] au fond, le mouvement des cacos des années 1911 – 1914 est bien un mouvement des masses populaires en lutte pour la justice sociale.
»124 En considérant les luttes populaires depuis l’indépendance passant par le XXème siècle, retenons ceux de nature patriotique survenus sous la direction de Charlemagne Péralte et Benoit Batraville (1916 – 1920)125. Ces deux leaders ont tous une nouvelle fois mobilisé le monde rural dans la lutte armée126. Dans la lutte contre l’occupation Nord-américaine (1915 – 1934), a pris naissance un nationalisme nourri cette fois par un anti – impérialisme politique orienté vers la reconquête de la souveraineté nationale127.
Selon Michel Hector, la période 1916 – 1920 est une
période de grandes mobilisations populaires. En outre, elle était dominée par le mouvement des cacos dans plusieurs régions du pays en résistance face à l’occupation états-unienne d’Haïti (1915 – 1920). D’où la nécessité de voir les approches psychosociologiques des cacos à travers le vêtement pour avoir une idée approfondie sur leur identité.
________________________
111 (Touraine Alain 1988, p. 47 – 48) ↑
116 (Touraine Alain 1988, p 106) ↑
120 (Touraine Alain et François Dubet 1981, p 176) ↑
121 (Hector Michel 2000, p 12) ↑
122 (Cité par Hector Michel 2000, p 14) ↑
123 (Hector Michel 2000, p 17) ↑
124 (Cité par Hector Michel 2000, même page) ↑
125 (Hector Michel 2000, p 18) ↑
126 (Hector Michel 2000, p 19) ↑
127 (Hector Michel 2000, p 55) ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce qu’un mouvement social selon Alain Touraine?
Selon Touraine, « les mouvements sociaux expriment une volonté collective » et sont définis comme des conduites socialement conflictuelles mais orientées.
Comment les mouvements sociaux influencent-ils l’histoire d’Haïti?
Les mouvements sociaux sont la trame de la société et représentent une action collective organisée d’un acteur luttant contre son adversaire pour la direction sociale de l’historicité.
Quelle est la vision de Touraine sur les mouvements sociaux?
Touraine affirme que le mouvement social y est présenté comme la combinaison d’un principe d’identité, d’un principe d’opposition et d’un principe de totalité, avec l’enjeu de l’historicité elle-même.