Les applications pratiques en communication interculturelle révèlent des mécanismes de défense socioculturelle souvent méconnus. Cette recherche innovante, ancrée dans le contexte congolais, offre des perspectives essentielles pour comprendre les dynamiques psychologiques sous-jacentes à la communication interculturelle.
- Mécanismes discriminatoires
Isabelle Nayrolles293 a distingué en trois sortes les mécanismes discriminatoires dans la communication interculturelle : la discrimination liée à la différence perceptible, la discrimination liée à la position sociale et la discrimination liée à l’appartenance communautaire.
Pour la discrimination liée à la différence perceptible, visible ou saillante, par exemple est celui d’un noir qui parmi les blancs est étranger, inhabituel et déroutant. Cette saillance a pour effet la « déroutinisation ou perte de repères et codes habituels de communication », ce qui peut entraîner une perturbation de la communication et donc une moindre efficacité du personnel.
290GIMENEZ, G. (dir.), « Psychologie sociale », p. 5, document téléchargé le 04 décembre 2012, URL : http://www.mutimania.com/hyksos/psy
291VALLERAND, R.J. (dir.), Les fondements de la psychologie sociale, Montréal, 2ème éd. Gaëtan Morin, 2006, pp.623-633.
292NOGUES, S., « La déviance : à la recherche d’une identité entre changement social et contrôle social », in Soc 201a, 2000, p. 5.
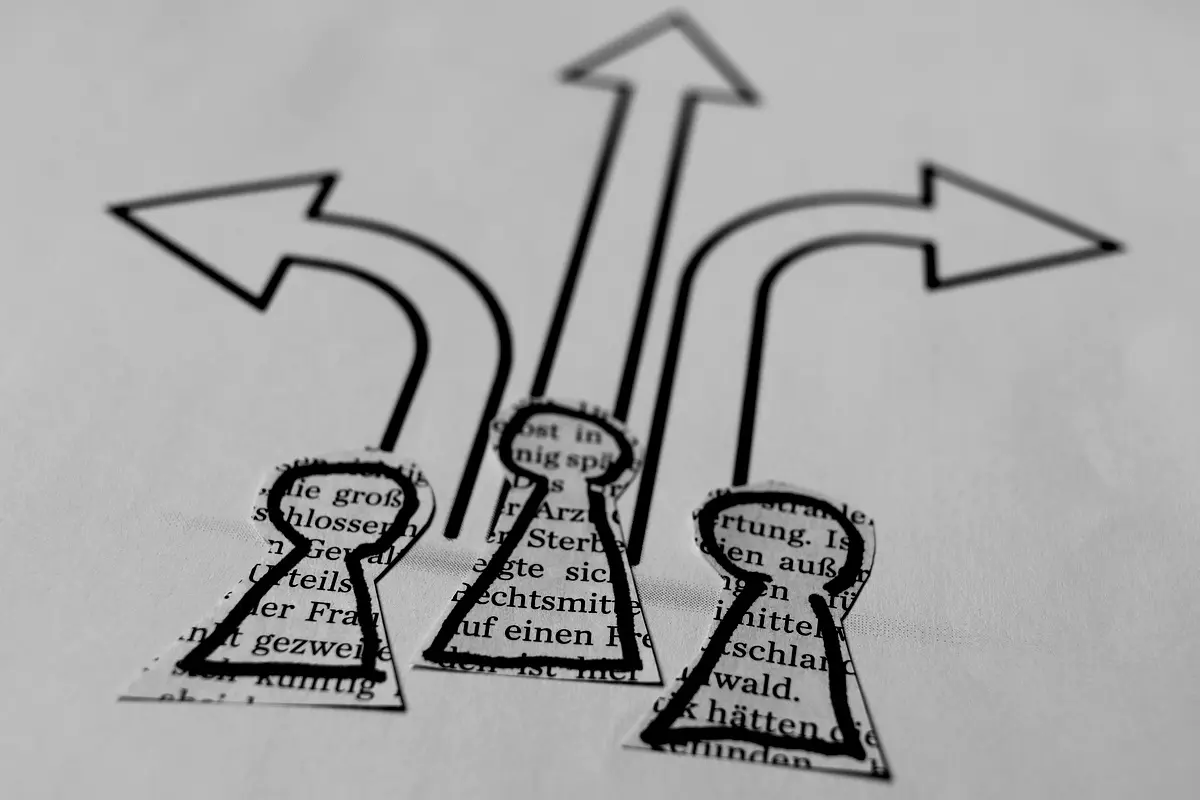
293NAYROLLES, I. citée par BIDOU-HOUBAINE, V., op.cit, pp. 15-20.
La discrimination liée à la position sociale est le fait de percevoir l’autre en tant qu’agent social. Telle est la représentation prototype de l’immigré. On est alors dans un rapport de dominant-dominé, voire actif-passif ou favorisé-défavorisé. L’autre n’a pas vraiment sa place en tant que sujet. On lui enlève sa position d’acteur. C’est ce qu’on appelle « l’agentisation » qui conduit à la non-reconnaissance des compétences de l’autre et la non-prise en considération de ses projets.
La discrimination liée à l’appartenance communautaire, tel est le mécanisme où l’autre est perçu comme un étranger affilié à un groupe différent. Dans ce cadre, nos « stéréotypes sont réactifs ». L’autre n’est pas considéré comme une personne à part entière mais comme membre d’une communauté. On se situe alors dans un rapport intergroupe avec tout ce que cela comporte comme « préjugés et stéréotypes », de « non-prise en considération de la situation particulière de la personne ».
C’est dans la communication interculturelle, comme l’affirme Miquel A. Rodrigo294, que se façonnent des préjugés fréquemment fondés sur une information partielle et déficiente. Mais curieusement, les idées ainsi préconçues sont très résistantes au changement même si elles sont confrontées à une nouvelle information qui ne s’adapte pas parfaitement au stéréotype.
Pour Yvonne Castellan295, les « préjugés et stéréotypes » sont des jugements, positifs ou négatifs, portés sur une personne, un objet ou un concept, en dehors de toute expérience personnelle ». Les deux aspects ne recouvrent pas la même réalité. Le préjugé est favorable ou défavorable ; tandis que le stéréotype est un jugement qualitatif, souvent sous forme d’adjectif : sincère, utile, propre… ou menteur, paresseux, malpropre… L’expérimentation réalisée en 1933 aux USA par Katz et Braly296 montre qu’une nationalité peut donner lieu à des stéréotypes très forts sans être l’objet de préjugés particuliers.
D’après les travaux d’Otto Klineberg297 sur l’interdépendance des préjugés et des stéréotypes selon le contexte social, les stéréotypes apparaissent dans un contexte social problématique donné et jouent une fonction sociale. Cette fonction sociale consiste à préjuger des groupes particuliers (groupes cibles) sur l’origine et/ou la cause de problèmes sociaux. Il répond à deux objectifs : transférer les problèmes du groupe à un autre groupe, et resserrer les liens intragroupes.
294RODRIGO, M.A., Identitats i comunicació intercultural, Valencia, Edicions 3i4, 2000, pp. 87-114.
295CASTELLAN, Y., Initiation à la psychologie sociale, Paris, Armand Colin, 1972, pp. 1-272.
296KATZ et BRALY cités par MERCIER, P., op.cit, pp. 15.
297KLINEBERG, O., « Introduction aux facteurs sociaux et formation de la personnalité », in Bulletin International des Sciences Sociales, vol. 7, n° 1, I955, pp. 4-14.
Myron W. Lusting298, de son côté, pense que les stéréotypes sont faits de trois façons. La première façon est telle qu’ils ignorent les différences entre individus. C’est ce que l’on appelle l’effet d’homogénéité et qui tend à faire considérer que tous les membres d’un groupe sont bien plus identiques qu’ils ne le sont en réalité.
La deuxième façon est une perception exagérée d’un groupe particulier. La troisième façon est la surestimation soit des aspects positifs, soit des aspects négatifs d’une culture spécifique. C’est ce que l’on appelle préjugé. Cela peut amener à ne plus voir les spécificités du groupe. A cet effet, de nombreuses personnes se construisent des préjugés en fonction d’expériences qu’ils ont eues avec un petit nombre de personnes issues d’un groupe particulier ou à partir des informations acquises par ouï-dire.
L’image médiatique de personnes ou d’événements du monde peut être une autre source d’a priori. Tout cela peut conduire à une perception faussée d’un groupe.
Sur cette liste, nous pouvons ajouter la « remise en cause de l’autorité » et la
« scotomisation » qui s’observent également dans la communication entre les individus d’origines culturelles et ethniques différentes.
La remise en cause de l’autorité de la source, « si l’information pose problème, l’individu va dévaloriser, en mettant en cause l’autorité, la compétence ou la bonne foi de celui qui est à l’origine de l’information »299. La question qui se pose désormais est celle du fondement de l’autorité. Sur quelle forme de légitimité s’appuie-t-elle pour agir ?
Quel est le principe moral qui opère en lieu et place de la contrainte, rendant cette dernière utile ? Ces préoccupations ont déjà trouvé des réponses dans les travaux de Max Weber300 sur les « fondements de l’autorité » publiés dans son ouvrage intitulé Le savant et le politique. L’auteur commence par définir l’autorité comme le pouvoir d’obtenir sans recours à la violence physique un certain comportement de la part de ceux qui acceptent l’influence et la reconnaissent légitime.
Cette autorité peut prendre trois formes : rationnelle, traditionnelle, charismatique, mais dans tous les cas, dans son fond, elle reste émotionnelle, affective. Il s’agit donc là des fondements de l’autorité. Cette conception de l’autorité, selon Bernard Jolibert301, est intéressante dans la mesure où elle permet peut-être de mieux saisir l’importance de la crise d’autorité que rencontrent les institutions sociales. L’autorité peut s’effondrer lorsque les fondements qui en garantissent l’emprise ont perdu de leur force, lorsque la valeur commune médiane a perdu son crédit, tant chez les agents de l’autorité que chez les patients. Or il semble bien qu’on se trouve aujourd’hui dans ce cas de figure puisque les trois modes de légitimation
298LUSTING, M.W. cité par MUHAMMAD, R., « Encourager la Communication Interculturelle », in Higher Education Policy, vol. 18, n°4, 2005, p. 20.
299GRONIER, G., op.cit, p. 1.
300WEBER, M., Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959, p. 113-114.
301JOLIBERT, B., « L’autorité et ce qu’elle n’est pas », in LOMBARD, J. (dir.), L’école et l’autorité, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 148.
possibles de l’autorité se voient contestés de toutes parts. Dans notre cas de figure, l’autorité est contestée lorsqu’elle ne relève pas de son obédience culturelle.
La scotomisation (non perception) consiste pour un individu à ne pas percevoir, à ne pas entendre, à ne pas enregistrer les éléments qui ne correspondent pas a son système de référence. Pour Antoine Porot302, la scotomisation (du grec scotos : sombre, obscur) désigne en psychologie un mécanisme de défense par lequel le sujet névrosé nie l’existence de faits qui ont été vécus mais qui lui sont intolérables. Il s’agit d’un processus de dénégation qui permet de
« ne pas voir » de contenus, d’images, souvenirs trop angoissants. Un véritable scotome psychique sélectif se constitue, qui rétrecit le champ de conscience réalisant une amnésie bien circonscrite dans le temps. Ainsi, une patiente peut avoir totalement oublié son mariage quelques mois auparavant en ayant par ailleurs une mémoire tout à fait normale. Il ne faut pas confondre la scotomisation avec le refoulement. Le refoulement porte sur les désirs mais pas sur l’objet de ces désirs.
- Mécanismes ethniques
Le sentiment de partager une ascendance commune à cause de la langue, des coutumes, des ressemblances physiques ou de l’histoire vécue (objective ou mythologique), ce que Max Weber303 appelle « ethnicité », a engendré certains mécanismes surtout chez les groupes soi- disant minoritaires dans les domaines de vie divers. Il s’agit notamment de la perversion démocratique, l’identification et la protection ethniques, l’alibi culturel, la construction idéologique d’exclusion interculturelle et la résistance au changement.
L’alibi culturel304 permet en fait à ceux qui en ont les moyens de tirer les ficelles du jeu social il est utilisé par les plus puissants pour mieux dominer les autres. Ceci s’observe surtout avec l’utilisation du système des castes en Inde et des lignages en Afrique. D’un autre côté, il exprime toutes les impostures que prennent deux individus ou deux groupes d’individus lorsque survivent un problème et que l’on allègue un peu vite : « on est dans l’interculturel ».
La construction idéologique d’exclusion interculturelle est ce mécanisme qui en consiste à la catégorisation et la hiérarchisation des cultures. C’est ce qui justifie le fait que certaines cultures se considèrent plus puissantes que d’autres. En témoigne le cas des Allemands avec Hitler se considérant comme la race pure ou supérieure. Par ailleurs, la revue de la littérature anthropologique fait état de certains peuples qualifiés de primitifs, surtout dans la civilisation africaine, allusion aux fameux écrits de Claude Lévy-Strauss dans l’Anthropologie structurale305.
302POROT, A., Manuel alphabétique de Psychiatrie, Paris, PUF, 1996, p.632.
303WEBER, M., Economie et société, Paris, Plon, 1970, pp. 1.-60.
304SAUQUET, M. et alii, op.cit, pp. 3-4
305LEVY-STRAUSS, C., Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 114.
L’identification et la protection ethniques observables dans la plupart des pays multi- ethniques insinuent que les membres des groupes ethniques durant les élections, telles les élections de 2006 et de 2011 en R.D.C, ont développé des comportements différents face aux candidats n’appartenant pas à leur ethnie. « Les membres d’un groupe ethnique donné développent des affinités particulières avec un certain parti politique plutôt qu’un autre, d’une part et ces mêmes individus généralement affiliés à un certain parti politique sont prêts à changer d’allégeance politique pour
voter pour (ou contre) un candidat issu d’un groupe ethnique particulier »306. Lors des élections, « ils ont tendance à voter pour des candidats qui sont de leur groupe ethnique. Ceci s’explique d’abord par le fait qu’un candidat qui partage la même culture d’origine ou le même passé ethnique que l’électeur a, dans l’esprit de l’électeur, généralement les mêmes préoccupations politiques »307.
Finalement, c’est donc un mécanisme d’identification ethnique et de protection.
La perversion démocratique, l’événement de la démocratie fondée sur le multipartisme dont l’un des postulats est le suffrage universel, avec la règle majoritaire qui a aiguisé la conscience démographique au sein des entités ethniques. On a vu naître des partis politiques sur le lit de parenté biologique se fonder sur la proximité naturelle plus que sur le partage de valeurs philosophiques ou la communauté d’idéaux politiques ; la solidarité de sang a présidé à la formation des alliances et déterminé le jeu de la course au pouvoir. Il s’agit donc de l’ethno- démocratie, qui n’est rien d’autre que la caricature de la démocratie, la négation même de celle-ci que certains appellent la perversion démocratique.
La résistance au changement est un comportement observable issu de mécanismes de défense (cause). Elle peut être définie comme étant «l’expression implicite ou explicite de réactions de défense à l’endroit de l’intention de changement » 308. Elle traduit aussi « l’attitude individuelle ou collective, consciente ou inconsciente, qui se manifeste dès lors que l’idée d’une transformation est évoquée. Elle représente donc une attitude négative adoptée par les employés lorsque des modifications sont introduites dans le cycle normal de travail » 309. Et pour sa part, Estelle M. Morin310 définit les résistances comme «des forces qui s’opposent à la réorganisation des conduites et à l’acquisition de nouvelles compétences ou, en d’autres mots, à des forces restrictives».
Enfin, ces mécanismes sont très visibles lors des échanges entre des personnes appartenant à des cultures différentes. Ils peuvent se manifester séparément ou ensemble. On
306WOLFINGER, R.E., “The development and persistence of ethnic voting”, in The american political science review, vol. 59, n° 4, 1965, p. 896.
307MICHELSON, M.R., « Does ethnicity trump party? Competing vote cues », Journal of political marketing, vol. 4, n°4, 2005, p. 4.
308COLLERETTE, P., et alii, Le changement organisationnel : Théorie et pratique, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, 1997, p. 94.
309DOLAN, S.L., et alii, Psychologie du travail et des organisations, Montréal, Gaëtan Morin, 1996, p. 486.
310MORIN, E. M., op.cit, p. 205.
les retrouve chez tous les individus et ils fonctionnent de manière inconsciente. De ce fait, ils constituent comme d’autres facteurs (variables) une « barrière » entre les individus ; toutefois, il serait intéressant de savoir comment ils s’observent dans le contexte congolais.
________________________
293 NAYROLLES, I. citée par BIDOU-HOUBAINE, V., op.cit, pp. 15-20. ↑
294 RODRIGO, M.A., Identitats i comunicació intercultural, Valencia, Edicions 3i4, 2000, pp. 87-114. ↑
295 CASTELLAN, Y., Initiation à la psychologie sociale, Paris, Armand Colin, 1972, pp. 1-272. ↑
296 KATZ et BRALY cités par MERCIER, P., op.cit, pp. 15. ↑
297 KLINEBERG, O., « Introduction aux facteurs sociaux et formation de la personnalité », in Bulletin International des Sciences Sociales, vol. 7, n° 1, I955, pp. 4-14. ↑
298 LUSTING, M.W. cité par MUHAMMAD, R., « Encourager la Communication Interculturelle », in Higher Education Policy, vol. 18, n°4, 2005, p. 20. ↑
299 GRONIER, G., op.cit, p. 1. ↑
300 WEBER, M., Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959, p. 113-114. ↑
301 JOLIBERT, B., « L’autorité et ce qu’elle n’est pas », in LOMBARD, J. (dir.), L’école et l’autorité, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 148. ↑
302 POROT, A., Manuel alphabétique de Psychiatrie, Paris, PUF, 1996, p.632. ↑
303 WEBER, M., Economie et société, Paris, Plon, 1970, pp. 1.-60. ↑
304 SAUQUET, M. et alii, op.cit, pp. 3-4 ↑
305 LEVY-STRAUSS, C., Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 114. ↑
306 WOLFINGER, R.E., “The development and persistence of ethnic voting”, in The american political science review, vol. 59, n° 4, 1965, p. 896. ↑
307 MICHELSON, M.R., « Does ethnicity trump party? Competing vote cues », Journal of political marketing, vol. 4, n°4, 2005, p. 4. ↑
308 COLLERETTE, P., et alii, Le changement organisationnel : Théorie et pratique, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, 1997, p. 94. ↑
309 DOLAN, S.L., et alii, Psychologie du travail et des organisations, Montréal, Gaëtan Morin, 1996, p. 486. ↑
310 MORIN, E. M., op.cit, p. 205. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les mécanismes discriminatoires dans la communication interculturelle?
Isabelle Nayrolles a distingué trois sortes de mécanismes discriminatoires : la discrimination liée à la différence perceptible, la discrimination liée à la position sociale et la discrimination liée à l’appartenance communautaire.
Comment la discrimination liée à la position sociale affecte-t-elle la communication?
La discrimination liée à la position sociale perçoit l’autre en tant qu’agent social, créant un rapport de dominant-dominé qui conduit à la non-reconnaissance des compétences de l’autre.
Quelle est la différence entre préjugés et stéréotypes dans la communication interculturelle?
Les préjugés sont des jugements, positifs ou négatifs, portés sur une personne, tandis que les stéréotypes sont des jugements qualitatifs souvent sous forme d’adjectif, comme sincère ou paresseux.