Le cadre théorique de la communication révèle des mécanismes de défense insoupçonnés dans les échanges interculturels congolais. En combinant psychologie et méthodologie innovante, cette recherche transforme notre compréhension des dynamiques sociales, avec des implications cruciales pour l’interaction interculturelle.
- Mécanismes situationnels
Lors des échanges entre des individus ayant des rôles sociaux déterminés, les interlocuteurs agissent par l’altérité (co-présence), la dissymétrie (distance sociale), le jugement potentiel, le conformisme et la déviance.
L’altérité ou la coprésence, c’est le fait de se sentir différent face à l’autre puisqu’on ne partage pas le même univers culturel. En effet, l’être humain n’est pas un être solitaire, c’est dans l’interaction avec les autres qu’il se développe, se construit et se définit.
Hélène Bonsergent287 affirme, en ce sens que, dès l’enfance, les êtres qui constituent l’environnement de la personne ont une influence importante sur l’élaboration de son monde symbolique. L’acquisition de la maturité psychique signifie la capacité de devenir indépendant des influences extérieures pour élaborer une symbolisation personnelle authentique, fonction de la subjectivité vécue à travers la liberté expérientielle.
Le paradoxe, qui n’est qu’apparent, est que la réalisation de l’autonomie subjective se fait grâce à l’altérité. La vie authentiquement personnelle est la co-présence, le chemin de soi par soi passe par autrui ; c’est dans un dialogue entre deux Toi que l’homme se découvre et s’affirme en tant que personne.
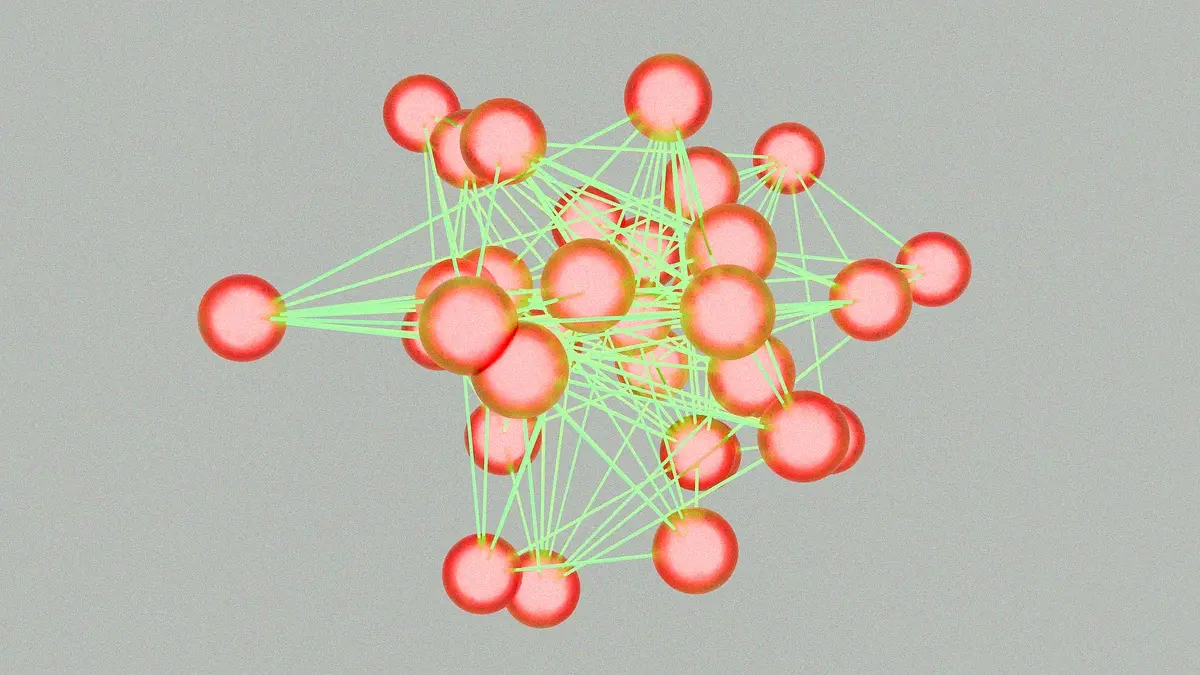
Pour comprendre l’autre, il est nécessaire d’être en capacité de se comprendre soi-même. Le philosophe Gilles Lipovetsky288 avance que le retrait sur soi-même, au lieu de nous éloigner d’autrui, nous en rapprocherait ; ce serait par la prise en considération de soi que l’individu peut « s’ouvrir aux malheurs des autres ».
La dissymétrie (distance sociale et psychologique). Chacun occupe son « espace personnel », une espèce de bulle psychologique qui lui est propre et qu’il n’aime pas voir brusquement envahie.
Nous préférons généralement signifier aux autres à quel moment ils peuvent se rapprocher et franchir cet espace psychologique. Quoique chacun tende à délimiter son espace personnel en fonction de la distance physique, dans l’ensemble, des schémas culturels contrôlent et régularisent cet espace et ces distances interpersonnelles.
Lorsque les individus ne respectent pas les règles établies, c’est-à-dire lorsqu’ils franchissent des limites non conformes aux attentes des autres selon les circonstances, ces derniers ressentent généralement un malaise. La distance est le témoin de l’implication dans la communication.
Le jugement potentiel, c’est le sentiment de risque et de menace ressenti vis-à-vis de l’autre. Ce mécanisme trouve son fondement dans les travaux de Curl G. Yung289 sur les fonctions psychologiques. En effet, la « pensée » et le « sentiment » sont deux fonctions psychologiques consistant à juger l’objet dont on a conscience.
La « pensée est un jugement sur sa nature » et le « sentiment un jugement sur sa valeur ». La raison d’un jugement est objective et consciente pour le penseur, elle est inconsciente et subjective pour le sentimental. La pensée vise à déterminer si l’idée que l’on a est juste : c’est une fonction intellectuelle, analytique, organisatrice et objective.
Cette fonction s’appuie naturellement sur la compréhension logique du monde et sur des catégories et des systèmes de pensée partagée ; mais le type « penseur » ne doit pas être confondu avec un degré élevé d’intelligence ou de culture.
Le sentiment, au contraire, vise à déterminer si l’on apprécie ou non cet objet, si l’on y adhère ou si on le rejette : cette fonction purement subjective se joue indépendamment de toute considération logique, classificatrice ou analytique. Elle est affective, instinctive, et sélective.
Le conformisme : c’est le fait d’adopter la norme définie par son interlocuteur ou le groupe dans lequel on fait partie et influencer les autres. C’est la « modification d’un comportement pour laquelle l’individu répond aux pressions d’un groupe en cherchant à se mettre en accord par l’adoption des normes qui lui soit proposées ou imposées »290.
Pour Robert J. Vallerand291, une personne modifie sa position dans la direction de la position du groupe. Cependant, la personne qui ne connaît pas sa situation, elle tend à se conformer, car les autres ont plus d’informations que lui et elle n’a pas confiance dans ses jugements.
On se conforme car on a peur des conséquences négatives et parce qu’on veut se faire aimer ou s’accepter par le groupe.
La déviance s’explique par ceci que, pour ne pas subir la norme que cherche à imposer l’émetteur, le récepteur ne peut qu’entrer en conflit avec ce dernier. Ce conflit peut entraîner la rupture pure et simple entre les deux interlocuteurs.
Il convient ici encore de faire observer que le mot « déviance » ne contient pas la connotation d’immoralité que lui confère souvent le langage quotidien. Un déviant, c’est un membre du groupe qui s’écarte des normes du groupe du point de vue des valeurs, de son comportement, de ses opinions.
Il s’agit là d’une transgression désapprouvée. Selon que l’on se situe dans l’optique de l’acteur singulier ou dans celle du processus d’interaction, la déviance peut recevoir deux acceptions différentes292 : d’une part, elle consiste en une tendance, propre à l’acteur, à adopter un comportement en contraction avec un ou plusieurs systèmes normatifs institutionnalisés et d’autre part, elle consiste, pour un ou plusieurs acteurs, à se comporter de manière à mettre péril l’équilibre du processus interactionnel.
________________________
282GIFFARD, D., op.cit, p. 2. ↑
283KANGA, Psychosociologie de la communication, Séminaire de DEA inédit, Kinshasa, IFASIC, 2009, p. 27. ↑
284LANGELET, C., « Comportement du consommateur et la publicité », pp. 11-12, document consulté le 04 décembre 2012, URL : http://www.langelet.info/marketing ↑
285PHANEUF, M., Cancer, mécanismes de défense et d’adaptation et interventions infirmières, Portugal, Coimbra, 2005, p. 13. ↑
286GIFFARD, D., op.cit, p. 1. ↑
287BONSERGENT, H, « Le lien avec soi-même se construit dans le rapport à l’Autre », pp. 1-2, document téléchargé le 03 avril 2013, URL : http://www.psycho-ressources.com/doc/778LAlterite.pdf ↑
288LIPOVETSKY, G., L’ère du vide, Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Folios Essais, 1998, p. 282 ↑
289YUNG, C.G., L’homme à la découverte de son âme, Paris, Albin Michel, 1987, pp. 1-360. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les mécanismes situationnels dans la communication interculturelle?
Lors des échanges entre des individus ayant des rôles sociaux déterminés, les interlocuteurs agissent par l’altérité, la dissymétrie, le jugement potentiel, le conformisme et la déviance.
Comment l’altérité influence-t-elle la communication interculturelle?
L’altérité ou la coprésence, c’est le fait de se sentir différent face à l’autre puisqu’on ne partage pas le même univers culturel, ce qui est essentiel pour le développement personnel à travers l’interaction.
Qu’est-ce que le conformisme dans le contexte de la communication interculturelle?
Le conformisme est le fait d’adopter la norme définie par son interlocuteur ou le groupe dans lequel on fait partie, influençant ainsi les comportements des autres.