Les perspectives futures en communication interculturelle révèlent des mécanismes de défense socioculturelle inattendus dans le contexte congolais. Cette recherche innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies variées, offre des clés essentielles pour comprendre et améliorer les interactions interculturelles.
- Dimension communicative
La toute première dimension de la communication interculturelle, c’est la
« communication », puisque les individus avec toutes leurs caractéristiques (biologique, culturelle, psychologique et sociale) entrent dans un processus de relation dynamique grâce à ce moyen. Cette interrelation se passe dans un cadre précis, celui d’une société qui constitue notre champ empirique. Cette considération implique donc l’éclaircissement de trois notions essentielles, dites aussi « composantes » : la communication interpersonnelle comme fondement de l’interculturalité, la communication généralisée et la contextualité situationnelle.
- Communication interpersonnelle, fondement de l’interculturalité
Dans ce paragraphe, il est question d’examiner tant sur le plan théorique que pratique la première composante, la communication interpersonnelle, comme fondement de la communication interculturelle. Pour ce faire, nous avons développé à tour de rôle les notions telles que :
- toute communication interpersonnelle est interculturelle ;
- toute communication interculturelle est verbale et non-verbale ;
- et toute communication interculturelle est une interaction.
- Toute communication interpersonnelle est interculturelle
De prime abord, il est important de signaler que la communication interculturelle est avant tout interpersonnelle ou interindividuelle, puisque lorsque deux personnes communiquent, leurs cultures sont convoquées dans l’échange, dans une intercommunication chargée d’interculturalité. C’est ce qui a amené Malika Lemdan103 à qualifier le concept de
« communication interculturelle » d’expression redondante, pléonastique, bien entendu un pléonasme désigne une expression ou un mot qui répète volontairement ou non une idée déjà émise. Dans ce sens, l’interrelationnel suppose l’activation des dimensions culturelles propres aux interlocuteurs, car plusieurs cultures peuvent coexister dans une personne et entre les personnes.
Dans cette perspective, « la communication est l’ensemble des processus physiques et psychologiques par lesquels s’effectue la mise en relation d’un ou plusieurs individus avec un ou plusieurs individus en vue d’atteindre certains objectifs. La communication existe dès lors qu’il y a échange de sens, de signification : toute communication s’inscrit dans un processus d’ordre social »104.
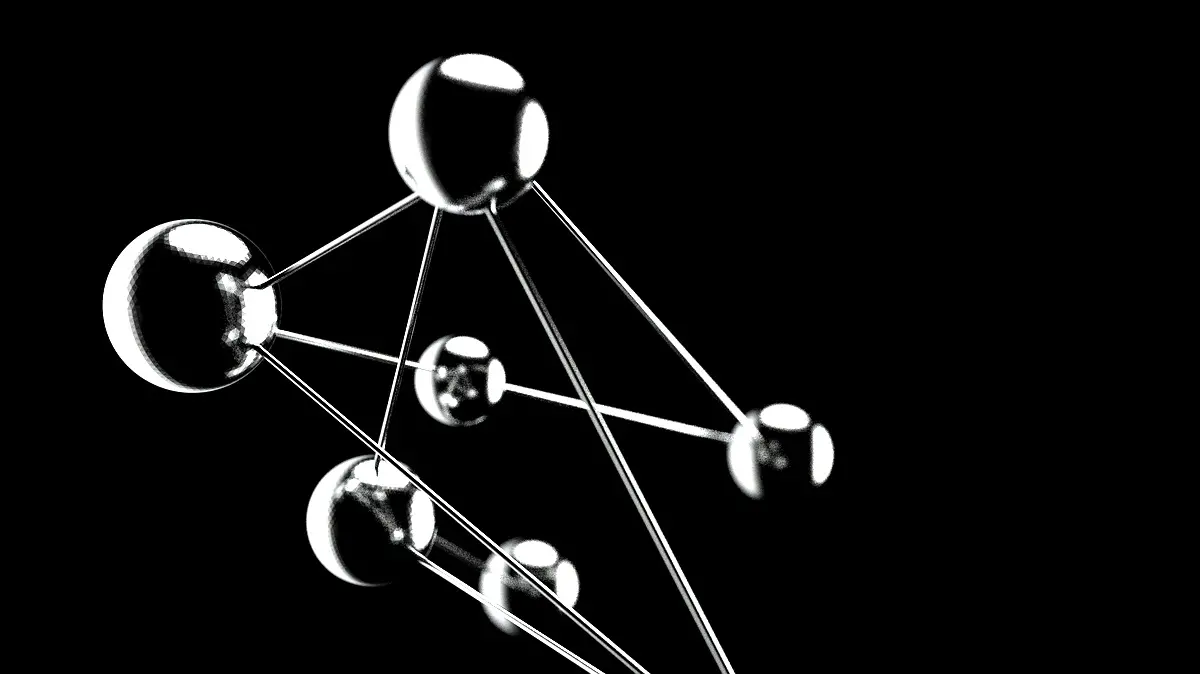
Cette définition vient donc d’affirmer l’idée déjà évoquée en 1975 par Gilles Amado et André Guittet105, selon laquelle il existe une communication chaque fois qu’un organisme quelconque, et un organisme vivant en particulier, peut affecter un autre organisme en le modifiant ou en modifiant son action à partir de la transmission d’une information (et non pas une action directe, telle que celle qu’exerce une force physique mettant en jeu une énergie).
Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de noter que la communication interpersonnelle est basée sur l’échange entre les humains (un émetteur et un récepteur), c’est la base de la vie en société. C’est là en général que la compréhension est la meilleure et la rétroaction est quasi systématique, puisque le nombre de récepteurs est limité à une seule personne. Dans cet échange, il n’y a pas que l’oralité, les gestes et autres signes non-verbaux sont aussi impliqués. Ces éléments ne sont pas neutres, ils sont toujours déterminés par des facteurs culturels.
- Toute communication interculturelle est verbale et non verbale
La communication entre les humains est toujours verbale et non verbale. Ce constat a alimenté de nombreuses recherches qui ont abouti à des constats parfois contradictoires. A ce sujet, un courant des chercheurs affirme qu’il existe une discordance entre les deux formes de communication (verbale et non-verbale) et par conséquent, elles peuvent être étudiées séparément. Un autre courant soutient le contraire ; les paragraphes qui suivent nous en donnent plus de détails.
- Le premier courant consacre un parallélisme entre les deux codes
Pour Paul Ekman et Wallace V. Friesen106, les signes non verbaux sont automatiquement utilisés, au niveau de l’émetteur comme du récepteur, pour porter et clarifier le contenu intellectuel de la communication, et leur « langage muet » n’est l’objet que d’une attention marginale.
De son coté, Joël R. Davitz107 affirme que les signaux verbaux et les signaux non verbaux sont perçus et interprétés par des processus complètement différents, comme s’il y avait deux types de conscience simultanés, l’une occupée au sens textuel, l’autre aux paralangages.
Michael Argyle108 distingue deux systèmes de communication et conclut en ces termes que le « code verbal » est utilisé pour communiquer un certain contenu de valeur informationnelle, tandis que le « code non-verbal » est utilisé pour établir et maintenir la relation interpersonnelle.
D’après ce courant, il existe deux formes de communication distinctes : la communication verbale et la communication non-verbale.
La communication verbale peut être orale ou écrite et l’efficacité de chacune d’elle est traduite par certains éléments de base. Pour l’oralité, on peut noter la qualité de locution de l’émetteur, le code ou le langage utilisé (le choix du vocabulaire), le canal ou moyen de transmission utilisé (son de la voix), le décodage ou l’interprétation du message de la part du récepteur. Pour la communication écrite, on signale le choix des informations du contenu du document, l’élaboration du document en tenant compte de l’intérêt, de la compréhension et de la lisibilité du document, l’utilisation des termes connus ou s’ils sont nouveaux mais à définir pour faciliter le décodage de la part du récepteur.
La communication passe donc aussi par le corps. Ainsi, elle sera non verbale ou plutôt non verbalisée. La communication non verbale peut être para-verbale, c’est-à-dire elle accompagne la vocalisation. Ainsi lorsque le locuteur explique qu’il faut aller à droite et qu’il bouge sa main dans cette direction, c’est un cas de communication para verbale. Croiser les bras dans un signe de protection est aussi une communication non verbale. Mimiques et postures font partie de la communication. Des gestes risquent de faire passer un message comme plus fort, plus prononcé que ce que l’on dit. Le ton d’un message est aussi une forme de communication non-verbale.
- Le second courant relève une convergence entre les deux codes
Pour les théoriciens de la « nouvelle communication », notamment Paul Watzlawick, Janet Helmick-Beavin, et Don D. Jackson109, la communication est bel et bien un acte social, cet acte pouvant être délibéré ou involontaire, conscient ou non. Il est en tout cas l’un des actes fondateurs du lien social. Si l’on admet que dans une interaction, tout comportement a la valeur d’un message, c’est-à-dire qu’il est une communication, il s’ensuit qu’on ne peut pas ne pas communiquer, qu’on le veuille ou non.
Dans ce sens, la communication ne repose pas bien entendu sur la seule expression orale, elle est un système à canaux multiples (les gestes, les mimiques, la position corporelle, le silence lui-même sont des actes de communication) qui véhiculent en effet une signification ; ces canaux témoignent de la nature du lien social existant ou souhaité.
La communication est donc un processus social permanent intégrant de multiples modes de comportement : la parole, le geste, le regard, la mimique, l’espace interindividuel, etc. « Il ne s’agit pas de faire une opposition entre la communication verbale et la communication non- verbale. La communication est un tout intégré »110. On dit parfois que la communication est holistique, c’est-à-dire qu’elle fait intervenir le tout de l’homme y compris l’environnement dans lequel il évolue. Que l’on se taise ou que l’on parle, tout est communication. Nos gestes, notre posture, nos mimiques, notre façon d’être, notre façon de dire, notre façon de ne pas dire, toutes ces choses « parlent » à notre récepteur.
Enfin, le contenu d’un message est influencé par les signes non-verbaux qui l’accompagnent, mais cela dans une proportion variable selon la personnalité de chaque auditeur et de l’environnement socioculturel dans lequel ce dernier a évolué. La convergence des deux systèmes (verbal et non-verbal) a un effet clarificateur et renforçateur. Tandis que la divergence entre les deux systèmes provoque chez les récepteurs des troubles émotionnels et brouille les significations du message.
A cet effet, Jean-Luc Penot et Liviu Marian111 font remarquer que la communication non verbale représente approximativement 65% du total des messages. Comme un complément à la communication verbale, l’expression du visage, les postures du corps situent les enjeux entre distance critique et approbation bienveillante. Les gestes de la main, les postures, le ton, la voix, révèlent le degré d’intimité, l’intérêt que l’on porte au sujet de la conversation et la volonté de poursuivre ou non l’échange.
- Toute communication interculturelle est une interaction
Toute communication doit s’analyser comme une interaction. Dans le contexte multiculturel, les gens d’origines ethniques ou culturelles différentes sont appelés à cohabiter (interagir) dans les différents milieux sociaux et professionnels (foyer, parcelle, quartier, ville, marché, école / université, entreprise, confession religieuse, …). Cette cohabitation impose un dialogue interculturel. Il y a donc dialogue interculturel au moment où s’opère la rencontre entre des univers culturels ou même sociaux différents. Ce dialogue n’est pas, en réalité, un fait acquis, mais plutôt construit dans la mesure où il s’élabore grâce à une interaction active.
Cette interaction peut engendrer trois situations au niveau des groupes culturels112 :
- L’assimilation, c’est-à-dire la culture dominante prend le dessus sur l’autre, considérée comme faible ;
- La ségrégation culturelle, c’est une situation où les groupes culturels coexistent avec un
minimum de contacts. Cette situation évoque un développement séparé de chaque culture, selon ses caractéristiques propres ;
La communication est donc un processus social permanent intégrant de multiples modes de comportement : la parole, le geste, le regard, la mimique, l’espace interindividuel, etc. « Il ne s’agit pas de faire une opposition entre la communication verbale et la communication non- verbale. La communication est un tout intégré »110. On dit parfois que la communication est holistique, c’est-à-dire qu’elle fait intervenir le tout de l’homme y compris l’environnement dans lequel il évolue. Que l’on se taise ou que l’on parle, tout est communication. Nos gestes, notre posture, nos mimiques, notre façon d’être, notre façon de dire, notre façon de ne pas dire, toutes ces choses « parlent » à notre récepteur.
Pour garder son équilibre interne, toute société a besoin du syncrétisme (de métissage culturel) qui est fondamentalement basé sur les « interactions » au cours desquelles le principe de rétroaction ou feedback est capital, car il n’est pas de communication sans interaction. Cependant une bonne rétroaction, feed-back, correspond à quatre fonctions113 :
- la fonction de contrôle de la compréhension, de la bonne réception des messages ;
- la fonction d’adaptation du message aux caractéristiques des acteurs, aux difficultés rencontrées ou à d’autres événements nécessitant une modification du contenu ou de la forme ;
- la fonction de régulation sociale par la flexibilité des rôles et des fonctions assurées par les différents acteurs facilitant la compréhension du point de vue de l’autre et favorisant l’apprentissage social ;
- la fonction socio-affective, l’existence du feed-back augmente la « sécurité interne» des acteurs. Il réduit l’appréhension et augmente la satisfaction.
Et, une autre fonction que l’on peut reconnaître à la communication, c’est une forme de manipulation. En effet, l’on communique souvent pour manipuler, modifier l’environnement ou le comportement d’autrui.
En conclusion, pour établir une « bonne » communication, le feed-back (rétroaction) apparaît comme une nécessité. L’individu qui communique se centre souvent sur son rôle d’émetteur, donnant la priorité à son propre point de vue, à ses idées, a ses sentiments, etc. Une attitude plus réceptive à autrui, notamment par une meilleure pratique de l’écoute, permet dans tous les cas d’améliorer la communication en réduisant l’importance des mécanismes pouvant y faire obstacle. Le feed-back permet donc de réduire les mécanismes de défense chez l’individu, en lui permettant de réagir, de manifester de l’intérêt pour l’autre en se centrant sur lui et de conférer au message une certaine adaptabilité et flexibilité.
________________________
103 LEMDANI, M., op.cit, p. 3. ↑
104 ANZIEU, D. et MARTIN, J.-Y., La dynamique des groupes restreints, Paris, PUF, 1968, p. 131. ↑
105 AMADO, G. et GUITTET, A., La dynamique des communications dans les groupes, Paris, Armand Colin, 1975, p.3. ↑
106 EKMAN, P. et FRIESEN, W. V., “The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage and coding”, in Semiotica, 1, 1969, pp. 49–98. ↑
107 DAVITZ, J.R. et alii, The communication of emotional meaning, New York, Mc Graw-Hill, 1964, pp. 1-214. ↑
108 ARGYLE, M., Social Interaction, London, Methuen, 1969, pp. 1-504. ↑
109 WATZLAWICK, P. et alii, op.cit, pp. 45-46. ↑
110 WINKIN, Y. (dir.), op.cit, p. 24. ↑
111 PENOT, J.-L. et MARIAN, L., « Analyse de la communication », in PENOT, J.-L. (dir.), Communication européenne, Miskolc, Miskolc University Press, 2008, p. 12. ↑
112 NTONDA, K.P., op.cit, p. 45. ↑
113 ABRIC, J.-C., Psychologie de la communication : Théories et méthodes, Paris, Armand Colin, 2011, p. 20. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la communication interculturelle?
La communication interculturelle est avant tout interpersonnelle ou interindividuelle, puisque lorsque deux personnes communiquent, leurs cultures sont convoquées dans l’échange.
Pourquoi la communication interpersonnelle est-elle considérée comme le fondement de l’interculturalité?
La communication interpersonnelle est basée sur l’échange entre les humains, c’est la base de la vie en société où la compréhension est meilleure et la rétroaction est quasi systématique.
Comment la communication interculturelle implique-t-elle des éléments verbaux et non verbaux?
La communication entre les humains est toujours verbale et non verbale, et ces éléments sont déterminés par des facteurs culturels.