L’analyse comparative des mécanismes de défense révèle des stratégies inattendues dans la communication interculturelle au Congo. En confrontant les perceptions socioculturelles, cette recherche promet de transformer notre compréhension des interactions humaines, avec des implications cruciales pour la gestion des conflits interculturels.
- Question de recherche
De ce qui précède, il est donc important d’établir des règles et des pratiques qui guident les décisions et les actions des individus confrontés à des problématiques interculturelles. La recherche des mécanismes ou réactions défensives déterminera selon le cas les stratégies à adopter en vue de gérer ces problèmes.
Cette gestion nous amène à porter un regard critique sur les pratiques de communication et à instaurer des conditions et un contexte qui favorisent l’apprentissage des personnes d’autres cultures. A cet effet, notre problématique se formule comme suit : quels sont les mécanismes de défense sociale que les individus d’origines culturelles et ethniques différentes produisent dans la communication interculturelle ?
- Hypothèse de travail
De ce qui précède, notre hypothèse générale dans le cadre de cette recherche stipule ainsi : en communication interculturelle, les acteurs sociaux d’origines culturelles et ethniques différentes produisent des mécanismes de défense psychiques de base, situationnels, discriminatoires et ethniques à travers les communications généralisées et les contextualités situationnelles.
Pour mieux cerner cette hypothèse, il nous paraît utile de procéder à son opérationnalisation. Celle-ci est constituée de la variable indépendante (V.Ind), de la variable intermédiaire (V.Int) et de la variable dépendante (V.D). Les trois variables, dites concepts, sont formulées comme suit :
- une variable indépendante : communication interculturelle ;
– une variable intermédiaire : acteur social ou sujet communicant ;
– une variable dépendante : mécanisme de défense socioculturelle avec deux modalités, à savoir la « communication généralisée » et la « contextualité situationnelle ».
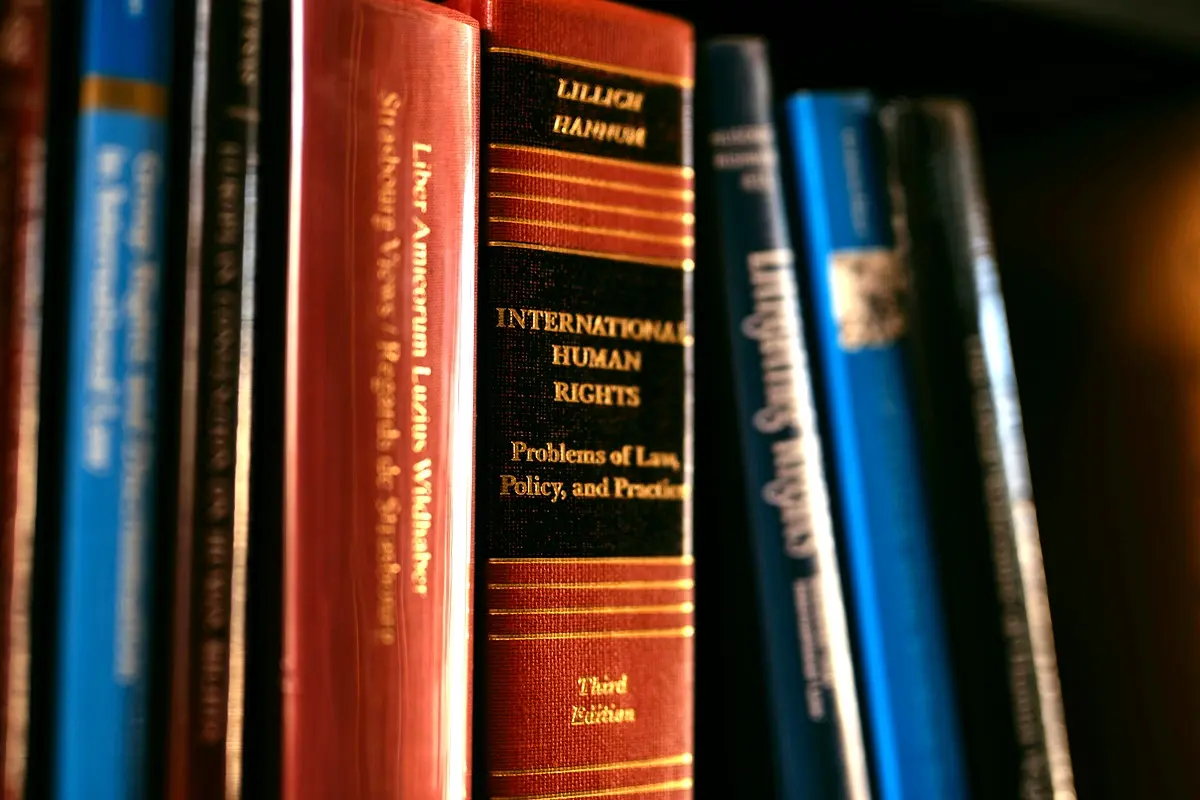
L’acteur social, le mécanisme de défense, la communication généralisée et la contextualité situationnelle sont des concepts spécifiques du concept-fédérateur
« communication interculturelle » qu’Edgard Morin70 et Alex Mucchielli71 appellent « macro- concept ». Ils constituent des matériaux de construction de notre cadre conceptuel et théorique.
- Objectifs de l’étude
Relativement à la question fondamentale soulevée ci-haut, notre recherche poursuit comme objectif principal de décrire les mécanismes défensifs dans une situation d’interculturalité ainsi que les expressions communicatives de leur production. De manière spécifique, il sera question au cours de nos investigations de pouvoir :
- primo, identifier les communications généralisées véhiculant les mécanismes de défense (attitude, conduite, langage et rituel d’interaction) ;
- secundo, déduire les éléments significatifs de la contextualité situationnelle (norme, enjeu, positionnement et relation avec les autres) à partir des communications généralisées ;
- tertio, déterminer le degré de l’influence des variables (physiques, sociales et psychologiques) sur la production des mécanismes de défense à travers les communications généralisées ;
- quarto, identifier les oppositions entre les provinces à partir des éléments significatifs de la contextualité situationnelle des mécanismes de défense.
- Délimitation de l’étude
Pour ce qui est de la délimitation de l’étude, la communication interculturelle se réalise naturellement dans toutes les villes cosmopolites où cohabitent des sujets de différentes origines. Ces villes constituent un cadre idéal d’étude de ce phénomène. Mais, comme nous ne pouvons pas couvrir toutes ces aires culturelles, nous avons constitué un échantillon raisonné composé au total de vingt-deux sujets natifs de leurs milieux respectifs et réparti comme suit : deux sujets venant de Kinshasa et vingt de l’intérieur du pays se trouvant à Kinshasa au moment de l’enquête (du 09 au 30 avril 2013), à raison de deux par province.
Ces sujets sont tirés parmi les étudiants de premières années de graduat (A et B) de l’IFASIC durant l’année académique 2012-2013. Le choix est porté sur ces étudiants pour deux raisons : d’abord, leur accessibilité et ensuite, leur historique culturel, surtout pour ceux de l’intérieur du pays venus tous à Kinshasa depuis environ six mois au moment de l’enquête pour la majorité pour raison d’études, et sont supposés garder encore le « patrimoine culturel »72 de
70MORIN, E., « Messie, mais non », Conclusion au colloque de Cerisy sur l’Argument pour une méthode, Seuil, 1990, p.265.
71MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 39 et 46.
72On entend par « patrimoine culturel, les traditions et expressions orales, les pratiques sociales et rituelles, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, … », tiré de LEGUY, C. cité par PATA KIANTWADI, D. et MBELOLO Ya MPIKO, J., « La place de l’oralité dans la conservation du patrimoine
leur milieu de provenance. Pour vérifier les informations reçues de ces enquêtés, nous avons prévu un « groupe contrôle » composé de onze sujets témoins, dont un par province, parmi les étudiants d’autres promotions de graduat (GII et GIII) et de licence.
- Méthodologie de travail
Sur le plan méthodologique, deux démarches guideront notre entreprise, celles qualitative et quantitative. La démarche qualitative va être appuyée par la méthode de contextualisation situationnelle panoramique qui donne des orientations et des principes- directeurs dans la collecte et le traitement de données. Cette méthode bénéficie des services de
« l’Entretien Semi-Directif Centré (ESDC) » pour la collecte des données grâce au « guide d’entretien » qui sera construit à partir des mécanismes de défense sus-indiqués, et la technique d’analyse de contenu pour le traitement des données qualitatives à partir du tableau panoramique proposé par Alex Mucchielli et Claire Noy73.
Du fait que cette démarche qualitative ne permet pas de mesurer la qualité métrologique de notre instrument de recherche (guide d’entretien) et les effets des variables sur l’apparition des phénomènes sous-examen, nous allons, par le principe de triangulation, l’associer à la démarche quantitative. Cette dernière sera appuyée par les tests d’étude métrologique des construits (Chronbach pour la fiabilité et Joreskog pour validité convergente), le test Q de Qochran pour le contrôle des effets de la variable « province d’origine » et l’Analyse Factorielle des correspondances (AFC) pour découvrir les oppositions ou les ressemblances entre les provinces. C’est au terme de l’analyse des données de l’enquête que sera validée notre hypothèse de recherche.
- Structuration du travail
Notre travail comporte deux parties, hormis l’introduction et la conclusion générales. La première partie traite du « cadre conceptuel et théorique de la communication interculturelle ». Il y est question de développer, en premier lieu, les notions (premier chapitre) de ce macro- concept, en deuxième lieu, les facteurs ainsi que les mécanismes de défense produits dans la communication interculturelle (deuxième chapitre) et, en troisième lieu, de circonscrire le cadre théorique servant de sous-bassement à cette étude (troisième chapitre).
La deuxième partie examine, quant à elle, « le cadre méthodologique, la présentation et l’analyse de données empiriques ». Il y est question de décrire le cadre méthodologique de l’étude (quatrième chapitre), la présentation et l’analyse qualitative des données relatives aux
culturel kongo à l’ère de l’écriture et des NTIC », in Cahiers congolais de communication, Vol. X, L’Harmattan, 2013, p. 126.
73MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 84 et 110.
mécanismes psychiques de base et situationnels (cinquième chapitre), la présentation et l’analyse qualitative des données relatives aux mécanismes discriminatoires et ethniques (sixième chapitre), l’analyse quantitative des données de quatre catégories de mécanismes en vue de consolider les résultats des analyses qualitatives et, en dernier lieu, l’interprétation des résultats pour valider l’hypothèse de recherche (septième chapitre).
________________________
70 MORIN, E., « Messie, mais non », Conclusion au colloque de Cerisy sur l’Argument pour une méthode, Seuil, 1990, p.265. ↑
71 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 39 et 46. ↑
72 On entend par « patrimoine culturel, les traditions et expressions orales, les pratiques sociales et rituelles, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, … », tiré de LEGUY, C. cité par PATA KIANTWADI, D. et MBELOLO Ya MPIKO, J., « La place de l’oralité dans la conservation du patrimoine ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les mécanismes de défense en communication interculturelle ?
Les mécanismes de défense en communication interculturelle incluent des mécanismes psychiques de base, situationnels, discriminatoires et ethniques.
Comment identifier les communications généralisées véhiculant des mécanismes de défense ?
Il est question d’identifier les communications généralisées à travers l’attitude, la conduite, le langage et le rituel d’interaction.
Quel est l’objectif principal de l’étude sur la communication interculturelle ?
L’objectif principal de l’étude est de décrire les mécanismes défensifs dans une situation d’interculturalité et les expressions communicatives de leur production.
Comment la recherche délimite-t-elle l’étude de la communication interculturelle ?
La recherche se limite à un échantillon de vingt-deux sujets natifs de leurs milieux respectifs, répartis entre Kinshasa et l’intérieur du pays.