La méthodologie de communication interculturelle révèle des mécanismes de défense insoupçonnés dans le contexte congolais. Cette recherche novatrice, alliant psychologie et communication, promet de transformer notre compréhension des interactions interculturelles, avec des implications profondes pour les pratiques sociales et professionnelles.
Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la Communication « IFASIC »
Département du 3ème cycle
Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sciences de l’Information et de la Communication « SIC »
Communication interculturelle dans le contexte congolais
Project presentation
Identification des mécanismes de défense à travers les communications généralisées processuelles
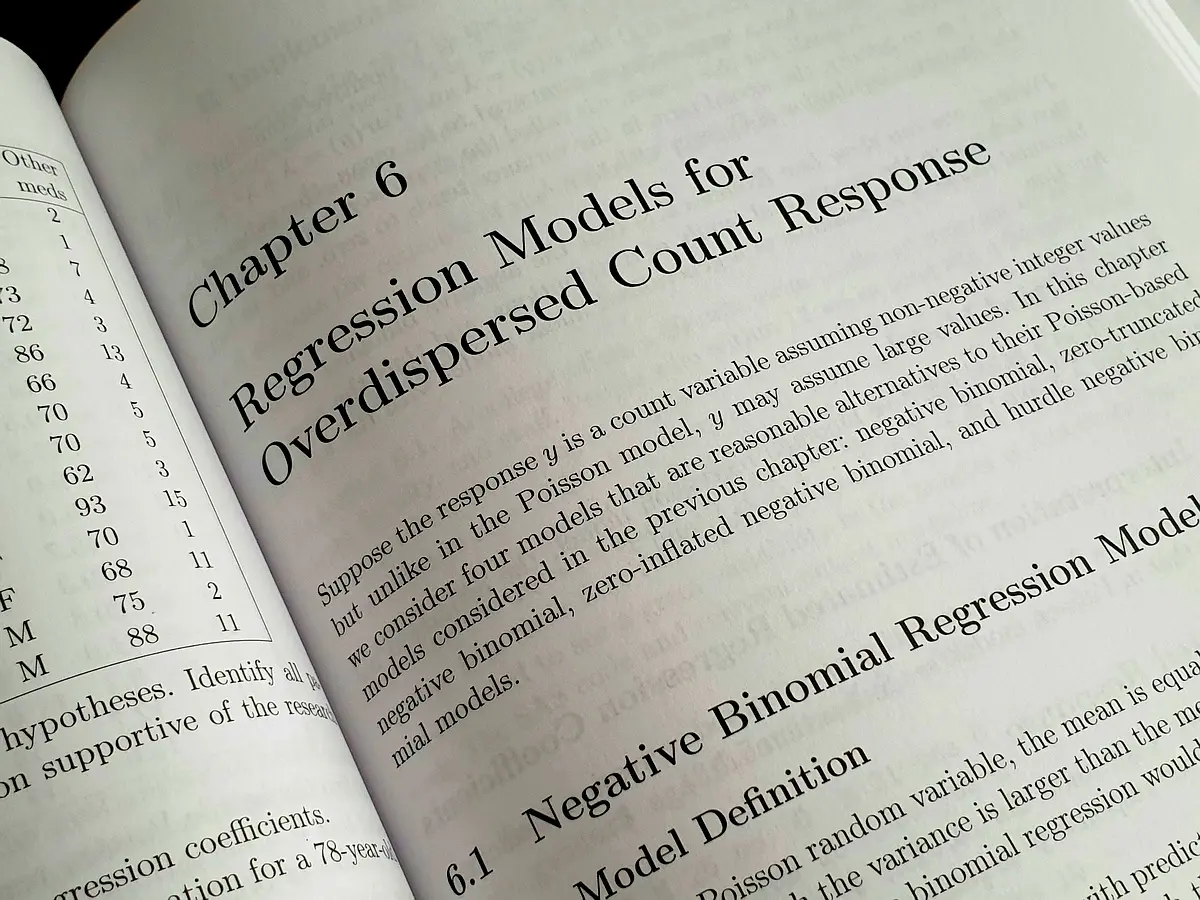
Pata Kiantwadi David
(Licencié en Psychologie du travail)
Promoteur : Ekambo Duasenge Jean-Chrétien, Professeur Ordinaire & Co-Promoteur : Kanga Kalemba-Vita Jean, Professeur Émérite
Mai 2014
Sommaire
Introduction générale
Première partie : Cadre conceptuel et théorique de la communication interculturelle
Chapitre I : Fondement scientifique de la communication interculturelle
Section 1 : Définitions et nature de la communication interculturelle
Section 2 : Objet d’étude de la communication interculturelle
Section 3 : Dimensions de la communication interculturelle
Section 4 : Opérationnalisation du concept « communication interculturelle »
Section 5 : Conclusion partielle du premier chapitre
Chapitre II : Facteurs explicatifs de la communication interculturelle et mécanismes de défense
Section 1 : Acteur social ou sujet communicant
Section 2 : Facteurs explicatifs de la communication interculturelle
Section 3 : Mécanismes de défense socioculturelle
Section 4 : Opérationnalisation des concepts-clés
Section 5 : Conclusion partielle du deuxième chapitre
Chapitre III : Cadre psychologique de la communication interculturelle
Section 1 : Nécessité du cadre psychologique dans l’étude de la communication interculturelle
Section 2 : Psychologie interculturelle
Section 3 : Constructivisme
Section 4 : Souci d’un cadre de référence théorique à construire
Section 5 : Modèle du cadre de référence théorique de notre recherche
Section 6 : Conclusion partielle du troisième chapitre
Deuxième partie : Cadre méthodologique et présentation des données empiriques
Chapitre IV : Méthodologie de travail
Section 1 : Méthodologie qualitative de l’étude
Section 2 : Méthodologie quantitative de l’étude
Section 3 : Population et échantillon d’étude
Section 4 : Conclusion partielle du quatrième chapitre
Chapitre V : Analyse des mécanismes psychiques de base et situationnels à travers les communications généralisées et contextuelles
Section 1 : Analyse quantitative des éléments communicationnels des mécanismes psychiques de base
Section 2 : Analyse quantitative des éléments communicationnels des mécanismes situationnels
Section 3 : Conclusion partielle
Chapitre VI : Analyse des mécanismes discriminatoires et ethniques à travers les communications généralisées et contextuelles
Section 1 : Analyse quantitative des éléments communicationnels des mécanismes discriminatoires
Section 2 : Analyse quantitative des éléments communicationnels des mécanismes ethniques
Section 3 : Conclusion partielle
Chapitre VII : Analyse quantitative des données et interprétation des résultats
Section 1 : Analyse quantitative
Section 2 : Interprétation des résultats de l’étude
Section 3 : Conclusion partielle
Conclusion générale
Bibliographie
Annexes
Table des matières
- Introduction générale
Notre introduction générale s’articule autour de huit points : le contexte de l’étude, la revue de la littérature, la question de recherche, l’hypothèse de recherche, les objectifs de l’étude, la délimitation de l’étude, la méthodologie du travail et la structuration du travail.
- Contexte de l’étude
La présente étude s’inscrit dans la catégorie des travaux scientifiques visant à déterminer la part de la culture dans le processus de la communication, car « la culture est communication et la communication est culture » 1. C’est donc le prolongement de « Cultural studies ». Pour éviter d’aller au-delà des limites qui nous amèneraient dans des considérations évasives, nous tenons à préciser qu’il est question ici, dans le cadre d’une recherche exploratoire, d’aborder notre sujet selon l’approche de la « Psychologie interculturelle » à partir de laquelle nous analysons les mécanismes de défense socioculturelle produits par les sujets congolais à travers les communications généralisées processuelles.
Selon le modèle orchestral de la communication développé par Théodore M. Newcomb2, George Gerbner3, Matilda et John Riley4, notre étude se situe au niveau des acteurs sociaux (Emetteur & Récepteur) impliqués dans le processus de la communication, ils sont caractérisés par des attitudes et des motivations. Il met également l’accent sur la liaison du message au contexte.
A cet effet, l’inscription de cette recherche dans le champ des sciences de la communication reflète non seulement la nature fondamentalement communicationnelle de son objet d’étude, mais surtout les influences théoriques qui ont façonné la manière dont cet objet est abordé ici. Dans cette perspective, l’ambition de notre mémoire est de contribuer, aussi modestement que possible, à l’enrichissement des problématiques et des données qui forment le patrimoine de ces sciences.
Ses apports concourent ainsi à :
- l’exploitation de l’approche psychologique dans la compréhension des phénomènes relevant de la communication interculturelle ;
- l’analyse définitionnelle et sémantique du concept « communication interculturelle » en termes de définitions et nature, d’objet d’étude, de dimensions (communicative et interculturelle) et de facteurs explicatifs ;
- l’application de l’approche constructiviste dans l’analyse des phénomènes relevant de la communication interculturelle ;
1 Hall, E. T., Le langage silencieux, Paris, Seuil, 1984, p. 219.
2 Newcomb, T.M., « An Approach to the Study of Communicative Acts », in Psychological Review, Vol. 60 (6), 1953, pp. 393-404.
3 Fiske, J. (edit.), Introduction to communication studies, New-York, Routledge, 2011, pp. 24-28.
4 Riley, M. and Riley, J., « Mass Communication and the Social System », in Merton, R.K. and alii, “Sociology Today”, Volume II, Harper, New York, 1965, pp. 537-578.
- la triangulation des approches qualitative et quantitative dans l’étude des phénomènes psychologiques de la communication interculturelle ;
- la mise au point d’un cadre théorique de référence pour étudier la communication interculturelle.
Comme nous pouvons le remarquer, il est aujourd’hui absurde de nier que la communication interculturelle est au cœur des enjeux de nos sociétés. A ce sujet, Alain Tourraine5 estime que la communication interculturelle aura été un succès dans une société capable de reconnaître des individus, des groupes sociaux et des cultures en même temps qu’elle tentera de les mettre ensemble en suscitant le désir de se reconnaître dans l’autre avec le même travail de construction qu’on opère en soi-même pour se reconnaître.
Cette communication s’élabore dans un processus sociétal dynamique et interminable à travers quatre étapes tel que postulé par Paul-Marcel Lemaire6. La première étape se rapporte à la manifestation de l’intérêt réciproque des partenaires l’un pour l’autre. La deuxième étape consiste en l’édification de la communication comme une séquence de libres « réponses » réciproques aux interventions des partenaires.
La troisième étape de l’élaboration de la communication comme reconnaissance réciproque des « intentionnalités » communicatives des partenaires (qu’est-ce qu’il veut dire ? qu’est-ce qu’il recherche ?). La quatrième étape est celle où la communication est poursuivie comme quête et construction d’un « espace de partage », chacun ayant sa façon propre de construire cet espace, le partage est meilleur lorsque les différences culturelles accèdent à leur pleine liberté à travers une véritable collaboration.
Dans ce processus, il n’y a pas de frontières entre les humains et les sociétés. Il y a plutôt un métissage culturel qui nous ouvre à tout l’univers, surtout que « tout individu, tout groupe social, toute institution, voire tout pays, est culturellement plus riche s’il participe organiquement à plus d’une culture. Ainsi, toute culture a absolument besoin d’autres cultures pour ne pas étouffer ses membres et ne pas dépérir elle-même »7. Cet échange met en jeu une double dimension : les interlocuteurs se transmettent des informations à travers le langage verbal ou non-verbal (dimension linguistique et extralinguistique), en même temps qu’ils construisent des relations qui déterminent leur engagement (dimension relationnelle).
Malgré cette double dimension, linguistique et relationnelle, Martine Abdallah-Pretceille8 pense que la communication doit être placée dans son contexte culturel. Ainsi dans la communication interculturelle les informations émises doivent être placées dans leur
5 Tourraine, A., « Les conditions de la communication interculturelle : faux et vrai problème », in Michel, W. (dir.), Une société fragmentée ? Le multiculturalisme en débat, Paris, La Découverte, 1996, pp. 291-316.
6 Lemaire, P.-M., « Communication interculturelle : L’action nationale », in Gazelle, vol. 12, n°10, 1987, p. 595.
7 Ibid, pp. 586-590.
8 Abdallah-Pretceille, M. et Porcher, L., Education et communication interculturelle, Paris, P.U.F, 1996, pp. 55-56.
contexte d’énonciation et de production. Elles ne prennent sens que dans une situation précise. Les faits culturels comme les mots sont polysémiques, ils ne signifient rien hors contexte et nécessitent une analyse, une démarche interprétative. Il s’agit là d’une approche pragmatique, d’une pragmatique culturelle.
Cette forme de communication ne concerne pas seulement le dialogue entre les nationaux et les étrangers (les cultures nationales) ; elle peut aussi viser une communication entre les individus d’un même groupe social (les cultures générationnelles), puisque « chaque individu tire en effet son identité d’appartenances culturelles multiples, qui dépendent des groupes auxquels il se rattache en fonction de ses origines ethniques, sociales, de son âge, de sa situation familiale, de sa personnalité, de son sexe, etc. Dans les faits, ces « identités » culturelles différentes s’entrecroisent pour former l’identité de l’individu » 9.
En effet, dans le contexte multiculturel de la RDC, les gens d’origines ethniques ou culturelles différentes sont appelés à cohabiter dans les différents milieux sociaux (foyer, parcelle, quartier, ville, marché, école / université, entreprise, confession religieuse, …). « Cette cohabitation impose un dialogue interculturel qui n’est pas en réalité un fait acquis, mais plutôt construit dans la mesure où il s’élabore.
Le dialogue dont il est question ici a lieu au moment où s’opère la rencontre des univers culturels différents, laquelle rencontre peut engendrer trois situations au niveau des groupes culturels, voire même des individus. Il s’agit de l’assimilation, la ségrégation et le métissage culturel10. L’assimilation, c’est-à-dire la culture dominante prend le dessus sur l’autre, considérée comme faible.
La ségrégation culturelle, c’est une situation où les groupes culturels coexistent avec un minimum de contacts et vivent séparés les uns des autres, selon leurs caractéristiques propres. Le métissage culturel, c’est-à-dire les cultures en contact aboutissent à une nouvelle synthèse.
Lorsqu’il s’agit du syncrétisme, c’est-à-dire métissage culturel, le problème ne se pose pas puisque les interlocuteurs partagent les mêmes valeurs, normes et croyances ; mais lorsqu’ils dominent ou sont dominés par la culture d’autrui (assimilation) ou qu’ils gardent intacts leurs traits culturels sans céder à la pression des autres (ségrégation), chaque membre développe un sentiment soit de puissance dans le cas de domination, soit d’impuissance dans le cas d’assimilation ou soit de discrimination et de rejet dans le cas de ségrégation.
Lors des dialogues entre les individus issus d’aires culturelles différentes, l’interactivité se met en jeu avec des identités culturelles différenciées par des « processus psychiques »,
9 Rahal, A., « Formation à l’interculturel », pp. 2-3, document téléchargé le 29 juin 2012, URL : http://www.ac-reims.fr/canav/…/formation/formation_interculturel.pdf.
10 Ntonda, K.P., « Regard sur la communication interculturelle à Kinshasa», in Cahiers Congolais de Communication, Vol. IX, n°2, Août 2010, p. 45.
appelés « dimensions cachées » par Edward Twitchel Hall11, « processus sociocognitifs » par Edmond Marc Lipiansky12 ou « processus psychosociaux » par Martine Abdallah-Pretceille13 ou Tania Ogay14 pour produire des phénomènes psychosociaux agissant comme un prisme déformant et préjudiciant les interactions. Face à cette situation, Nicole Carignan15 nous demande de comprendre la manière d’établir la communication multi et interculturelle.
La communication multiculturelle reconnaît la différence tandis que la communication interculturelle valorise la prise en compte des ressemblances, de l’échange, de la réciprocité et de la solidarité ; car, dans ce processus chargé d’interculturalité, les individus font face à des identités culturelles déjà construites. Edward Twitchel Hall16, de son côté, nous conseille d’aller au-delà de la culture, c’est-à-dire de comprendre le caractère organique des différences culturelles et de nous impliquer de manière active et consciente dans les aspects de notre existence qui nous semblent les
plus naturels.
Dès lors, il se pose la question fondamentale suivante qui, depuis des années, a toujours fait l’objet de débats et de recherches dans les milieux scientifiques : Comment se comportent les individus d’origine ethnique et culturelle différente dans un contexte multiculturel ? Cette problématique, signalons-le, a toujours été au centre des Cultural Studies, un courant de pensée né à Birmingham et défini par Eric Macé17 comme l’étude des rapports conflictuels de pouvoir dans la culture, à ne donc pas traduire par études culturelles pour autant que c’est une expression.
________________________
1 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
2 Newcomb, T.M., « An Approach to the Study of Communicative Acts », in Psychological Review, Vol. 60 (6), 1953, pp. 393-404. ↑
3 Gerbner, G., « Mass Communication and the Social System », in MERTON, R.K. and alii, “Sociology Today”, Volume II, Harper, New York, 1965, pp. 537-578. ↑
4 Riley, M. and Riley, J., « Mass Communication and the Social System », in MERTON, R.K. and alii, “Sociology Today”, Volume II, Harper, New York, 1965, pp. 537-578. ↑
5 Tourraine, A., « Les conditions de la communication interculturelle : faux et vrai problème », in MICHEL, W. (dir.), Une société fragmentée ? Le multiculturalisme en débat, Paris, La Découverte, 1996, pp. 291-316. ↑
6 Lemaire, P.-M., « Communication interculturelle : L’action nationale », in Gazelle, vol. 12, n°10, 1987, p. 595. ↑
8 Abdallah-Pretceille, M. et Porcher, L., Education et communication interculturelle, Paris, P.U.F, 1996, pp. 55-56. ↑
9 Rahal, A., « Formation à l’interculturel », pp. 2-3, document téléchargé le 29 juin 2012, URL : http://www.ac-reims.fr/canav/…/formation/formation_interculturel.pdf. ↑
10 Ntonda, K.P., « Regard sur la communication interculturelle à Kinshasa», in Cahiers Congolais de Communication, Vol. IX, n°2, Août 2010, p. 45. ↑
11 Hall, E. T., Le langage silencieux, Paris, Seuil, 1984, p. 219. ↑
12 Lipiansky, E. M., « Processus sociocognitifs », in Psychologie interculturelle, Paris, P.U.F, 1996. ↑
13 Abdallah-Pretceille, M., « Processus psychosociaux », in Education et communication interculturelle, Paris, P.U.F, 1996. ↑
14 Ogay, T., « Processus psychosociaux », in Education et communication interculturelle, Paris, P.U.F, 1996. ↑
15 Carignan, N., « Communication multi et interculturelle », in Education et communication interculturelle, Paris, P.U.F, 1996. ↑
16 Hall, E. T., Le langage silencieux, Paris, Seuil, 1984, p. 219. ↑
17 Macé, E., « Cultural Studies », in Education et communication interculturelle, Paris, P.U.F, 1996. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les mécanismes de défense socioculturelle identifiés dans la communication interculturelle au Congo?
L’étude identifie des mécanismes de défense socioculturelle à travers les communications généralisées processuelles.
Quelle méthodologie est utilisée pour l’étude de la communication interculturelle dans le contexte congolais?
L’étude adopte une approche de psychologie interculturelle et utilise le modèle orchestral de la communication, combinant des méthodologies qualitative et quantitative.
Quel est l’objectif principal de la recherche sur la communication interculturelle au Congo?
La recherche vise à développer un cadre théorique de référence pour l’étude de la communication interculturelle.