L’interaction didactique dans Ravisseur joue un rôle crucial en remplaçant ou complétant les séquences narratives, facilitant ainsi la progression de l’intrigue. Cette analyse met en évidence comment les dialogues transmettent des informations essentielles tout en révélant des rapports d’enseignement entre les personnages.
II. 2. 3. L’interaction didactique
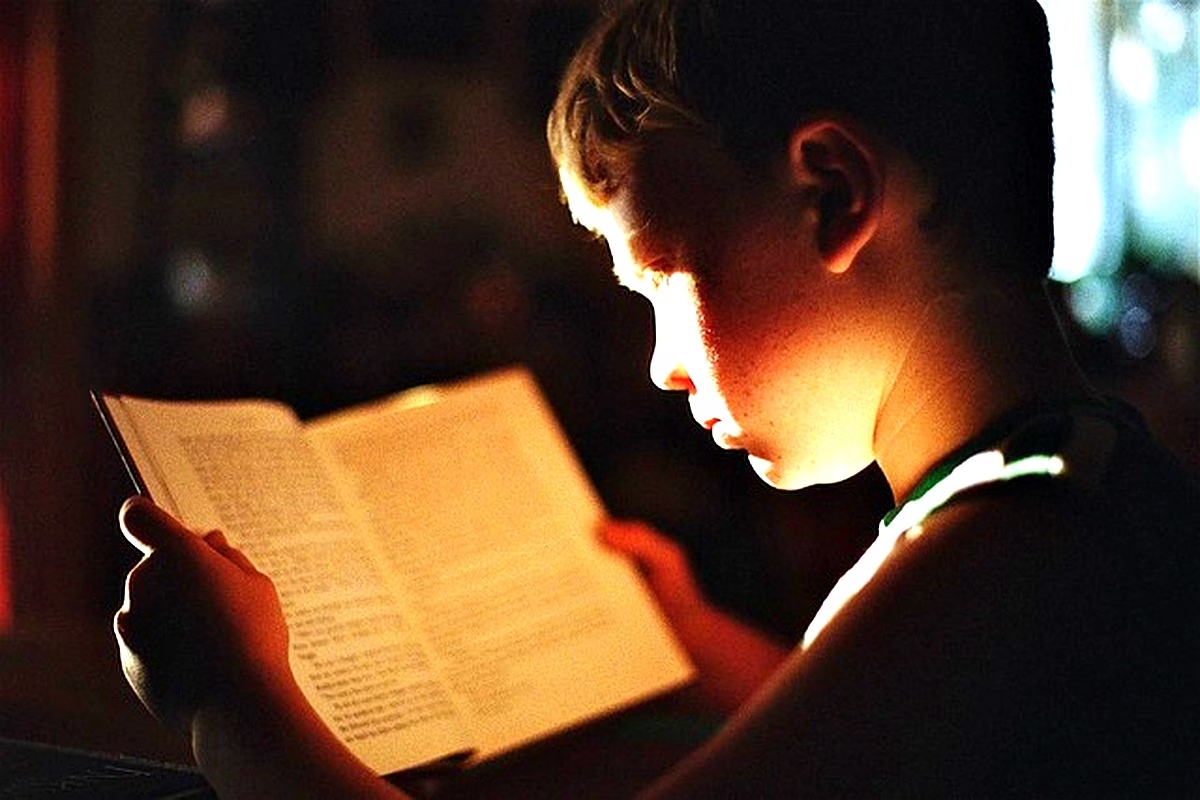
Jusque là, nous avons montré que le dialogue remplace les séquences narratives ou plutôt les complète pour fixer le discours de la narratrice.
Cela dit que la fonction première des dialogues est de faire progresser l’intrigue en apportant des informations multiples.
De ce fait, outre les rapports de base déjà étudiés, s’ajoute le rapport d’enseignement qui se subdivise en deux rapports soit la demande d’information et l’information fournie. C’est ce que nous entreprendrons d’analyser en nous appuyons sur quelques exemples d’échanges.
Posons d’abord le principe de ce rapport selon le travail qu’a mené Berthelot dans son ouvrage. Il stipule que le rapport d’enseignement « joue un double rôle : Au niveau extradiégétique, elle a sur le lecteur un effet direct dans la mesure où elle l’instruit (ou non) lui-même ; Au niveau intradiégétique, elle fait progresser l’intrigue par les réactions que sa transmission entraîne. 1»
Selon cette définition deux cas se présentent: l’information transmise à un personnage au cours d’un dialogue figure déjà dans la narration, ce qui importe alors le lecteur, est la manière dont elle annoncée et reçue par les interlocuteurs. Dans le cas contraire, l’information est transmise
1 Cf. Berthelot Francis. Op. cit. p. 38-47 ↑
simultanément au personnage et au lecteur. L’intérêt d’un tel procédé et de faire partager aux personnages et aux lecteurs les mêmes émotions. Nous rencontrons ces deux cas dans les dialogues insérés dans le récit de Marouane.
Dans le dialogue qui ouvre le roman, Aziz explique à son interlocuteur que Samira n’est plus jeune fille et a été violée. Cette information transmise au cours du dialogue est essentiellement adressée au lecteur. D’ailleurs, le père insinue que tout le quartier, a pris connaissance de cette histoire.
- Qui voudrait d’une fille qui n’est plus jeune fille ? Ne prenez pas cet air étonné, l’imam, dans ce quartier, il n’y a pas de secret inviolable. Ça ne me bouleverse plus, rien ne me bouleverse, du reste. Je suis condamné à voir et à avoir cette simulatrice sous mon toit jusqu’à la fin de mes jours. Pour un milliard de dollars, on ne m’en débarrasserait pas. (p. 19)
Cette information est reprise dans le discours de Khadidja, mais en y ajoutant une autre information : la petite dernière, en l’occurrence Zanouba n’est pas la sœur de la narratrice mais sa fille.
- Pourquoi ne te repens-tu (Samira) ?
– (…)
- De ce que tu as fait, bernant les autres et ton frère qui croit te venger et le fait au détriment de ses convictions.
- Dieu est juste, je vais prier pour qu’il ait pitié de mon mari (Omar) et de l’âme de ton enfant (Zanouba). (p. 75-76)
Les exemples sus-citésmontrent que le lecteur détient deux informations- que la narratrice-personnage, ignore ou plutôt a oublié. Ces informations fournies lui permettent de comprendre enfin, pourquoi Aziz considère sa fille comme « une simulatrice, sournoise, fugueuse, menteuse, à la mémoire soi-disant trouble » (p. 17).
Le lecteur connaît la vérité, alors qu’il a fallu un travail de mémoire pour que la narratrice se souvienne du viol.Toutefois, le lecteur ignore dans quelle circonstance et quand elle a été violée et donné naissance à Zanouba,. Ces informations et plus particulièrement, la naissance de Zanouba, le lecteur en aura connaissance, plus loin, et en même temps que la narratrice à travers le discours de ses sœurs.
Quelques jours plus tard, alors que Noria et Fouzia vaquaient sur les marchés, Yasmina me dit :
- Tu te souviens de tout ?
- Oui…A quelques détails près. Peut-être.
- Papa a donc cogné au bon endroit, dit Amina. Puis :
- Tu les veux dans l’ordre ou dans le désordre, les détails ?
- Tu voudrais vraiment qu’on en parle ? demanda Yasmina.
- Oui.
- Papa a réparé ce que les autres et lui-même avaient déglingué, dit Amina.
- C’était tout de même osé d’affirmer que tu étais morte, sourit Yasmina. Comme ça, sans ciller. Il n’empêche que tu as été à deux doigts de le convaincre.
- Il t’aurait préférée morte plutôt que souillée. Alors il t’a battue. Il faut dire que, cette fois-là, il n’a pas eu le temps de te défigurer comme pour le gigot d’agneau. Il avait perdu connaissance avant. Et maman était là.(p. 126)
- Tu es sûre de vouloir en parler ? demanda encore Yasmina.
- Oui !
- Bon dit-elle.
Mais elle ne pipa mot.
C’est Amina qui enchaîna : (p. 127)
- Quand tu as commencé à grossir, maman t’a serrée dans une gaine et elle s’est mise à porter un coussin sous sa robe. Puis elle n’a plus dormi que dans ta chambre, prétextant qu’elle ne supportait pas sa grossesse…. Tu te souviens de ça ?
- Vaguement, souffai-je
– […] (p.127-128)
- (…) En tout cas, elle aura brillé dans son numéro. En fait elle désobéissait à papa qui voulait que tu te fasses avorter. Il ne croyait pas à une agression
mais, pour sauver la face, disait que le mufti de Bosnie avait bien autorisé l’avortement aux femmes qui…enfin… tu sais…
- (…) Mais Omar était contre, fermement contre. Il voulait que tu aies vivre au bled…avec le bébé. (…)
- Plus tard, reprit Yasmina, indémontable Zanouba naissait aussi costaud qu’un….
- Assez, dis-je à mon tour. (p .129)
La lenteur du dialogue crée un effet d’attente avant de délivrer les informations attendues et nécessaires pour la compréhension des propos de Khadidja. Les explications données sont simultanément destinées à Samira et au lecteur.
Ce dialogue fonctionne selon un implicite entre les personnages qui est marqué par l’inachèvement des phrases et l’utilisation des points de suspension (qui…enfin… tu sais…) et lorsque Yasmina voulait comparer Zanouba à son géniteur, la réaction de la narratrice devient violente, et met fin à la conversation par l’emploi de l’adverbe assez, interrompant sa sœur et lui interdisant de terminer sa phrase.
A la deuxième question, Samira répond : (oui.) Cette question est posée une seconde fois par Yasmina, au dixième tour de parole, la réponse de Samira est toujours : (oui !) Nous enregistrons une légère différence dans les deux répliques de Samira. Cette différence réside dans le changement de ton, mentionné par les signes de ponctuation (utilisation du point, puis du point d’exclamation) expriment l’émotion de la narratrice. Son insistance fait avancer l’échange.
Dans le second cas, le lecteur apprend l’information en même temps que l’allocutaire. Ces dialogues ont alors une fonction « informative ou référentielle 2».
Suivons ces exemples extraits de la deuxième partie du roman:
Khadidja annonce à Samira la disparition d’Omar
- (…) C’est Omar. Il n’est pas rentré.
- Où crois-tu qu’il soit ?
- Ils ont tiré dans la nuit, dit-elle. Il ne reviendra plus. Mort ou vif, ils ne me le rendront jamais.
- Omar est certainement en mer ; il a dû y aller juste après la fête qui s’est terminé tard, ajoutai-je. (p. 75)
Samira demande si son frère est revenu
- Et Omar?
- Toujours pas rentré et papa encore dans la salle de bains. (p.80)
La narratrice annonce à son père la disparition d’Omar
- Omar aussi a disparu.
- Qu’il disparaisse ! vociféra mon père. Qu’il disparaisse ! puisque c’est devenu une habitude dans cette famille ! (p. 86)
Yasmina affirme que son frère a simplement fui la honte
- Enfin, cessons d’être ridicules, répliqua Yasmina. Maman a fui la honte. Et Omar aussi, d’ailleurs. (p. 100)
Khadidja annonce enfin qu’Omar est en Angleterre avec sa mère et Youssef
Elle nous a apprit qu’elle était revenue prendre son baby, l’emmener outre-manche où Omar, Nayla et Youssef Allouchi les attendaient. (p 159)
- Il en a parlé à Omar, qui lui a conseillé de fuir. (p. 160)
L’idée du décès éventuel d’Omar, le sentiment de peur et d’inquiétude se dissipent peu à peu lorsque Yasmina affirme que son frère à seulement fui la honte. Cette idée est confirmée vers la fin du roman par son épouse. Le lecteur partage les mêmes émotions que les personnages au moment où la nouvelle est annoncée : surprise.
L’exemple suivant permet de suivre les explications que donnent Khadidja sur les disparitions successives, et en fournit les raisons au lecteur. Nous proposons d’étudier cette séquence dont l’intérêt est d’englober tous les rapports de base. La séquence d’ouverture correspond à l’information fournie qui provoque, au niveau du corps de la séquence, un désaccord, appelant d’autres informations fournies pour réinstaurer l’accord, et relancer le dilogue sous forme du couple questions/réponses (demande d’informations)
2Gabriel Conesa. Le dialogue moliéresque : étude stylistique et dramaturgique. Paris : SEDES. 1992. p. 95 ↑
Séquence d’ouverture : informations fournies/désaccord
Nous étions dans son appartement, assises autour d’elle, la découvrant comme une nouvelle terre. Elle gava son fils et Zanouba de compote de fruits made in UK , leur fit moult chatouillis dans la langue de Shakespeare, puis elle nous apprit qu’elle était revenue prendre son baby, l’emmener outre-Manche où Omar, Nayla et Youssef Allouchi les attendaient dans un bed and breakfeast.
Elle nous annonça le tout d’un trait, sans ponctuation, les yeux rivés sur Moud qui bredouillait maman à l’une de se tantes.
Les sourires de bienvenue se crispèrent. Puis le silence s’imposa. Noria et Fouzia se mirent à ronger leurs ongles. Amina se leva, lentement. Elle se tint droite et raide comme un soldat saluant la levée des couleurs. Puis elle inspira profondément, le visage sombre de gravité.
Elle dit :
- Que tu raccourcisses tes robes, que tu te maquilles, que tu voyages seule, ça ne nous regarde pas. Au contraire, nous nous réjouissons. De même que nous applaudissons enfin les goûts de notre frère. En revanche, les mensonges, nous ne les tolérons pas. Religion ou non.
Puis après une pause et se détendant :
- Okay, baby ? (p.159)
- Votre mère et son mari sont là-bas. C’est une longue histoire et bien compliquée, mais c’est la vérité, dit notre belle sœur. (p 159)
Corps de la séquence : informations fournies/ retour à l’accord
Nos visages laissaient transparaître notre besoin d’en savoir plus.
- Allouchi a failli avoir des problèmes à cause d’une pièce de théâtre qu’il écrivait dans le désert. L’histoire tournait autour des origines des séismes, des plaques tectoniques ou quelque chose comme ça. Quelqu’un lui avait subtilisé le manuscrit. Il s’en était aperçu la veille du mariage. Ça l’avait tracassé, évidemment. Il en a parlé avec Omar, qui lui a conseillé de fuir. Il n’avait du reste pas le choix. Votre mère l’a suivi de son plein gré. Elle n’aurait jamais supporté de vivre dans le quartier ; cette histoire de remariage lui faisait tellement honte…
Noria et Fouzia pleuraient. Les jumelles ne pipèrent pas mot.
- Il faut dire que Youssef Allouchi est un homme admirable, ajouta ma belle-sœur. Je crois qu’ils s’entendent bien.
- Fouzia se moucha.
- Avons-nous d’autres frères et sœurs ? demanda-t-elle.
- Pas pour l’instant, répondit Khadidja. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite mais je vais quand même vous le dire : Allouchi a promis de s’occuper de vous. Dès que possible.
- Comment ? demanda Fouzia
- Par une procédure qui prendra certainement du temps mais qui aboutira…
- Quelle procédure ? dit Amina en serrant les dents.(p. 160)
- Crémieux. Enfin, je veux dire que les décrets Crémieux avaient fait de sa mère une citoyenne française, ne m’en demandez pas davantage, c’est dans les livres d’histoire. A vrai dire, moi-même je n’y comprends pas grand-chose. Ce qu’il faut retenir, c’est que grâce à ce mariage avec votre mère, vous serez toutes françaises, nous serons tous français, et ainsi vous pourrez les rejoindre. Si vous en avez envie, bien sûr.
- Mais que faites-vous chez les Anglais si Crémieux est français ? demanda Fouzia
- Parce que les bed and breakfast nous sont gracieusement offerts. C’est aussi une histoire de EEC. Et puis c’est provisoire.
- Une histoire de quoi ?
- De CEE… Je ne saurais pas trop expliquer. Sachez seulement que ça va s’arranger pour tout le monde. Okay ? (p. 161)
– (…]
Séquence de clôture : l’accord
- Vous verrez ça le moment venu, dit Khadidja.
Puis elle se jeta sur ses valises.
- Et maintenant, les cadeaux ! c’est votre mère et Allouchi qui vous les envoient. (p.161)
Dans ce cas Khadidja renseigne ses belles sœurs et leur donne un récit détaillé. La demande d’informations se fait d’une manière polie (le cas cité plus haut), mais peut se faire impoliment quand un locuteur exerce une force pour obtenir une information.Nous avons déjà analysé des cas de dialogue lorsque nous avons abordé la relation verticale(Aux interrogations répétées, Samira ne répond pas directement aux questions posées. Après hésitations, elle évoque la naissance de son neveu. Ce n’est qu’après avoir répété la même question six fois, qu’elle répond. Et elle essaye de faire accompagner sa réponse par des justifications. Dans une autre situation, le père contraint Samira à raconter ce qu’elle a subi quand elle a été enlevée)
II. 2. 4. La requête ou l’ordre
Souvent un dialogue s’amorce lorsqu’un personnage souhaite obtenir une information ou une aide d’un autre personnage. Dans le cas de la requête, les relations interpersonnelles jouent un rôle important pour faire agir l’allocutaire.
Dans Ravisseur, nous décelons deux dialogues construits sur ce principe :
| Tableau II.2.4 : Exemples de dialogues dans Ravisseur | |||
|---|---|---|---|
| Page | Personnages | Type de requête | Relation |
p. 62 | Aziz- | La requête du père | Régi par le rapport hiérarchique |
p. 180- | Samira | Demande d’aide pour se débarrasser | Basé sur l’accord et la familiarité |
Le dialogue choisi, présente une double supplique. Le locuteur (Aziz) demande qu’il soit accompagné par une de ses deux allocutaires (Samira ou Yasmina). Pour répondre à sa supplique du père, Yasmina de son côté, demande à Samira de le faire.
- Qui m’a maudit a dit et égrené son chapelet jusqu’aux aurores. Puis gémissant :
- Sauve-moi, ma tante, dis-moi ce qu’il me faut faire.
- Il me faut aller en face, dit-il. L’une de vous va m’accompagner.
Yasmina craignant le scandale que mon père ne manquerait pas de déclencher, me signifia qu’elle se défilait en me pinçant discrètement le bras. Avais-je moins à perdre que ma sœur en m’offrant en spectacle au voisinage, en escortant mon père qui n’allait pas rater l’occasion d’attirer l’attention ? J’étais un peu vexée mais me dévouai. D’ailleurs, j’étais réputée pour avoir la mémoire fragile et le pardon facile.(p. 83)
- Vous n’en parlerez à personne. Surtout pas à Omar, lâcha mon père d’un ton presque normal. (p. 82-83)
Donc Samira répond positivement à cette double requête. Elle accorde sa requête d’abord à Yasmina puis au père. Le rapport hiérarchique, basé sur la crainte, est très explicité dans cet exemple.
Cet autre dialogue comporte deux requêtes, en répondant par écrit à la requête des employés d’Aziz, les filles introduisent elles aussi une requête.
A la fin du mois, des employés de mon père virent s’enquérir de la santé de leur patron, de leur avenir et de leur salaire. Ne sachant que dire, nous demandâmes de repasser. Ce qu’ils firent dès le lendemain.
- Une lettre ! s’écria Amina. Leur répondre par une lettre. Faire semblant qu’elle vient de papa. (p. 103)
- C’est de l’argent qu’ils veulent, pas des mots, répliqua Yasmina.
- Dans la lettre il leur cédera tout !
- Il leur cédera tout. Provisoirement, en attendant le retour d’Omar, précisa Amina. D’ailleurs nous n’avons pas le choix. C’est ça ou le réveil de mon père. (p. 103-104)
- Seule requête : si la pêche était bonne-ce plus pour ajouter à la crédibilité de la donation que par goût, nos préférences allant à la viande rouge, rarissime chez nous- donc, si la pêche était bonne, un cageot de rougets ou de crevettes royales serait apprécié de la famille.
Une fois la donation en main, ils se souvinrent des malheurs de leur patron qui continuaient d’alimenter les cafés du quartier et du port. (..) ils allaient faire bon usage de ce don du ciel. Merci. Mille mercis. Jamais ils ne l’oublieraient.
Nous ne revîmes ni les employés de mon père. Ni les cageots de poisson. (p.104-105)
Les filles délèguent par écrit, les biens de leur père à ses employés mais parallèlement la requête formulée par ces dernières restera sans suite.
Sur l’axe hiérarchique, cette situation reflète la supériorité d’un locuteur sur son allocutaire. Une supériorité qui lui permet de donner des ordres. Ce sont là des dialogues à fonction exhortative.
Dans Ravisseur, les deux personnages ayant cette capacité de donner des ordres sont le père et la fille aînée. Revenons à l’exemple où le père demandait à une de ses filles de l’accompagner chez Allouchi. Une fois chez lui, Aziz ne fait que donner des ordres à sa fille.
- Vous n’en parlerez à personne. Surtout pas à Omar.
Mon père se mit sur le côté et, par de grands gestes, m’intima de frapper. Je m’exécutai.
- Plus fort, souffla-t-il.
- Allume, dit mon père, jurant puis humectant ses doigts de salive. (p. 83-84)
Quand le père lâcha les rênes, c’est la sœur aînée qui prend tout en charge, et donc elle acquiert un pouvoir et une autorité mais qu’elle n’utilise que dans les cas extrêmes.
- Vous irez à l’école, dis-je .
Mon ordre était indiscutable. (p. 148)
- Appelons chez Allouchi, dis-je en quittant le lit.
- Le téléphone est coupé.
- Alors sortons, allons voir ce qui se passe chez lui.
- Tu n’y penses pas…
- Si, si, j’y pense.
- Et papa ? Que fais-tu de papa ? Et il faut que tu manges, tu n’as rien avalé de la journée. Tu vas retomber dans les pommes.
- De papa, je fais mon affaire et je mangerai plus tard.. (p 81)
Sur l’axe hiérarchique, le personnage dispose d’un pouvoir absolu et utilise différents moyens pour faire exécuter ses ordres.
Les conversations sont faites de mots. Ces mots représentent les paroles échangées mais les comportements non verbaux et paraverbaux.Ces comportements ouvrent les répliques des locuteurs et fournissent des informations sur la production des paroles.