La femme algérienne et l’éducation sont au cœur de l’analyse des romans ‘La Grande maison’ et ‘Un Été africain’ de Mohammed Dib. Cette étude met en lumière la représentation de l’ignorance féminine dans une société algérienne marquée par la colonisation et les inégalités éducatives.
La Grande maison et Un Été africain
87
L’image de la femme ignorante :
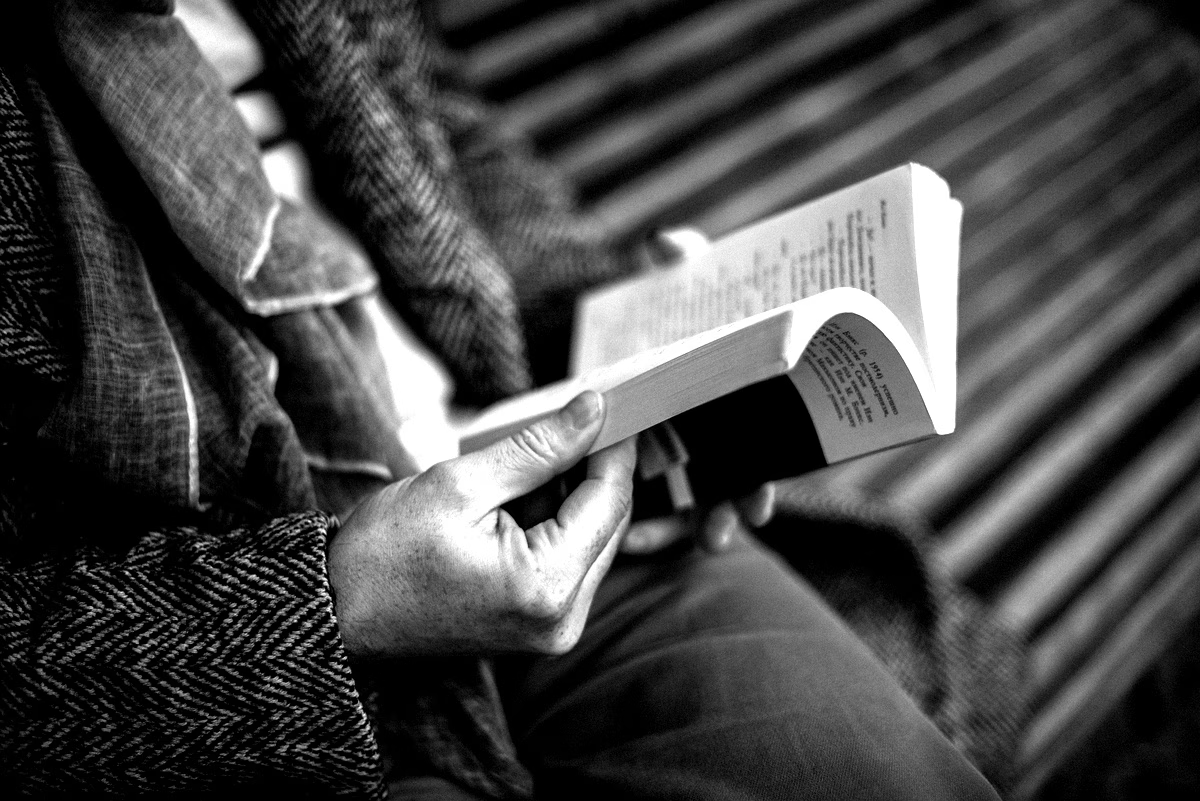
Dans la société algérienne traditionnelle, traumatisée par la colonisation et caractérisée par une population essentiellement rurale et analphabète, les femmes étaient généralement non instruites. Seuls les garçons ont eu le droit de franchir les écoles françaises, alors que les filles suivaient une instruction religieuse qu’elles devaient abandonner dès la puberté.
Laquelle situation est traduite par Mohamed Dib dans son œuvre La Grande maison, où il met en évidence des personnages féminins incultes, occupées uniquement de leur gagne-pain. À cet égard, Zina s’adresse à sa voisine Aïni :
Nous ne comprenions pas toujours. Qu’est-ce que nous sommes ? Une pauvre femme, sans plus ? Nous n’avons pas été instruites et préparée à connaître. (G.M p.65)
De même, Aïni était illettrée, son fils Omar est obligé de l’accompagner chez Gonzalès l’Espagnol pour compter et vérifier les sommes. « Omar venait exprès pour vérifier la somme que l’Espagnol leur remettait. Sa mère ne savait pas compter. (G.M p.132)».
Plusieurs autres passages nous montrent Aïni avec son fils Omar en train de vérifier leurs calculs. Ainsi, dans la scène qui montre Aïni préparant la liste des achats qui ne dépassent pas la farine, la petite Meriem est étonnée à cause de la grande somme que nécessite l’achat de farine.
Sa mère posait l’argent qu’elle rapportait à la maison, sur sa robe tendue entre ses jambes. (…)
- Voilà pour la farine, disait-elle. Vous voyez combien il en faut ? Meriem avait les yeux fixés sur les pièces et les billets mêlés. (…)
- La petite appelait Omar.
- Regarde, lui disait-elle. Il faut tout ça pour la farine seulement.
- Bien sûr, idiote, répondait son frère. (G.M p.133)
Ce passage narratif montre la suprématie intellectuelle du garçon instruit sur la fille illettrée. Avoir traité sa sœur comme idiote reflète le mérite d’Omar d’être instruit au moment où Aouicha, Meriem et Zhor n’ont jamais été à l’école.
En outre, la femme est consciente de son infériorité intellectuelle et de son ignorance. Dans Un Été africain, Yamna s’adresse à sa fille Zakya : «je ne comprends pas ces choses-là ; je suis une pauvre femme, trop ignorante, qui n’a jamais mis les pieds dans une école. (UEAp.100)».
La vieille Razia tient le même langage avec sa belle-fille Yamna : « nous autres femmes, nous sommes sottes par nature. (UEAp.106) ». Ignorante, enfermée, la femme se contentait de ce que lui conseillaient ses parents, son mari et les instructions de la tradition obscurantiste.
D’ailleurs, d’après tante Hasna l’instruction n’est pas utile même pour les hommes. Être instruit, cultivé ne sert à rien, tout ce qu’il faut pour un homme, « qu’il cherche du travail, mugit-elle, qu’il prenne femme et fonde un foyer, plutôt que de perdre son temps à prêcher des billevesées. (G.M p.85/86) ».
Donc, le mariage parait le but essentiel de la vie pour la fille comme pour le garçon. Une fois la fille mariée, elle doit remplir les mêmes devoirs et tâches envers son mari, car comme le dit Lala Razia :
Le mariage, pour une femme, c’est sa fonction, son travail, sa carrière, sa destination. Dis-moi un peu ce qu’elle pourrait faire en dehors de ça ? Et qu’est-ce qu’une femme non mariée ? Hein !…Moins que rien ! (UEAp.107)
Toute la carrière de Zakya, ses études et son baccalauréat ne représentent aux yeux de sa grand-mère qu’un poison et une tentation. Elle s’exprime ainsi :
Il a fallu que ces maudites études viennent lui corrompre le cœur ! Nous avions pensé lui donner une éducation digne d’une bonne famille, et elle n’a appris que poison et tentation. Je m’en rends bien compte maintenant. Elle doit avoir la tête farcie de sottises…comme pas mal de filles d’aujourd’hui. (UEAp.106)
Donc pour la grand-mère l’instruction est inutile. La science et le savoir-faire sont des superflus qui ne font pas le trousseau de la jeune fille le jour de son mariage. Ce dernier qui doit être le but de chaque fille. Toutefois, est-ce que ce statut d’épouse va permettre à la femme de bénéficier d’une autre image plus valorisante ?
L’image de la femme épouse :
La vie dans le milieu traditionnel oblige à la jeune fille dès l’enfance à apprendre comment assurer ses tâches domestiques, pour qu’une fois mariée, elle soit l’épouse modèle qui sert son mari jusqu’à la mort. « Et, mariée, sa règle de conduite doit être la crainte et la soumission : ainsi seulement elle mériterait sa place sur terre et au ciel. (UEAp.107)», explique Lala Razia.
L’épouse ne peut donc exister qu’en fonction de son mari et elle se sent liée à lui. Elle n’a le droit, ni de s’exprimer, ni de montrer son avis, car l’homme lui seul a le droit de prendre les décisions de la famille, et quand il veut quelque chose tous doivent se soumettre.
De ce fait, l’épouse a vécu privée de son être, de parole et d’amour. Mohamed Dib nous explique le pourquoi de son absence, plutôt de sa dissimulation :
Ce pays [l’Algérie] est entré, avec la colonisation et même avant, dans une phase que je qualifierai d' » austérité morale « . Une austérité qui est allée jusqu’à pratiquer la sclérose de la société, qui a entraîné à son tour une certaine paralysie des sentiments. Le mot » amour » est devenu un mot tabou dans la société algérienne.
Dans des conversations familiales, et surtout entre des êtres proches, dans un couple par exemple, ce mot était imprononçable. Que l’on chante l’amour dans la musique andalouse ou dans toutes sortes de chants et que l’on se délecte de cela, c’est une chose, mais quant à le dire, dire » je t’aime » à sa femme ou à son mari, c’est une tout autre chose.
Pour moi, puisque le mot amour était imprononçable, et pour rester fidèle à l’image de la société algérienne, je ne le prononce pas. Je le fais par contre sentir, parce qu’il y a dans la vie comme dans la littérature plusieurs manières de faire sentir qu’on aime quelqu’un. Je le fais sentir pour que, peu à peu, on prenne conscience de ce sentiment et qu’il faut à un moment ou à un autre le dire.1
Cette crainte d’exprimer ses sentiments et ses émotions est nettement ressentie dans le passage qui met en scène Yamna Bent Taleb en train d’arroser les plantes de son jardin en fredonnant un chant lyrique dans lequel elle s’exprime :
Une voix s’élève soudain Et me répond dans la lumière Infinie et toute tremblante :
« Au fil des saisons que les ans
« Passant, mais jeune je demeure,
« Jeune je renais ; aussi jeune
« Que ce jour encore trempé
« De rosée et froid. Aime-moi ! » (UEAp.97)
En prononçant ces derniers mots, Yamna inquiète jette des regards autour d’elle pour s’assurer qu’elle est seule et que personne ne l’entend fredonner ces mots, « Pourquoi des peurs si bizarres fondent-elles sur vous comme un voleur, des fois ? « Comme un voleur », c’est bien ce qu’elle pense en ce moment. (UEAp.97)».
C’est absolument cette paralysie de sentiments que Dib nous a expliqué, et qui fait que Yamna vole des mots captifs dans le coin sombre de la société.
En fait, Mohamed Dib nous présente dans ses œuvres une autre image que celle de l’épouse opprimée, représentée dans l’épouse heureuse malgré les conditions défavorables. Ainsi, Aïni épuisée par les problèmes de pauvreté et de responsabilité, souvenant « des quelques jours heureux qu’elle avait connus durant sa vie conjugale. Depuis quinze ans, c’est-à-dire bien avant la mort de son mari. (G.M p.130) ».
De même, Nafissa dans Un Été africain, bien qu’elle fût heureuse à la compagnie de son mari, elle ne pouvait pas l’exprimer. Toutes les séquences narratives qui nous présentent Nafissa auprès de son mari dévoilent cet amour cachée et imprononçable dont Dib nous a parlé.
Ils boivent leur café en silence. Depuis un instant, Nafissa baisse la tête, songeuse. De temps en temps, Djamal lui lance un bref coup d’œil à la dérobée. Il regarde rarement sa femme, mais chaque fois qu’il y pense il est frappé par son expression d’inaltérable jeunesse. (…) Elle lève ses longs yeux sombres et humides ; son regard croise celui de son mari. Alors elle sourit et rosit un peu plus. Pendant une seconde, leurs regards ne se déprennent pas l’un de l’autre. Elle sourit, et lui il ne sait quelle mine faire. Ils se remettent à boire leur café, les yeux baissés, n’échangeant pas une parole. Et le même silence se prolonge. (UEAp.63/64)
À vrai dire, et comme le dit Dib, ce sont les circonstances sociales, voire économiques qui ont empêché le dialogue entre les maris. Djamal sans travail, habitant une maison où murs, hommes, femmes et enfants s’entassent et se pressent, ne pourrait jamais prononcer un mot.
Il regarde vers la cour. Avec ses voisins, il ne reste plus grand-chose qu’ils ne fassent en commun. Il serre les poings. Il a été maintes fois sur le point de dire à Nafissa que… Mais avec elle, il ne sait même pas comment entamer une conversation. Alors, ça ne va pas plus loin. (UEAp.142/143)
Chômeur, Djamal se sent inutile et nul, il s’exclame souvent : « un homme sans maravédis en poche, qu’est-ce qu’il est, je vous prie ? (UEAp.66) », ou « je suis un homme dont le cœur est mort. (UEAp.137) ». Dans une telle situation, il réfléchit même à quitter la maison conjugale.
Nafissa, désespérée, refuse farouchement que son mari la quitte, « la même douleur aveuglante la transperce toutefois dès qu’il prononce ces paroles abhorrées. C’est plus fort qu’elle. (UEAp.144) ». La présence du mari auprès de son épouse lui donne une protection, une sécurisation et une confiance en elle-même. Ainsi pour Nafissa, «son expression est faite tout ensemble de confiance et d’inattention en soi. (UEAp.63) », quand elle est auprès de son mari.
Le même sentiment de sécurisation et du bonheur est ressenti par Yamna Bent Taleb dans toutes les scènes qui la montrent près de son mari Moukhtar Raï.
Elle vient s’asseoir ensuite au bord d’une chaise, en face de son mari. Un sourire vague erre sur ses lèvres, expriment le bonheur inconscient. (UEAp.08)
Aussi plus loin, «elle va ensuite s’asseoir sur une chaise. Se tenant droite, elle sourit vaguement. (UEAp.47).
Cependant dans Un Été africain on assiste à une famille où l’épouse est appelée à parler, à s’exprimer en toute liberté et en toute franchise. Ba Sahli s’exprime ainsi à son fils Abed à propos de son épouse Aalia, le jour où il décide de rejoindre la révolution :
Je porte témoignage, profère-t-il de sa grosse voix. Je n’ai connu que du bien de ta mère, mais il nous faut la quitter, et il faut qu’elle parle. Qu’a-t-elle à dire de ton père ? Qu’elle parle en toute franchise, et sans crainte. (…) Il se tait et attend. Mais ni sa femme, ni son fils, n’ouvrent la bouche.
- Si elle a quelque chose à me reprocher, reprend alors ba Sahli plus bas, au bout d’un instant de réflexion taciturne, si elle se souvient de quelque tort que j’aie commis à son égard, qu’elle le dise. Sans poser ses regards sur celle qui, âgée aujourd’hui, a partagé l’existence avec lui, l’a servi comme la plus humble et la plus dévouée des servantes, avec un amour qui ignore jusqu’au nom qu’il porte, à celle-là, sans la regarder, il dit du ton de l’homme qui renoncer à son orgueil et à son autorité :
- qu’on on me pardonne mes offenses…je pardonne celles qu’on a pu me faire. (UEAp.175)
Dans cette séquence narrative, Mohamed Dib démontre la valeur qu’avait l’épouse traditionnelle chez son mari qui lui reconnaît tout bien. Dib fait appel pour que toute femme et toute épouse aient une valeur, et qu’elles soient respectées et appelées à s’exprimer.
Aalia est l’image de toute épouse fidèle qui sert son mari, et qui semble le faire avec empressement et amour, car ça fait partie des devoirs de sa vie en tant qu’épouse et c’est une habitude acquise et même désirée inconsciemment.
De même, on trouve cet appel à propos de la femme pour qu’elle s’exprime et donne son avis chez Moukhtar Raï. Ce dernier demande à son épouse son avis à propos du travail de leur fille Zakya. « Moukhtar Raï considère sa femme : – Hein, qu’en dis-tu ? (…) à propos d’un poste d’institutrice.
Yamna jette un regard à sa fille. – Ma foi, rien. (UEAp.09)». Ainsi qu’à propos du mariage de Zakya, Yamna s’exprime : « c’est toi qui sais ; c’est toi le père. Décide comme tu l’entends. (UEAp.103)».
Il semble que Yamna n’a rien dit, comme si elle n’était pas concernée, ni par le travail, ni par le mariage de sa fille, laissant au père le choix de prendre la décision, comme si elle était seulement concernée du trousseau de sa jeune fille qu’elle a préparé depuis longtemps.
En fait, Dib traite à travers les personnages Aalia et Yamna l’image de toute épouse soumise aux traditions rétrogrades qui tuent tout dialogue entre l’homme et sa femme, et font de l’épouse une apparence sans substance. Elles incarnent l’image de la passivité et de la servitude féminine. Et quoiqu’ elles soient appelées à s’exprimer, elles, conscientes de leur être féminin, préférèrent se taire.
Ce qui fait que Allal le frère de Yamna lui dit : « tu ne sais pas défendre tes intérêts, ni ceux de ta fille !(UEAp.130)». D’ailleurs, Yamna n’ose même pas défendre ses idées devant sa belle-mère Lala Razia, considérant la parole de cette dernière comme la vérité qui ne manque pas de preuves : « vous ne dites que ce qui est juste. (UEAp.108)», dit Yamna à sa belle-mère à propos du mariage de sa fille Zakya.
À tort ou à raison, les traditions exigent de l’épouse toute l’obéissance et la servitude à toutes les exigences de sa belle-mère qui veille à la bonne marche de la maison de son fils. Elle n’avait pas d’autre choix, que de supporter les affres d’une telle pression, voire d’une telle discrimination de la part de l’homme et de la belle mère. Et si une fois cette épouse se dérobe face à ses obligations, elle finit par être répudiée et jetée à la rue comme un torchon, avec une marmaille d’enfants sur les bras.
________________________
1 Mohamed DIB, cité par Mohamed ZAUOI, Algérie, Des voix dans la tourmente, in : http://www.fondation-dib.com/site.php?VARID=27 ↑