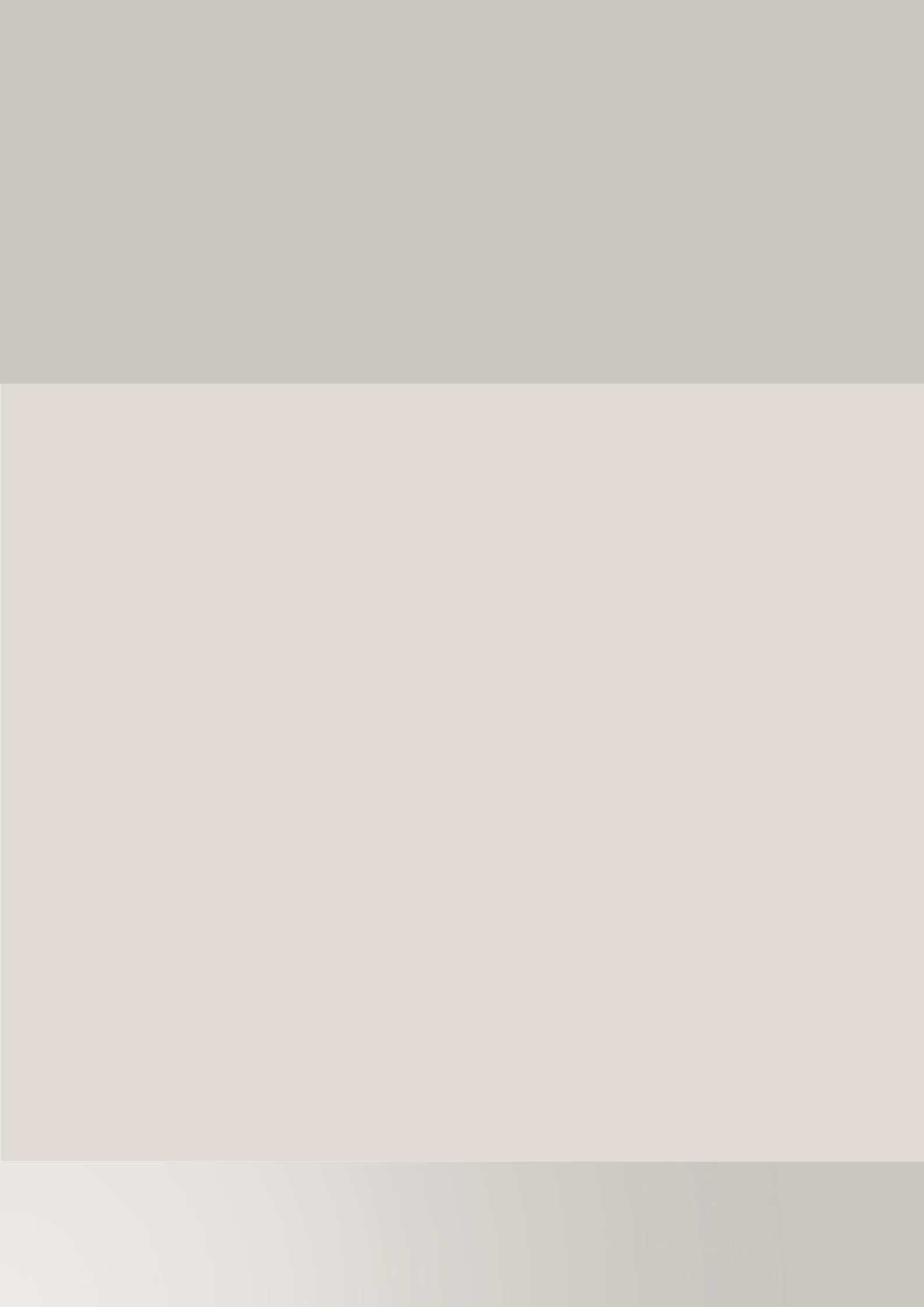Le système de management intégré est essentiel pour un responsable QSE afin d’instaurer des procédures efficaces en matière de Qualité et de Santé & Sécurité au Travail. Cet article explore également l’évolution des normes juridiques et l’importance de l’économie circulaire dans ce contexte.
Ce mémoire étudie comment un responsable QSE peut instaurer des procédures Qualité et Santé & Sécurité au Travail tout en maîtrisant un système de management intégré. Il aborde également l’évolution des normes juridiques et l’importance de l’économie circulaire.
Institut supérieur de formation
HSE Concept – Yyours Formation
Master I — Responsable QSE 2021-2022
Mémoire pour HSE Concept soutenu le 25 Mai 2022 :
Méthodologie du responsable QSE pour instaurer un système de management intégré
[featured_image]
Madame Elodie Grueau
Directeur du mémoire Mr Florimond Saya Responsable pédagogique
2021-2022
SOMMAIRE
Résumé 5
Introduction 6
Partie I. Mise en place d’une démarche qualité 7
Chapitre I. Approche qualité 8
Chapitre II. Échelons de la démarche qualité 16
Chapitre III. Principaux outils du SMQ 23
Partie II. Mise en place d’une démarche SST 31
Chapitre I. Principaux concepts 32
Chapitre II. Encadrement de la SST 39
Chapitre III. Application de la démarche SST 44
Chapitre IV. Focus santé et sécurité au travail 52
Partie III. Mise en place d’une démarche environnementale 58
Chapitre I. L’évolution lente et progressive de la protection de l’environnement 59
Chapitre II. Prévention des risques environnementaux 66
Chapitre III. Construction d’un SME 77
Conclusion générale 86
Annexes 90
Bibliographie 103
Table des matières 105
Résumé
« La maîtrise de la qualité commence par la formation et se termine par la formation. »
~ Kaoru Ishikawa ~
La conjoncture des années 2000 (hausse de l’euro, récession économique (bulle internet) et raréfaction du pétrole à la suite de la guerre en Irak) a marqué un tournant : une prise de conscience de la fin d’un modèle économique et une extension de solutions innovantes.
Il est alors apparu une crise structurelle des pays et des mutations et reconfigurations des systèmes productifs dans cette économie mondialisée, entraînant des changements tant dans les manières de produire, dans les finalités de production, que dans les comportements des acteurs.
Il a été question de répondre à des objectifs d’économie de moyens et de ressources, de réduction des coûts et de compétitivité par l’innovation ; grâce notamment au levier « numérique » qui transforme les activités, les biens et services et tend à une économie plus servicielle.
En conséquence, les clients sont devenus plus exigeants et les concurrents plus nombreux.
Depuis plus de 20 ans, cette révolution des comportements a modelé des actions de prévention et amélioré la démarche QSE dans son intégralité ; afin de quantifier l’épuisement des ressources et mesurer la dégradation de l’environnement.
Les normes juridiques ont évolué dans le monde entier, et un arsenal législatif a été déployé pour accompagner les sociétés dans ce tournant règlementaire. 1
L’économie circulaire s’opposant au modèle classique dit d’économie linéaire (extraire => produire => consommer => jeter) fait alors son apparition en 2010, devenant ainsi la base des cadres politiques mondiaux.
Les agissements responsables permettant de sécuriser le monde du travail changent ainsi le quotidien des entreprises et de leurs salarié(e)s.
En France, la création du métier de Responsable Qualité Santé Environnement a permis une avancée décisive : mener de front les actions globales SSE décidées par la Direction d’une entreprise, grâce à une présence terrain et un rôle pivot ; afin de garantir la satisfaction des objectifs opérationnels et de répondre aux besoins du client.
A travers ce mémoire, nous allons étudier comment un responsable QSE peut préconiser et instaurer des procédures Qualité et Santé & Sécurité au Travail, tout en maîtrisant son système de management intégré.
- (En 2000 le Japon publie la « Loi de base pour la formation d’une société basée sur le recyclage » qui entrainera une initiative internationale du gouvernement japonais sous la dénomination d’initiative 3R (Reduce, Reuse, Recycle))
Introduction
» Il n’y a pas de publicité aussi puissante qu’une bonne réputation qui voyage rapidement «
~ B. Koslow ~
La gestion de la QSE n’est pas un phénomène nouveau.
C’est un sujet qui a progressé depuis vingt ans dans tous les secteurs des entreprises en France et au-delà, à commencer par les secteurs réglementés.
Elle est cependant devenue ces dernières années pour les entreprises un fort enjeu, autant en termes de gestion des risques qu’en termes de réputation, de business et d’enjeux financiers.
En effet, vis-à-vis de leurs parties prenantes et clients, les entreprises doivent répondre de leur politique en matière de prévention des risques et de respect des règles applicables.
Pour les autorités, elles doivent non seulement prévenir les risques mais également être en mesure de démontrer l’effectivité de leurs programmes de gestion QSE.
Par effet boomerang, la QSE a donc vu éclore des nouveaux métiers et un écosystème riche de solutions digitales.
De ce fait, il y a un intérêt croissant des organisations pour la mise en place d’un Système de Management Intégré (SMI), et ce, quelles que soient leurs tailles et leurs secteurs d’activité.
Devenu incontournable, le SMI fait partie de la politique entrepreneuriale et contribue à la pérennité d’une entreprise.
Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et permet aux organisations de relever des nouveaux défis : réduire au maximum les problématiques SSE et les impacts négatifs qui en découlent, afin de satisfaire au mieux leurs clients et/ou investisseurs.
En réduisant leurs coûts et en augmentant leur rentabilité, les organismes peuvent parallèlement développer leur capital humain et financier, améliorer les performances stratégiques et acquérir des nouveaux marchés.
Partie I.
Mise en place d’une démarche qualité
[1_img_1]
Source : https://www.formaplace.me/courses/gpme-e51-cours-gestion-risques-pme/lessons/g-e51-8-la-mise-en-place-dune-demarche-qualite-au-sein-de-la-pme/
Chapitre I. Approche qualité 2
Avant de détailler la démarche qualité dans son ensemble, il convient de définir le concept de qualité.
Section I.
La notion de qualité

Etymologie : Qualité = du latin qualitatem, de qualis, quel (manière d’être 3, nature d’une chose…) ; l’état de « ce qui est comme ça ».
Au départ, la notion de qualité a été attribuée à un produit ou individu ; puis à la clientèle ; et ensuite à une organisation toute entière ; ce qui en fait un concept polysémique.
§ 1. Les différentes perceptions de la qualité
- Définitions
La qualité est étudiée depuis des siècles, en voici quelques définitions de théoriciens par ordre chronologique :
- état, disposition, Aristote
- propriété, attribut, René Descartes
- aptitude à l’emploi, Joseph Juran
- vise la satisfaction des besoins présents et à venir des consommateurs, W.E Deming
- conformité aux exigences, Philippe Crosby
- aptitude à satisfaire le client, Kaoru Ishikawa
- tout ce qui peut être amélioré, Masaaki Imai
Nous retiendrons aussi deux des nombreuses définitions du Larousse :
- « Ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature, à ce qu’on en attend »
- « Ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne »
1 terme créé par Cicéron et répandu par la lang. philos
- Historique
De premier abord utilisée pour définir un standard, la qualité a ensuite permit de contrôler puis d’automatiser les processus de production, pour enfin se tourner vers la satisfaction de besoins et se déployer dans tous les services d’une entreprise.
Cette avancée chronologique correspond à l’évolution industrielle et la production de masse, dont voici quelques dates clés :
- Pendant l’Antiquité, les Egyptiens et les Grecs évaluaient déjà leurs constructions
- Au Moyen-âge, l’estampillage de l’or et les constructions de forteresses, ont nécessité des transmissions de règles de bonnes pratiques via des manuels
- Jusqu’au XIXème siècle, la qualité était inhérente aux métiers manuels et de commerce local
- A partir de l’ère industrielle de 1800 et sa consommation de masse, il a été nécessaire de gérer quelques problématiques, l’ingénieur américain F.W TAYLOR fondera le taylorisme (division du travail et tâches chronométrées pour la chaîne de production, naissance de la sous-traitance) : l’Organisation Scientifique du Travail est née, avec une distinction forte entre ceux qui assemblent et ceux qui décident ; avec pour mot d’ordre augmenter la productivité.
- Le début des années 1900 marque la création du métier d’inspecteur, pour vérifier la qualité des produits finis et déceler visuellement les défauts éventuels.
- 1924 : le docteur W.E DEMING propose une réforme globale du système organisationnel de production, via le management qualitatif et une participation de l’ensemble du personnel : ainsi apparaît le niveau minimum de qualité acceptable à ne pas dépasser pour que le client soit satisfait de son fournisseur ; et l’intégration de la qualité d’un produit dès sa conception.
- En 1926, création de L’Association française de normalisation (AFNOR), qui édite la collection des normes NF
- La consommation de masse engendrera la standardisation et donc la création de normes, l’armée américaine sera pionnière en la matière pour l’armement, de 1930 à 1950, le contrôle de la qualité s’étend ; avec des statistiques de processus.
- En 1954, l’ingénieur et professeur J. JURAN, instaure l’idée d’assurance qualité et d’amélioration continue, dans son ouvrage Quality Control Handbook, qui connut un succès au Japon
- En parallèle dans les années 50, la méthode KAIZEN est lancée par TOYOTA, mouvement qui permet d’accroître la qualité de production par une perspective d’amélioration permanente et par l’implication totale de tous les salariés d’une entreprise
- En 1961, pour le programme spatial APPOLO et le missile PERSHING, l’ingénieur P. CROSBY développe le concept « zéro défaut »
- La même année, première édition de l’ouvrage « Total Quality Control », (de A.V FEIGENBAUM. Feigenbaum a été le premier à utiliser le terme de « maîtrise totale de la qualité » (appelé plus tard Total Quality Management), et à analyser le coût de la non-qualité
- En 1962, Toyota adopte la méthode Just In Time de Taiichi Ōno, communément connue sous le nom des 5 zéros.
- 1970 (USA) Loi imposant L’OBLIGATION DE L’ASSURANCE QUALITE pour la construction des centrales nucléaires.
- 1975 (France) CREATION DU SQUALPI (Service de la qualité des Produits Industriels)
- En 1987, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) adopte les normes internationales d’assurance de la qualité de la série ISO 9000. Elles seront révisées une première en 1994, et une deuxième fois en Décembre 2000.
- Depuis les années 90, le management de la qualité totale est au cœur des préoccupations, pour centrer la démarche qualité sur les préoccupations stratégiques de l’entreprise, et de l’axer vers des modes d’actions techniques ou organisationnels (la notion de groupes responsables, d’unités autonomes).
- Durant la période des années 2000, de nombreuses études ont démontré que l’obtention de certifications ISOs améliorait le rendement financier des entreprises, tout comme leur efficacité commerciale.
A chaque étape de cette chronologie, la dimension humaine d’une démarche qualité s’est fortifiée, mettant en avant la nécessité d’une implication de tous les employés pour parvenir à une performance globale.
§ 2. Des normes pour encadrer la qualité
En tant qu’enjeu principal pour le fonctionnement d’une économie marchande internationale, il était nécessaire de fixer un cadre pour la garantie de la qualité, protégeant ainsi les consommateurs et les producteurs ; tout en suivant l’évolution du rapport fournisseur/ acheteur
- Distinguer norme et standard
Cette différence est parfois source de confusion…
- Un seul terme en anglais : standard
- Deux termes en français : standard, norme
- Définition de Standard : Ensemble de recommandations développées et préconisées par un groupe représentatif d’utilisateurs, à diffusion large
Il permet d’harmoniser l’activité d’un secteur et indique l’état de la science, de la technologie et des savoir-faire au moment de la rédaction ; et donc assure la pérennité et l’évolutivité des contenus et des choix techniques.
- Définition officielle ISO de Norme : « Document établi par un consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et repérés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. »
La norme est un récapitulatif de bonnes pratiques avec des exigences rigoureuses, à destination des entreprises souhaitant obtenir une certification pour la qualité d’un produit ou d’un service.
Elle répond à l’attente d’« assurance qualité » du client, cad une livraison conforme à la commande et certifie que l’entreprise a tout mis en œuvre pour répondre au besoin demandé (via la démarche qualité).
Une norme est un ensemble de règles de conformité ou de fonctionnement légiféré par un organisme de normalisation mandaté, comme l’ISO (International Standardisation Organisation) au niveau international, l’UIT, l’AFNOR (France).
Les normes internationales ISO sont les normes de gestion de la qualité les plus utilisées à l’échelle mondiale.
Il existe 4 types de normes 4:
- Les normes fondamentales : définissent les règles en termes de terminologie, sigles, symboles, métrologie (ex : ISO 2108 définit l’ISBN – Numéro international normalisé du livre, ou ISO 31 pour grandeur et unités)
- Les normes de spécifications : fixent les caractéristiques et seuils de performance d’un produit ou d’un service (ex : EN 2076-2 : Série aérospatiale – Lingots et pièces moulées en alliages d’aluminium et de magnésium – Spécification technique – Partie 2 – Lingots pour refusion.)
- Les normes de méthodes d’essais et d’analyse : elles indiquent les méthodes et moyens pour la réalisation d’un essai sur un produit (exemple : ISO 6506-1 : Matériaux métalliques – Essai de dureté Brinell – Partie 1 : Méthode d’essai).
- Les normes d’organisation : elles décrivent les fonctions et les relations à l’intérieur d’une entité en introduisant des niveaux organisationnels (exemple : ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité et le processus qualité) à travers un guide contenant des lignes directrices.
Dans la dernière version des normes internationales5, la qualité est définie dorénavant comme :
- « Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ».
- « Exigence » : besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés.
- Is0 9001 : Exigences du SMQ
La norme ISO 9000 de 2015 détaille les principes essentiels et le vocabulaire du système de management de la qualité.
Quant à l’ISO 9001, c’est la seule à pouvoir être utilisée pour obtenir la certification DE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ; quand une entreprise a pour stratégie commerciale de donner l’assurance à ses clients des produits ou services uniformes ; et donc créer en amont un système de gestion de la qualité.
- URL : https://www.3-0.fr/accueil-doc-dd/les-labels-et-les-normes/les-normes-iso (consulté le 20 Juillet 2021).
- ISO, ISO 9000 : 2000, systèmes de management de la qualité – principes essentiels et vocabulaire, Genève, déc. 2000, p. 7
Cette norme rassemble 7 principes de management de la qualité pour guider l’amélioration des performances d’une entreprise et a été conçue pour s’adapter à chaque activité et nature d’une
[1_img_2]
Source : www.indiceoconseil.com
organisation 6:
Il est important de relever que pour la version précédente de l’ISO 9001 de 2008, il y figurait 8 principes, avec l’approche système en complément des 7 actuels ; notion finalement intégrée dans l’approche processus ISO 9001 de 2015.
Les principaux enjeux pour une entreprise qui souhaite obtenir la certification ISO 9001 sont :
- Technologique : Innovation des produits ou des processus de réalisation
- Economique : Diminuer les pertes et augmenter les marges, en améliorant sa performance
- Commercial : Perfectionner l’image de l’entreprise et acquérir une nouvelle clientèle
- Communication : Atténuer les sources de conflits internes ou externes (type fournisseurs)
6 URL : www.indiceoconseil.com, consulté le 20 Juillet 2021
Section II.
La politique qualité (chap 5 ISO 9001)
Selon le choix stratégique adopté par la direction d’une entreprise, il existe plusieurs orientations possibles 7 :
[1_img_3]
Source : Slide Player – Stratégies de la Qualité
La politique qualité permet donc de clarifier les orientations générales prises par la direction, grâce à la présence d’un Responsable QSE désigné, qui présentera un plan d’action et une feuille de route des axes prioritaires.8
Les enjeux et les objectifs de qualité sont transmis par écrit à l’ensemble du personnel.
7 Slide Player – Stratégies de la Qualité 8 Doc Player – Manuel Qualité
[1_img_4]
Source : Doc Player – Manuel Qualité