L’hégémonie linguistique en France est mise en lumière à travers l’analyse du Dictionnaire des francophones, un outil politique novateur qui interroge les rapports de force et les enjeux de gouvernance linguistique. Cet article aborde également la lutte contre la glottophobie et son lien avec l’agenda politique français.
Section 2. Questionner le rapport ambigu entretenu à l’agenda politique français
[img_1]
Source : Gasparini, N. (2021c, 3 mars). La langue est politique b [Diapositive]. Formation « La langue est politique », Masters Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3.
A-Une posture dominante : analyse du poids de la France au sein du projet
1. Des rapports de force incontestables : décrypter l’hégémonie en place
Les intentions politiques du DDF nous poussent à questionner les rapports de force inhérents au projet. Le pilotage du projet en France fait débat : « Concernant le DDF, le fait de le mettre en France permet de dire que c’est bien la France qui garde la mainmise dessus. » (Blanchet, 2022, p. 113)
Pour donner à voir les ambiguïtés induites par un portage français, nous avons mobilisé la notion d’« hégémonie » en tant que cadre théorique. Nous l’avons définie au préalable dans le Chapitre 1, Section 2, C, 1 de notre seconde partie d’analyse. Pour rappel, elle s’entend, au sens de Gramsci, comme la « collaboration à une coercition acceptée comme n’ayant pas d’alternative » (Blanchet, dans Ragonneau, 2021).
Il s’agit d’une domination imposée et intégrée, perçue comme étant normale par la frange de la population y étant assujettie et qui, en ne percevant pas d’alternative possible et viable, y consent. Sous cet angle, elle rejoint la notion de violence symbolique. Selon Blanchet, trois voies principales permettent l’imposition d’une hégémonie : le système scolaire, les discours politiques et les médias (2022, p. 108).
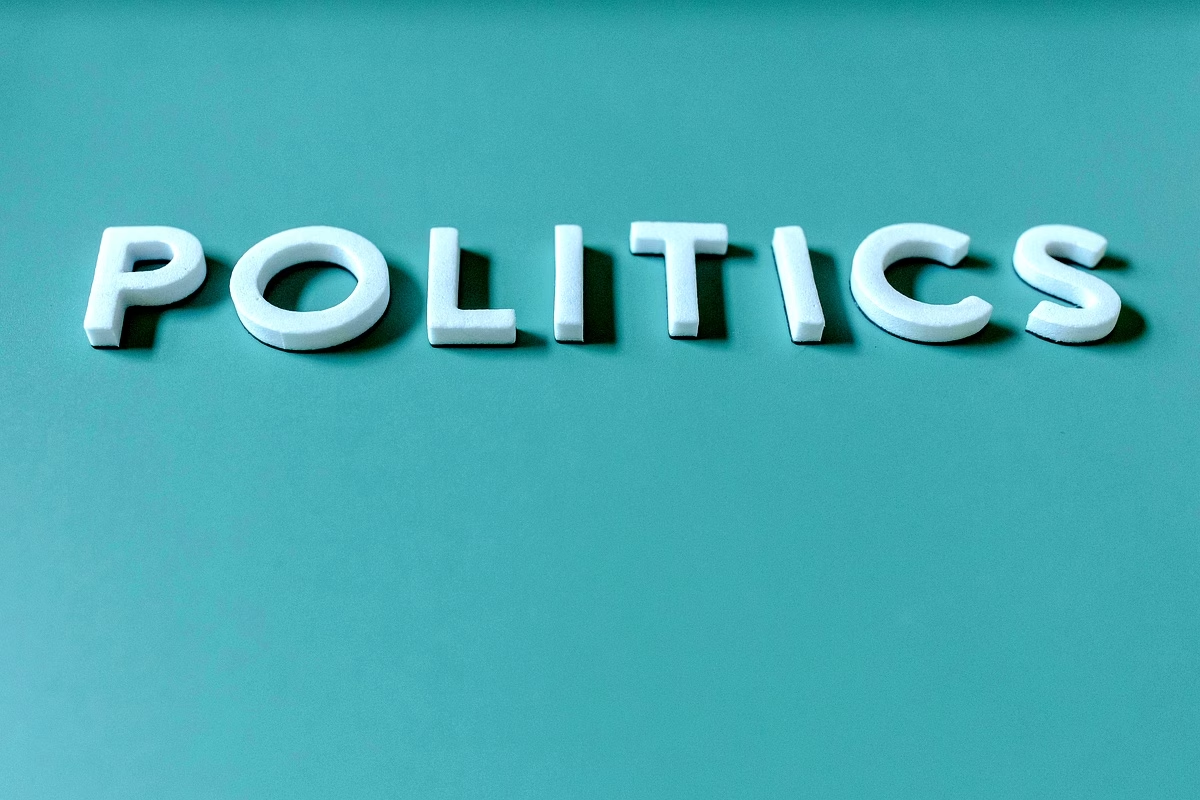
Il y ajoute que son bon fonctionnement réside dans le fait que l’on « laisse du jeu », i.e. « des marges, des interstices », laissant croire à la population dominée qu’elle est encore pourvue d’un libre-arbitre (Ibid., p. 106). C’est en cela que l’on distingue l’hégémonie de la domination, « système coercitif totalitaire » (Idem). La latitude accordée agit comme un rempart au risque de révolte tout en permettant l’expression de positions « alternatives » (Idem).
Toutefois, l’espace laissé n’est pas suffisamment important pour laisser poindre un renversement du système hégémonique en place. Selon Blanchet, c’est en offrant « des petites marges aux autres pour qu’ils aient l’impression d’avoir un peu d’espace » que la France assure une position hégémonique sur la francophonie et la langue française (Ibid., pp. 113-114). La posture est partagée par Serdaroglu, qui pointe du doigt le fait que « la situation hégémonique de la France lui permet de parler au nom de et à propos des autres » (2001, p. 192). D’après cette grille de lecture, le DDF fait partie de ces marges octroyées aux francophones.
2. Le mythe de Villers-Cotterêts réactivé : élément de langage mal à propos
Dans les discours portant sur le DDF, nous relevons la référence systématique faite à Villers-Cotterêts et à la Cité internationale de la langue française, présentée comme l’autre entreprise phare issue de la Stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme. Dans cet ordre d’idées, Emmanuel Macron convoque – lors de son discours à l’Institut de France – le récit selon lequel François Ier érige en 1539 le français en tant que « langue administrative du royaume par l’Édit de Villers-Cotterêts » (2018a).
L’acte, qui enjoint à rédiger les actes de droit en langue de France plutôt qu’en latin, est présenté comme une grande avancée en faveur d’un ordre socio-linguistique horizontal :
En renonçant au latin des clercs, François 1er ouvrait la porte à une langue authentiquement nationale, partagée, comprise de tous, il donnait corps à cette ambition propre à la langue française de jeter des ponts entre les classes et les conditions. (Idem)
De nouveau, lors de la cérémonie inaugurale du DDF, mention est faite de la Cité internationale de la langue française par Louise Mushikiwabo et Roselyne Bachelot-Narquin. Pour cette dernière, le DDF résulte d’une même volonté de promouvoir le « bien commun » qu’est la langue française (2021). Des propos réitérés par le ministère de Culture au sein du Dossier presse conçu par leurs soins. L’idée directrice étant que la Cité internationale de la langue française et le DDF sont les deux « opérations majeures parmi les mesures du plan d’action présidentiel ». (2021, p. 13)
L’assimilation du DDF à la symbolique de Villers-Cotterêts fait débat. L’ambiguïté idéologique est trahie par Gaël de Maisonneuve, Délégué aux affaires francophones du MEAE, lors de sa prise de parole au colloque d’OPALE en 2018. Selon lui, le roman national français n’est pas contradictoire à la défense d’une linguasphère plurilingue et polycentrée :
Emmanuel Macron, dès la campagne électorale de 2017, a fait de la Francophonie un sujet de fond, liant identité nationale, en choisissant comme symbole Villers-Cotterêts, lieu de signature de l’ordonnance d’août 1539, et projection internationale dans le plurilinguisme, fil conducteur de son discours du 20 mars 2018 à l’Institut de France. » (DLF, 2019, p. 15)
La symbolique de Villers-Cotterêts est multiscalaire. L’associer à la défense de l”identité nationale fait d’elle une pomme de discorde. Nous avons recoupé les différentes positions dénonçant le récit mythique fait de Villers-Cotterêts. Loin de la perception d’une langue élaborée par et pour ses locuteurs, Alain Rey dépeint Villers-Cotterêts comme « le triomphe de la volonté politique du monarque constructeur d’un absolutisme éclairé » (2007, p. 179).
Blanchet dépeint le même biais de complaisance en signant la tribune Cité de la langue française à Villers-Cotterêts : le contresens d’un mythe national (Blog Mediapart, 2020). Il y dénonce « l’idéologie de l’identité nationale une et indivisible » qui « ne s’embarrasse pas de vérité historique » (Idem). Pour lui, l’érection du Cité internationale de la langue française donne à voir une « méconnaissance de l’histoire linguistique de la France » (Idem).
Il convoque les travaux de Paul Cohen, auteur de L’imaginaire d’une langue nationale : l’État, les langues et l’invention du mythe de l’ordonnance de Villers-Cotterêts à l’époque moderne en France (2003). Celui-ci qualifie Villers-Cotterêts de « mémoire “inventée” » (Idem) arguant que « l’édit à peu contribué à la dissémination du français dans le royaume » (Idem). Pour Cohen et Blanchet, l’ordonnance de Villers-Cotterêts a été remaniée en élément de langage. L’objectif est alors de corroborer la perception d’un « État-nation centralisé et uniformisé depuis Paris » (Blanchet, 2020).
Un récit véhiculé depuis la Révolution française, dans le but de présenter « le prince » (Cohen, 2003) comme l’instigateur de l’unité linguistique.
Dans leur ouvrage Le français n’existe pas, Arnaud Hoedt et Jérôme Pion s’attellent à déconstruire la vision erronée de l’Édit royal (2020). Afin d’illustrer la teneur du « mythe fondateur », ils prennent pour exemple une intervention du Président Macron auprès de scolaires : « Dans ce château, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français. » (2017, dans Hoedt et Piron, 2020, p. 60)
Une explication mensongère puisque l’Édit concerne les actes de justice et non les pratiques langagières quotidiennes. En outre, s’il est fait référence à l’emploi de « langage maternel françoys » pour remplacer le latin, la possibilité qu’il soit fait allusion à tous les langages maternels du royaume de France est avancée.
C’est la thèse défendue par Sylvain Soleil – historien du droit – qui argue que la diversité culturelle est encore protégée à l’époque, malgré l’intention d’instaurer une unité politique. Ainsi, la mention à répétition de Villers-Cotterêts est perçue comme un stratagème pour « légitimer une politique centralisatrice entamée à la Révolution » (Ibid., p. 62). Pour les auteurs, il s’agit de mettre en scène « une nation monolingue largement fantasmée. » (Idem)
Afin d’offrir un autre récit, le Youtubeur Romain Filstroff, alias Linguisticae, s’empare du mythe de Villers-Cotterêts dans une chronique éponyme. Il y soulève les incohérences des discours nationaux. Après avoir rappelé que « tous les citoyens français ne parlent pas français » (2017b) – à l’instar des populations des territoires d’outre-mer –, il établit, tout comme Rey, Hoedt, Piron et Blanchet, que l’objectif d’unification linguistique est apparu non pas pendant la Monarchie, mais sous la Révolution française.
Suite au rapport de l’Abbé Grégoire en 1794, la France jacobine impose le français à tous afin de « détruire l’ordre socio-linguistique », i.e. « détruire les barrières entre les classes sociales » (Idem). Il démontre qu’au XVIe siècle, l’homogénéité linguistique n’est pas de mise dans le royaume de France, les langues régionales étant symbole de prestige, tout en faisant office de barrière sociolinguistique – l’ordre social étant préservé par l’incapacité du Tiers état à parler français –.
Il prend l’exemple de la Gascogne, où les consuls de Capbreton imposent que le catéchisme soit enseigné en français plutôt qu’en gascon en 1752. Décision annulée par le pouvoir monarchique et l’Église pour éviter une « superposition entre des classes sociales et des langues ». Enfin, son travail permet de faire remonter que « Sous-entendre que Villers-Cotterêts a initié une politique linguistique apparue sous l’État-nation, c’est considérer qu’à l’époque il y avait déjà une conception de l’État-nation, ce qui n’est pas vrai. » (Idem)
Dans le cadre de la promotion faite du DDF, la référence faite à l’ordonnance de Villers-Cotterêts est ambiguë. Si ce « mythe fondateur » véhicule une vision centralisée de l’État, les fondements du DDF résident dans le décentrement de la langue française. L’incohérence semble donc criante.
Néanmoins, nous avons conclu de notre enquête empirique que la réactivation du mythe de Villers-Cotterêts répond à une certaine logique. Au prisme de la notion d’hégémonie présentée précédemment, le DDF constituerait une marge accordée aux francophones pour passer sous silence la mainmise française sur la francophonie :
Réactiver le mythe de Villers-Cotterêts – celui du français langue historique et très ancienne de la France, qui éterniserait la Gaule, destinée à être unifiée et unie – tout en lançant le projet du DDF, c’est une façon de donner un gage aux francophones en leur disant : “En fin de compte, on est tous pour le français, mais chacun à sa façon. Donc on vous laisse une marge”. (Blanchet, 2022, p. 113)
Le sociolinguiste établit que, face aux revendications menées pour une égale légitimité des usages, l’État français – qui entend conserver la langue comme socle de son identité nationale – réalise le DDF pour laisser du jeu aux francophones. Telle est, en tout cas, une grille de lecture exploitable.
Comme lui, les linguistes interviewés que nous avons interviewés demeurent perplexes quant à l’établissement de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Les opinions que nous avons récoltées considèrent l’entreprise malhabile au vu du sujet délicat qu’est la francophonie :
La francophonie, ça fait trente ans que j’y travaille. C’est une affaire compliquée. On ne décrète pas comme ça, en un coup d’œil, qu’on va faire une cité internationale représentative de la francophonie. J’ai de bons amis dans ces milieux en France qui m’ont sollicité pour que je collabore sur des aspects extrêmement périphériques – dans tous les sens du terme d’ailleurs –. Cette entreprise recherche plus une sorte de caution – apportée par l’extérieur – qu’une véritable participation à un mouvement où l’on serait aussi, de manière privilégiée, associés aux mécanismes. (Francard, 2022, p. 131)
Pour Cerquiglini, la politique nécessite de faire des compromis : « tant qu’on a pas d’Académie francophone qui recouvre tous les pays […] il faut faire avec. Il faut faire de la politique, comprenez […]. Dans ce domaine, on ne fera pas de révolution. » (2022)
En conclusion, en étant associé à la Cité internationale de la langue française, le DDF pâtit des ambiguïtés politiques dont nous venons de débattre. Dans une salle du château de Villers-Cotterêts, il cohabitera avec le Dictionnaire de l’Académie française. Une initiative résolument tournée vers la France plutôt que vers la Francophonie, réduite à un élément de langage. Un projet qui aurait gagné à s’établir vers le bassin du fleuve congo – pour paraphraser Emmanuel Macron – plutôt qu’en périphérie d’Île-de-France.
3. Contradictions internes : la diversité en porte-à-faux
Le constat de l’ambivalence entre le DDF et la Cité internationale de la langue française pose la question de la cohérence du discours politique de l’État français. À l’issue de nos entretiens, nous attestons qu’une discordance est remarquée entre les discours portés sur la langue et leur concrétisation. Pour Blanchet, la principale dissonance est de défendre le plurilinguisme dans la francophonie tout en œuvrant « contre la diversité linguistique au niveau national » (2022, p. 113).
Le biais hégémonique est de nouveau pointé du doigt : « Derrière tout ça, il y a une dimension très hiérarchique qui relève clairement d’un esprit néo-colonial ayant largement diffusé l’idée qu’il y aurait des formes supérieures et inférieures de langues, de cultures, de civilisations. » (Idem)
Pour François Grin, la Francophonie souffre d’initiatives à deux vitesses, où « l’on appui[et] en même temps sur le frein et l’accélérateur. » (2022, p. 19) La cohérence interne est pointée du doigt. En cause, le décalage « entre des objectifs hautement professés et une réalité qui ne va pas toujours dans le sens proclamé » (Ibid., p. 29). Une faiblesse pragmatique qui peut se résorber, à condition de mettre l’accent sur la planification linguistique plutôt que sur le champ discursif :
[…] une fois qu’on a énoncé des principes très généraux – et ça Macron l’a fait –, il faut veiller à ce qu’à un niveau un peu plus précis, un peu plus terre-à-terre, il y ait cohérence avec ces principes hautement proclamés. À partir du moment où l’on veille à cette cohérence, les choses se mettent en place. On voit où sont les contraintes et ce qu’il faut négocier avec d’autres. (Ibid., p. 30)
Pour Francard, la place accordée aux éléments de langage est spécifique à la France. Les « prises de position officielles » étant davantage respectées contrairement à la Belgique, où le discours médiatique bénéficie d’une forte résonance : « Je constate que le lobbying de l’Académie française a un poids absolument incroyable, qui est étonnant. Vous fonctionnez manifestement à coups d’injonctions officielles. » (2022, p. 130)
Klinkenberg relève également le « double discours chez un grand nombre de responsables politiques français » (2022, p. 37). Une idée de la francophonie dichotome qui s’explique de nouveau par la fidélité au modèle linguistique centraliste. Malgré l’institution du DDF, la binarité inhérente à la Stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme relègue la lutte pour la diversité à une diplomatie de façade :
Ils tiennent officiellement le discours d’une francophonie pluricentrée, colorée, africaine, – parce qu’on ne peut tenir un autre discours sans être taxé de colonialiste –, mais continuent quand même dans le fond de leur conscience à penser que le français est la chose de la France. (Idem)
Une piste de réflexion à explorer est le rapport entretenu à la langue anglaise. Lors de son discours à Ouagadougou, Emmanuel Macron déclare vouloir concurrencer la langue « rivale principale qui est l’anglais » (2017). Selon Philippe Blanchet, la défense d’un français pluriel correspond davantage à une stratégie de lutte contre « le monolinguisme anglais international » (2022, p. 113) qu’à une revendication sociolinguistique. Une préoccupation davantage économique, pour reprendre la grille de lecture établie par Calvet (1999).
