C-Examiner la pertinence d’une gouvernance partagée de la diversité
Donner corps à une enceinte de dialogue : poids symbolique du DDF
Comme constaté précédemment, les forces centripètes et centrifuges sont un frein à la polycentration de la linguasphère francophone. Il n’en demeure pas moins que le DDF incarne symboliquement une fenêtre de tir pour donner corps à une enceinte de dialogue. Selon nos informations collectées, la polycentration a déjà été discutée lors d’une concertation du réseau OPALE. Le mémorandum soumis n’a pas donné suite, faute d’adhésion au projet. En cause,
« l’idée préconçue de l’inutilité d’une action concertée sur la langue » (Rey, 2007, p. 22). Le lexicographe a été précurseur en déplorant que l’« On oublie que de nombreuses langues nationales doivent leur existence actuelle à une action volontaire, qui suppose une information exacte et précise sur les pratiques de langage.
» (Idem) De même, la chercheuse de Saint-Robert relève en 2000 – dans son ouvrage portant sur les politiques linguistiques du français – l’absence « de mécanisme de concertation linguistique systématique entre pays francophones » (p. 83). Malgré le manque de coopération recensé, nous prenons acte de l’idée d’une « gouvernance de la diversité au niveau mondial » introduite lors du Colloque OPALE de 2018 (DLF, 2019, p.
5). Quatre ans plus tard, François Grin révèle ne « pas avoir vu passer de travaux de collègues relatifs à cette problématique précise. » (2022, p. 23) Personne ne s’est donc saisi du besoin de polycentrer la langue. Par conséquent, le DDF constitue des « petits pas importants […] en direction de cette polycentration » (Klinkenberg, 2022, p.
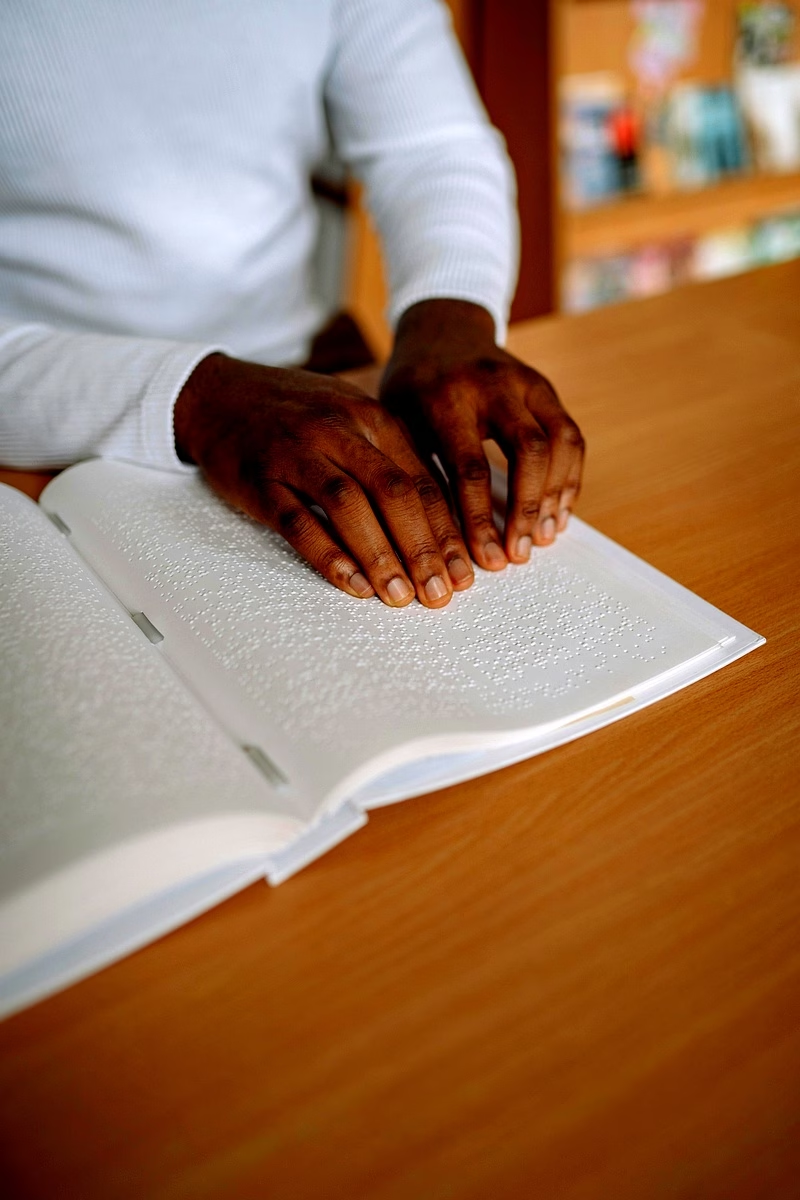
34).
Nous argumentons que le DDF est l’emblème d’une gestion concertée de la langue. Le journal du CNRS relaie cet aspect essentiel. Bénéficiant de cet espace de parole, le chef de projet du
DDF, Noé Gasparini, certifie que « Reconnaître cette diversité des normes est un changement de paradigme fort par rapport aux politiques linguistiques précédentes » (dans Boutaud, 2021). Un DDF agissant comme une ouverture sur la multipolarité donc, mais qui ne permet pas de mettre en place une véritable gouvernance. À ce sujet, les points de vue des acteurs interrogés se confrontent. Notre enquête révèle une divergence d’opinions manifeste sur la capacité du DDF à incarner cette gouvernance de la diversité. Le premier point de vue – majoritaire – affirme la compétence du DDF à coordonner un dialogue au sein de la francophonie :
Je pense que le DDF, et même – au sein de la Francophonie – l’Observatoire de la langue française, sont compétents pour cela. Il faut trouver une orchestration parce que, les habitudes ayant la peau très dure, la périphérie n’a pas eu l’habitude de participer. Il va falloir se déshabituer des plaintes, ne plus être sur la défensive et saisir cette opportunité pour construire concrètement une nouvelle manière d’appréhender la langue française. Il y a tout cela qui est à créer, et le DDF en sera. (Simo-Souop, 2022, p. 63)
À l’inverse, un autre point de vue nous est offert : celui ne plébiscitant pas l’instauration d’une gouvernance de la linguasphère francophone. Les instances de concertation lui sont préférées. Pour ce faire, la Convention mondiale sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par l’UNESCO en 2005, est prise en exemple :
En revanche, ce qui est utile, c’est d’avoir au niveau international – un petit peu comme en matière climatique – une gouvernance partagée de la diversité. C’est pour cela qu’on appelle de nos vœux la reprise des travaux portant sur la proposition d’une convention mondiale sur la diversité linguistique portée par l’UNESCO, au même titre que celle sur la diversité culturelle promulguée en 2005. (Grin, 2022, p. 25)
Ainsi, la promulgation d’une Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions linguistiques pourrait répondre au besoin d’instaurer une concertation linguistique entre communautés francophones. Le DDF, par le biais notamment du Conseil scientifique et du Comité de relecture, pourraient venir en appui, leur expérience permettant d’être force de proposition.
La linguasphère francophone : charnière d’une action concertée sur la langue
Les linguasphères ont été définies lors du colloque de l’OPALE Les « linguasphères » dans la gouvernance mondiale de la diversité comme étant « les regroupements, plus ou moins formalisés ou plus ou moins homogènes, de pays et populations ayant une langue en partage »
(DLF, 2019, p. 6). Chaque « communauté […] se définit en rapport avec l’usage d’une langue commune, en tenant généralement compte de sa variété géographique » (Ibid., p. 17). La notion est corrélée – sans en être parfaitement le synonyme – aux « X-phonies » (Idem). Selon ce raisonnement, la francophonie peut être caractérisée de linguasphère (Grin, dans DLF, 2019, p. 5).
Au terme de notre recherche, nous émettons la recommandation d’inscrire le DDF au sein de la linguasphère francophone. C’est en le replaçant au sein d’un dispositif plus vaste qu’il comptabilise le plus de chances de participer d’une action concertée sur la langue. Selon Gaël de Maisonneuve – délégué aux affaires francophones pour le MEAE –, la francophonie consiste en « une linguasphère politique et coopération » (DLF, 2019, p. 14). L’intervention de Patrick Mouguiama-Daouda – professeur des universités à Libreville – permet de cerner les critères d’adhésion à une linguasphère (Ibid., p. 19). Selon lui, un État y adhère dès lors où il estime que cela sert ses intérêts (Idem).
Dans le cadre du DDF, il nous semble essentiel de consulter chaque pays francophone pour saisir les points de connexion pouvant se créer avec les enjeux nationaux fixés en matière de langue. Telle est l’expertise avancée par Jean-Marie Klinkenberg, qui propose d’appréhender la linguasphère francophone comme « le soubassement de possibles politiques linguistiques à mener dans un cadre multinational. » (Ibid., p. 29) Il déplore que la francophonie ait « rarement posé des actes de politiques linguistiques concertés » (Idem), raison pour laquelle nous l’exhortons à considérer le DDF comme l’opportunité de développer une pensée multilatérale qui, regrette Klinkenberg, « est encore dans les limbes. » (Idem)
Dès lors, la réflexion menée lors du colloque OPALE visibilise le rôle clé qu’à la mondialisation dans la redéfinition des politiques linguistiques. Pour François Grin, il est désormais impossible de se référer « au cadre restreint d’un pays ou d’une région » (Ibid., p. 5) Pour l’économiste des langues, « les dimensions linguistiques des phénomènes politiques, économiques, sociaux et culturels qui s’y déploient sont nécessairement influencées par des processus qui se manifestent ailleurs, en dehors de l’espace politique et juridictionnel considéré, et notamment à l’échelle
mondiale. » (Idem) Si la mondialisation challenge le devenir des politiques linguistiques, le DDF offre une réponse à la prise en charge de la diversité linguistique. Il s’inscrit dans « une optique de gouvernance linguistique partagée » (Grin, dans DLF, 2019, p. 5). Dans la continuité, notre enquête révèle la ferme volonté des membres du Conseil scientifique d’entrer dans une francophonie pluricentrique.
Adeline Simo-Souop s’en fait le porte parole :
Nous devons créer une nouvelle façon de fonctionner et mettre ce nouveau contenu dans une organisation pluricentrique et polycentrique. Il y a tout un apprentissage à faire dans la francophonie du Sud à laquelle j’appartiens. Le ton a été donné. Désormais, nous sommes forts d’une incitation à la copropriété, à la revendication officielle de la copropriété, qui manquait précédemment. […] J’aspire, avec le DDF, à ne plus être dans la revendication mais dans la construction. Le DDF est un outil puissant pour cela. (2022, p. 64)
En conclusion, le DDF pourrait nul doute devenir l’impulseur d’une francophonie polycentrique, à condition qu’il s’inscrive dans des politiques transnationales en charge de créer des instances de concertation. L’expérience d’autres linguasphères polycentrées peuvent, pour ce faire, être prises pour modèle.
La polycentration anglophone et hispanophone : des résultats probants
Afin d’assurer la mise en place d’une linguasphère institutionnelle dans la francophonie, les exemples de l’anglophonie et de l’hispanophonie peuvent être consultés. Leur fonctionnement s’avère en effet concluant (Grin, 2022, p. 25). Pour l’économiste des langues, l’anglais et l’espagnol « sont des langues très polycentrées et reconnues comme telles » (Ibid., p. 23). Une réussite qui s’explique par la très faible hiérarchie existant « entre les différents parlers anglais » (Idem), contrairement à l’échelonnement des français :
il y a toujours en francophonie, me semble-t-il, une forme de hiérarchisation en direction de certains accents qui sont associés à certaines provenances régionales et un peu sociales. La manière de hiérarchiser les usages de la langue est très différente de l’anglophonie, et je pense qu’il y aurait dans le contexte de la linguasphère francophone, dans sa concurrence avec d’autres linguasphères, un intérêt à se déprendre de cette tradition hiérarchique qui me semble toujours présente. (Ibid., p. 28)
Le président de la DLF estime que la polycentration francophone est entravée par la domination du parisianisme, qui s’arroge le monopole de la légitimité. À l’inverse, il détermine que la vitalité de l’hispanophonie et de l’anglophonie s’explique par l’absence de rapports de force. Pour lui, le DDF est l’opportunité de « prendre acte de cette multipolarité » et d’en bénéficier (Ibid., p. 25)
En conclusion, nous relevons comme différence majeure entre la francophonie et l’anglo/l’hispanophonie, le traitement qui est fait des variétés de la langue. La francophonie est aux prises avec des rapports hiérarchiques, qui ont pour conséquence une polycentration embryonnaire, inaboutie. Si les variétés de français induisent de facto une polycentration, cette dernière n’est pas encore reproduite à un niveau institutionnel.
