Les stratégies de mise en œuvre de la communication interculturelle révèlent des mécanismes de défense insoupçonnés dans le contexte congolais. Cette recherche, alliant psychologie et méthodologie innovante, promet de transformer notre compréhension des interactions socioculturelles, avec des implications cruciales pour le dialogue interculturel.
PREMIERE PARTIE
CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L’ETUDE
La communication interculturelle est avant tout un phénomène, elle est ensuite un concept, enfin, un champ de recherche relativement récent au sein des Sciences de la Communication et qui a bénéficié des apports d’autres disciplines, notamment l’anthropologie, le management, la psychologie, la sociologie, …. Chaque discipline a tendance à proposer un modèle en fonction de son schéma théorique, ce qui de fois provoque des divergences avec ceux proposés par d’autres.
Ces divergences devraient être mises en commun par une approche constructiviste pour donner lieu à un champ théorique autonome comme ce fut le cas avec d’autres disciplines. En attendant, nous sommes obligé ici de décrire les contours de ce phénomène (son fondement scientifique, ses facteurs explicatifs et les mécanismes de défense socioculturelle qui y sont produits) et d’examiner le cadre psychologique, qui est à la fois « interculturel » et constructiviste », servant de sous-bassement à l’étude de ce phénomène.
Chapitre I : FONDEMENT SCIENTIFIQUE DE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE
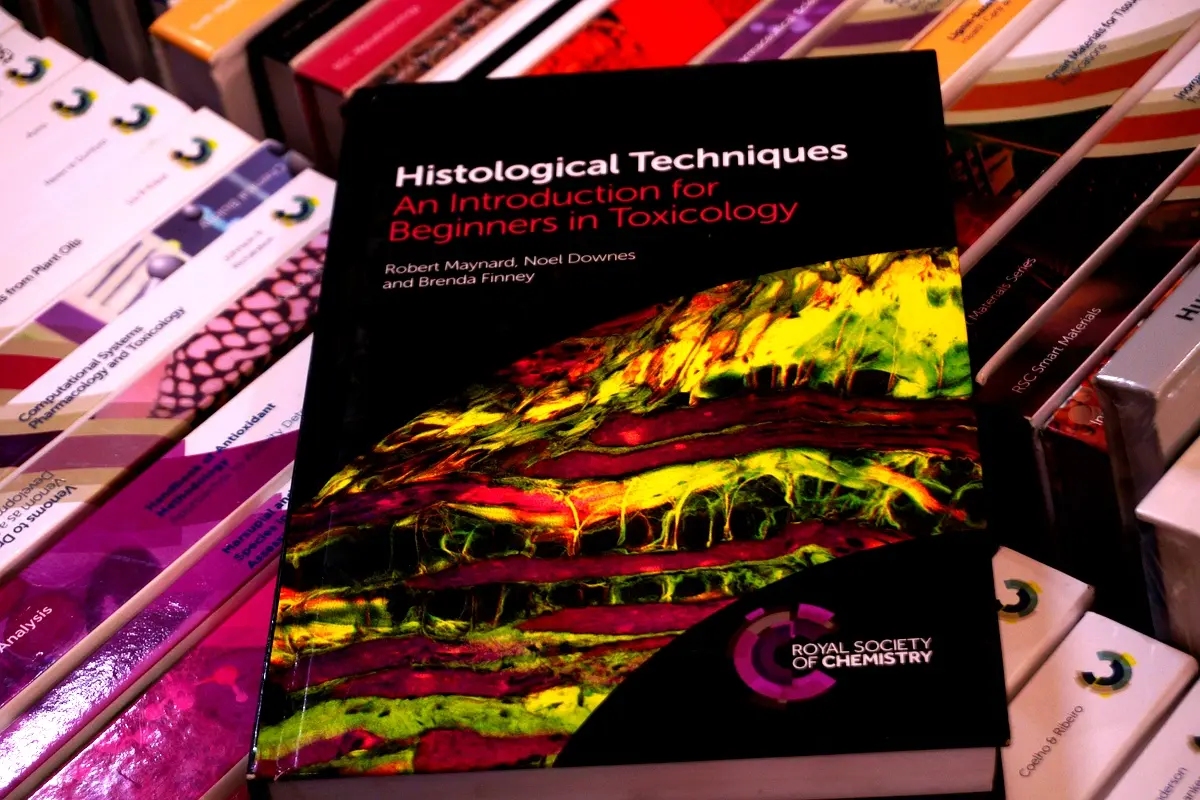
La communication interculturelle, comme type de pratiques de communication particulière, se déploie entre les acteurs de cultures ou ethnies différentes ; elle concerne aussi des acteurs d’un même groupe social appartenant à des cultures générationnelles différentes. La compréhension de ce macro-concept nécessite l’examen approfondi de ses « définitions », son « objet d’étude » et ses dimensions conceptuelles (communicative et interculturelle). Chacun de ces éléments est analysé à la lumière des théoriques déjà évoquées sous d’autres cieux servant d’explication à ce phénomène.
Section 1 :
Définitions et nature de la communication interculturelle
Les débats sur le concept de « communication interculturelle » montrent la difficulté à la cerner de manière univoque, du fait que plusieurs disciplines des sciences sociales ont contribué à des réflexions sur son acception, ce qui explique la difficulté d’une définition unifiée. Il y a toutefois lieu de retenir ce qui suit.
Selon Cough et Hintz74, la communication interculturelle est un processus dynamique et interminable caractérisé par quatre étapes. Dans un premier temps, elle manifeste l’intérêt réciproque des partenaires l’un pour l’autre. Le deuxième temps concerne l’édification de la communication comme une séquence de libres «réponses» réciproques aux interventions des partenaires. Le troisième moment, c’est l’élaboration de la communication comme reconnaissance réciproque des «intentionnalités» communicatives des partenaires (qu’est-ce qu’il veut dire ? qu’est-ce qu’il recherche ?). Le dernier moment, c’est la poursuite de la communication comme quête et construction d’un «espace de partage», te que chacun construit cet espace à sa façon et que les différences culturelles collaborent véritablement pour un meilleur partage.
Christian Barrette, Édith Gaudet et Denyse Lemay75, de leur côté, pensent que la communication interculturelle est une relation qui s’établit entre des personnes à partir de significations communes qu’elles attribuent à des mots et à des intonations (communication verbale) ainsi qu’à des gestes, des attitudes corporelles, des expressions, des positions dans l’espace, des vêtements (communication non-verbale).
74COUGH et HINTZ cités par LEMAIRE, P.-M., op.cit, p. 595.
75BARRETTE, C. et alii, Guide de communication interculturelle, Saint-Laurent, Renouveau Pédagogique, 1996, p. 138.
Pour Paul-Marcel Lemaire76, s’il est un terrain où les termes de culture et de communication se prêtent au débat et à la passion, c’est bien celui de la communication interculturelle. C’est autour d’elle que gravitent des vocables contradictoires qui alimentent généreusement les médias, le discours politique et l’opinion publique : l’identité culturelle ou la culture mondiale, le tribalisme ou l’universalisme, le protectionnisme culturel ou le free flow of information. A ce sujet, le même auteur soulève trois faits :
- La culture, individuelle ou collective, est un système clos, emprisonnant, qui empêche la communication avec les autres cultures. C’est ainsi que, pour parvenir à la communication interculturelle, il faut aller au-delà de sa propre culture qu’Edward T. Hall77 appelle Beyond culture en anglais ;
- Toute culture a absolument besoin d’autres cultures pour ne pas étouffer ses membres et ne pas dépérir elle-même. Ce constat ne remet pas en cause le principe de sa vitalité et de son renouvellement à travers la continuité, même si l’histoire prouve le contraire : de nombreuses cultures étaient riches et florissantes alors qu’elles étaient relativement isolées, tandis que de nombreuses autres ont commencé à décliner avec le contact extérieur envahissant ;
- Tout individu, tout groupe social, toute institution, voire tout pays est culturellement plus riche s’il participe organiquement à plus d’une culture. Ainsi donc, avec la communication interculturelle, il n’y a plus de frontières entre les humains et les sociétés, il y a métissage culturel qui nous ouvre à tout l’univers. Toute mesure, éducative ou législative, qui empêcherait de quelque façon cette forme de communication ou qui viserait à protéger et à stimuler l’identité culturelle d’un groupe ou d’une nation, pourrait être considérée comme un crime contre l’humanité.
De son côté, Martine Abdallah-Pretceille78 pense que malgré sa double dimension, linguistique et relationnelle, la communication doit être placée dans son contexte culturel ; les informations qui y sont émises doivent être placées dans leur contexte d’énonciation et de production. Elles ne prennent sens que dans une situation précise. Les faits culturels comme les mots sont polysémiques, ils ne signifient rien hors contexte et nécessitent une analyse, une démarche interprétative. Ils relèvent, dans ce sens, d’une approche pragmatique, d’une pragmatique culturelle.
Dans son ouvrage intitulé Au-delà de la culture, Edward Twitchel Hall79 pense que pour pratiquer la communication interculturelle, il est nécessaire, outre de comprendre le caractère
76BARRETTE, C. et alii, op.cit, p. 585-590.
77HALL, E.T., op.cit, 1979, pp. 11-12.
78ABDALLAH-PRETCEILLE, M. et PORCHER, L., op.cit, pp. 55-56.
79HALL, E.T., op.cit, p. 12.
organique des différences culturelles, de les dépasser en redécouvrant la «nature» oubliée. Paradoxalement, la seule possibilité pour l’homme d’échapper aux contraintes latentes d’une culture naturalisée est de s’impliquer de manière active et consciente dans les aspects de son existence qui lui semblent les plus naturels.
Pour sa part, Nicole Carignan80 pense que pour mieux communiquer, il faut être capable de comprendre la manière d’établir la communication multi et interculturelle. La communication multiculturelle reconnaît la différence tandis que la communication interculturelle valorise la prise en compte des ressemblances, de l’échange, de la réciprocité et de la solidarité.
Ces exigences épistémologiques et éthiques conduisent à passer des compétences communicative et culturelle à une compétence interculturelle. Celle-ci s’appuie sur une mise en scène, une théâtralisation de la culture dans des situations de communication, des échanges verbaux mais aussi non-verbaux, dans des comportements humains au quotidien. Dans ce cas, les mots, les gestes, les signes, les silences, …, utilisés lors des échanges constituent des indices culturels qui nécessitent un codage et un décodage, non pas à partir d’une signification culturelle globale a priori mais à partir d’une situation concrète qui implique des sujets (interculturels). De cette façon, la communication interculturelle est :
- « Un processus de réajustement permanent qui s’appuie non pas sur la totalité d’une culture mais sur des bribes culturelles, elles-mêmes objets de manipulation (stratégie de conformité, de transgression, de miroir, de camouflage, de cache-cache…) »81 ;
- « Une situation de rencontre entre des personnes appartenant à des cultures différentes. Mais la nationalité n’est qu’un des facteurs de cette différence ; le code linguistique n’est qu’une barrière parmi d’autres » 82 ;
- « Un processus interactif qui s’inscrit dans un cadre culturel mouvant et qui vise à donner du sens à une relation »83.
Enfin, dans la communication interculturelle, les individus font face à des identités culturelles déjà construites qui façonnent des préjugés fréquemment fondés sur une information partielle et déficiente, ce qui résulte de la production des réactions défensives de la part des interlocuteurs. Ainsi donc, plusieurs auteurs comme Edmond Marc Lipiansky84, Martine Abdallah-Pretceille85, Tania Ogay86, etc., s’accordent sur le fait qu’il existe des
80CARIGNAN, N., op.cit, p. 7.
81ABDALLAH-PRETCEILLE, M. et PORCHER, L., op.cit, p. 56.
82ATTALI, C., Communication interculturelle, une nécessité pour l’Assistant de manager, BTS « Assistant de Manager », Séminaire académique, Saint Cloud, Mars 2008, p. 1.
83BULL, A. et alii, Communication interculturelle, gestion nécessaire ou préoccupation superflue ?, Management des ressources humaines, Paris, Université Paris Dauphine, 2005, p. 48.
84LIPIANSKY, E.M, op.cit, pp. 15-29.
85ABDALLAH-PRETCEILLE, M. et PORCHER, L., op.cit, pp. 55-56.
86OGAY, T. et alii, « Pluralité culturelle á l’école : Les apports de la psychologie interculturelle », in VEI Enjeux, n° 129, 2002, pp. 43-44.
processus sociocognitifs ou psychosociaux qui décident les comportements des individus lors des échanges, et par conséquent, sont responsables des ces réactions défensives. Dans la vie courante, ces comportements sont exprimés par des expressions communicatives (communication généralisée et contextualité situationnelle).
________________________
74 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
75 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
76 BARRETTE, C. et alii, op.cit, p. 585-590. ↑
77 HALL, E.T., op.cit, 1979, pp. 11-12. ↑
78 ABDALLAH-PRETCEILLE, M. et PORCHER, L., op.cit, pp. 55-56. ↑
79 HALL, E.T., op.cit, p. 12. ↑
80 CARIGNAN, N., op.cit, p. 7. ↑
81 ABDALLAH-PRETCEILLE, M. et PORCHER, L., op.cit, p. 56. ↑
82 ATTALI, C., Communication interculturelle, une nécessité pour l’Assistant de manager, BTS « Assistant de Manager », Séminaire académique, Saint Cloud, Mars 2008, p. 1. ↑
83 BULL, A. et alii, Communication interculturelle, gestion nécessaire ou préoccupation superflue ?, Management des ressources humaines, Paris, Université Paris Dauphine, 2005, p. 48. ↑
84 LIPIANSKY, E.M, op.cit, pp. 15-29. ↑
85 ABDALLAH-PRETCEILLE, M. et PORCHER, L., op.cit, pp. 55-56. ↑
86 OGAY, T. et alii, « Pluralité culturelle á l’école : Les apports de la psychologie interculturelle », in VEI Enjeux, n° 129, 2002, pp. 43-44. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la communication interculturelle?
La communication interculturelle est un processus dynamique et interminable caractérisé par quatre étapes, manifestant l’intérêt réciproque des partenaires et l’édification d’un espace de partage.
Quels sont les mécanismes de défense socioculturelle dans la communication interculturelle?
Les mécanismes de défense socioculturelle sont produits dans le cadre de la communication interculturelle, bien que l’article ne détaille pas spécifiquement ces mécanismes.
Comment les différentes disciplines contribuent-elles à la communication interculturelle?
Plusieurs disciplines des sciences sociales, telles que l’anthropologie, le management, la psychologie et la sociologie, ont contribué à des réflexions sur la communication interculturelle, provoquant des divergences dans les définitions et modèles.