La méthodologie d’enquête sociolinguistique révèle que 85 % des étudiants subsahariens privilégient le français comme langue véhiculaire dans les résidences universitaires de Constantine. Cette étude met en lumière l’importance cruciale de cette langue dans un contexte de diversité culturelle, redéfinissant ainsi les dynamiques de communication.
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Frères Mentouri Constantine 1
Faculté des Lettres et des Langues Département de Lettres et Langue Française
Mémoire de Master Spécialité : Sciences du langage
Project presentation
Le français comme langue véhiculaire chez les étudiants étrangers subsahariens au sein des résidences universitaires : cas des résidences de l’Université Salah Boubnider Constantine 3.
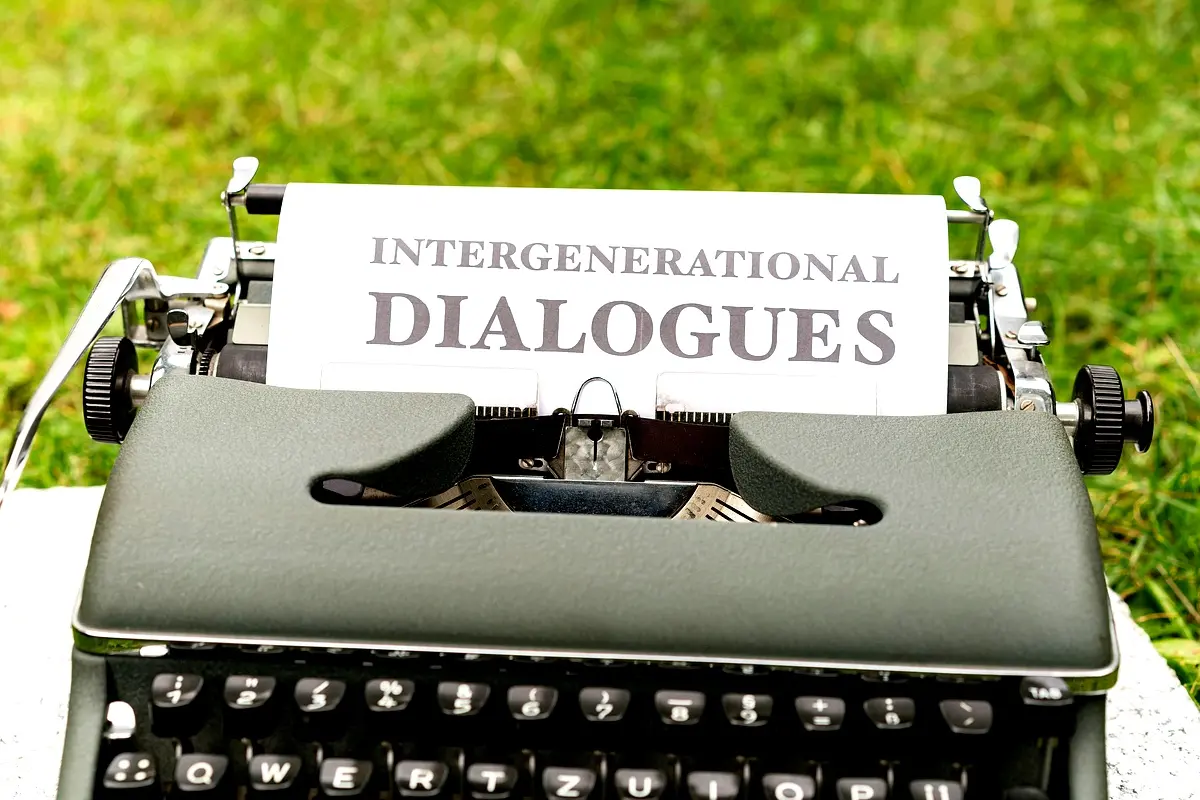
Présenté par : BADAMASSI Sarkin Sada Moustapha
Supervised by: Mme CHENTLI Cherifa
Année universitaire 2020/2021
Ce présent travail de recherche s’inscrit dans le domaine des sciences du langage, plus précisément dans celui de la sociolinguistique. À cet effet, nous avons mené une étude au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider sises à Constantine. Ces résidences typiquement polyglottes sont caractérisées par la diversité culturelle ; elles accueillent généralement des étudiants venant de l’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient.
C’est en effet dans cette perspective que nous nous sommes donné comme objectif principal de démontrer, le statut véhiculaire de la langue française chez les résidents subsahariens de ces résidences. Pour cela, nous nous sommes référés à deux techniques d’enquête notamment le questionnaire et l’enregistrement afin de recueillir les données nécessaires.
Nous avons donc recouru à la fois à l’analyse quantitative et qualitative afin d’analyser ces données recueillies. En définitive, les résultats obtenus ont prouvé que le français est la langue la plus utilisée par ces locuteurs subsahariens au sein de ces résidences. Cela est sans doute lié d’une part au statut de celle-ci dans une majeure partie des pays subsahariens (langue officielle, langue véhiculaire), et de son statut en Algérie d’autre part (FLE, langue d’enseignement des sciences et des techniques dans le supérieur).
Mots clés : Langue véhiculaire, polyglotte, diversité culturelle, sociolinguistique, analyse quantitative, analyse qualitative.
This present research work is in the field of language sciences, more precisely in that of sociolinguistics. Consequently, we carried out a study within the residences of the University Salah Boubnider located in Constantine. These typically multilingual residences are characterized by cultural diversity. They generally welcome students from sub-Saharan Africa and the Middle East.
It is in this perspective that we have set ourselves the main objective of demonstrating the vehicular status of the French language, particularly among sub-Saharan residents in these residences. For this, we referred to two survey techniques including the questionnaire and recording in order to collect the necessary data. We therefore used both quantitative and qualitative analysis to analyze the data collected.
The results obtained proved that French is the most used language by these sub-Saharan students in these residences. This is undoubtedly linked on the one hand to its status in a major part of the sub-Saharan countries (as official language, lingua franca), and to its status in Algeria on the other hand (as a foreign/second language, partially language of instruction at university level).
Keywords: lingua franca, multilingual, cultural diversity, sociolinguistic, quantitative analysis, qualitative analysis.
ملخص
يتعلق مجال هذه المذكرة بعلم اللغة بشكل عام و علم اللغة الاجتماعي على وجه الخصوص. ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بإجراء دراسة على مستوى الإقامة الجامعية صالح بوبنيدر بقسنطينة المتعددة اللغات بتنوع ثقافي فريد من نوعه بحيث أنها عادة ما تستقبل طلاب قادمون من جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية و الشرق الأوسط. فمن هذا المنظور، فإننا نسعى لتحقيق هدفنا الأساسي لإثبات المكانة المشتركة للغة الفرنسية خاصة لدى المقيمين الآتين من شبه الصحراء الجنوبية لأفريقيا. في مثل هاته أشرنا في هذا الصدد إلى تقنيتين للتحقق واللتان تتمثلان في الاستبيان و التسجيل، من أجل جمع البيانات اللازمة. ولذلك لجأنا لاستخدام كلا من التحليل الكمي و النوعي لتقييمها.
هؤلاء قبل من استخدامًا الأكثر اللغة هي الفرنسية أن عليها الحصول تم التي النتائج أثبتت ، النهاية في جزء في بوضعها جهة من مرتبط شك بلا وهذا .المساكن هذه في الكبرى الصحراء جنوب من المتحدثين أخرى جهة من الجزائر في ومكانتها ،)المركبات لغة الرسمية، اللغة( الصحراء جنوب بلدان من كبير ).التدريس لغة(
الكلمات المفتاحية:
اللغة السائدة – متعدد اللغات- تنوع ثقافي- لغوي إجتماعي- تحليل كمي- تحليل نوعي.
Introduction générale
La présente recherche s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique, une discipline qui met en relation les phénomènes linguistiques avec les réalités sociales. Ainsi la sociolinguistique se définit comme : « une partie de la linguistique dont le domaine se recoupe avec ceux de l’ethnolinguistique, de la sociologie du langage, de la géographie linguistique et de la dialectologie et se fixant comme tâche de faire apparaître dans la mesure du possible la covariance des phénomènes linguistiques et sociaux et, éventuellement, d’établir une relation de cause à effet » (Dubois, 1994 : 435).
De nos jours, il n’est en aucun cas un secret que la langue française fait partie des langues les plus parlées au monde. Cependant le français n’est plus uniquement une langue des français mais aussi une langue des africains pour des raisons d’ordre multiple (historique, politique…). Le français est un outil véhiculaire des cultures africaines. C’est en effet une langue dans laquelle beaucoup de jeunes africains apprennent, par laquelle ils peuvent convaincre et défendre leurs valeurs et leur dignité.
Le français sert aussi le plus souvent de langue véhiculaire à ces jeunes africains issus de cultures différentes et possédants des langues maternelles et nationales différentes.
C’est ce sur quoi porte notre travail de recherche et c’est dans cette optique que nous nous dirigeons vers les résidences de l’Université Salah Boubnider sises à Constantine (Algérie) afin d’observer ce phénomène sociolangagier, celui de l’utilisation du français comme langue véhiculaire, plus précisément chez les locuteurs subsahariens au sein de ces enceintes. Nous tenons en effet à souligner que la langue française en Algérie jouit d’un privilège pour la transmission du savoir même si elle n’est pas du tout langue officielle.
Pour les linguistes, il s’agit des « langues utilisées pour l’intercompréhension entre des communautés linguistiques géographiquement voisines et qui ne parlent pas les mêmes langues. » (Louis-Jean Calvet, p.23).
La notion a été reprise en 2012 par l’historien Benoît Grévin. Elle désigne une « langue employée pour des raisons politiques, commerciales, administratives ou autres comme langue commune par des populations de langues différentes. Véhiculaire qualifie donc des langues dotées d’un certain prestige et relativement diffusées, même si l’échelle de cette diffusion peut varier… » (p. 394).
Permettant la communication entre de communautés distantes, elle s’oppose dans cette vision des choses aux langues vernaculaires utilisées localement dans des communautés restreintes.1
Objectifs
Par le biais de notre travail de recherche nous allons tenter de comprendre pourquoi la langue française s’est incrustée comme langue véhiculaire dans les résidences de l’Université Salah Boubnider, qui d’ailleurs est purement polyglotte.
Nous allons donc essayer d’observer et d’énumérer les raisons qui ont fait en sorte que le français soit la langue qui permet la plus grande intercompréhension et interaction au sein de ces résidences pour la communauté subsaharienne.
Motivations
Derrière le choix de ce sujet se cache une envie de comprendre un phénomène sociolangagier, à savoir l’usage du français comme étant la langue la plus entendue et la plus utilisée par cette communauté linguistique.
En effet nous constatons l’usage quasi quotidien du français dans les interactions entre les étrangers subsahariens et avec leur hôtes Algériens, et ce malgré le statut de celle-ci dans ce pays.
De ce fait nous allons donc tenter de comprendre ce phénomène observé dans ces résidences où nous remarquons une importante diversité socioculturelle, c’est l’intitulé de notre travail de recherche.
Problématique
En effet, dans notre travail de recherche, nous nous sommes intéressés à la langue la plus parlée et la plus utilisée par ces locuteurs étrangers subsahariens dans ces résidences marquées par la diversité culturelle et le plurilinguisme, l’usage donc quasi quotidien du français au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider Constantine 3.
Nous allons donc essayer d’en savoir davantage sur l’implantation de la langue française dans ce paysage linguistique.
1 https://num-arche.unistra.fr/voces/notice/langue_vehiculaire.xml
Pour cela, un ensemble de questions relatif à notre sujet de recherche est donc nécessaire :
- La langue française permet-elle la plus grande intercompréhension entre les étrangers subsahariens ou encore avec les autochtones Algériens ?
- Quel est le statut de la langue française au sein de ces résidences universitaires ?
- Le français favorise-t-il les interactions entre locuteurs de langues différentes ?
- Qu’est-ce qui est à l’origine de l’implantation de cette langue comme langue véhiculaire dans ces résidences ?
- Le français serait-il la langue qui permet l’intercompréhension entre la communauté estudiantine étrangère et les administrations des leurs résidences respectives ?
Hypothèses
Dans le but d’apporter des réponses aux questions évoquées ci-dessus, nous allons essayer de proposer un bon nombre d’hypothèses que nous tâcherons de vérifier tout au long de nos recherches.
Ces hypothèses se présentent comme suit :
- La langue française est la langue des études de la plupart de ces résidents.
- Le rapport avec le statut de la langue française en Algérie.
- La diversité culturelle et sociolinguistique a peut-être fait en sorte que les concernés ont opté pour l’usage du français afin de se faire entendre et comprendre par son/leurs interlocuteur/s.
- Les représentations positives des étrangers envers la langue française.
- Le nombre important des étrangers subsahariens francophones au sein de ces résidences.
Présentation de l’Afrique subsaharienne
Nous présentons ci-dessous un bref aperçu de l’Afrique subsaharienne avec les langues officielles. Cette dernière est la région du continent africain située au sud du désert du Sahara et qui compte 48 pays pour un peu plus d’un milliard d’habitants.2
Comme nous montre l’image ci-dessous l’anglais et le français sont majoritairement les principales langues officielles dominantes dans cette partie de l’Afrique où sont parlées plus de deux mille langues.
Les pays de l’Afrique subsaharienne sont : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.
Image 1 : carte de l’Afrique subsaharienne avec les langues officielles3.
[1_methodologie-enquete-sur-le-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_1]
2 LEE, S, (2020), Liste des pays d’Afrique Subsaharienne et classements par potentiel, Stileex, (Page consultée le 01/06/2021), https://stileex.xyz/afrique-subsaharienne.
3 Le Fil plurilingue, 2016, Afrique subsaharienne : 2000 langues utilisées, des situations sociolinguistiques complexes, (Page consultée le 02/06/2021), Twitter, https://twitter.com/filpluri/status/749976601794863104.
Plan de travail
Nous tenons à souligner que notre travail est scindé en trois chapitres :
Le premier chapitre comporte la définition de quelques concepts clés relatifs à la compréhension du sujet.
Le second chapitre dont l’intitulé est « Aspect méthodologique/ Présentation et description des Corpus » sera quant à lui réservé à la description de l’ensemble de techniques et méthodes auquel nous avons recouru pour recueillir toutes les données qui nous seront utiles. Ajouté à cela la description des corpus.
Enfin, dans le dernier chapitre nous allons procéder à l’analyse des données recueillies. Nous ferons donc appel respectivement à la fois à l’analyse quantitative et à l’analyse qualitative.
Résumé Cette présente recherche s’inscrit dans le domaine des sciences du langage, plus précisément dans celui de la sociolinguistique. En conséquence, nous avons réalisé une étude au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider située à Constantine. Ces résidences typiquement multilingues se caractérisent par une diversité culturelle. Elles accueillent généralement des étudiants d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. C’est dans cette perspective que nous nous sommes fixés comme objectif principal de démontrer le statut véhiculaire de la langue française, particulièrement parmi les résidents subsahariens de ces résidences. Pour cela, nous avons recours à deux techniques d’enquête, à savoir le questionnaire et l’enregistrement, afin de collecter les données nécessaires. Nous avons donc utilisé à la fois l’analyse quantitative et l’analyse qualitative pour analyser les données recueillies. Les résultats obtenus ont prouvé que le français est la langue la plus utilisée par ces étudiants subsahariens dans ces résidences. Cela est sans aucun doute lié d’une part à son statut dans une grande partie des pays subsahariens (en tant que langue officielle, lingua franca), et d’autre part à son statut en Algérie (en tant que langue étrangère/deuxième langue, partiellement langue d’enseignement au niveau universitaire).
Mots-clés : lingua franca, multilingue, diversité culturelle, sociolinguistique, analyse quantitative, analyse qualitative.
Introduction générale
La présente recherche s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique, une discipline qui met en relation les phénomènes linguistiques avec les réalités sociales. Ainsi, la sociolinguistique se définit comme : « une partie de la linguistique dont le domaine se recoupe avec ceux de l’ethnolinguistique, de la sociologie du langage, de la géographie linguistique et de la dialectologie et se fixant comme tâche de faire apparaître dans la mesure du possible la covariance des phénomènes linguistiques et sociaux et, éventuellement, d’établir une relation de cause à effet » (Dubois, 1994 : 435).
De nos jours, il n’est en aucun cas un secret que la langue française fait partie des langues les plus parlées au monde. Cependant, le français n’est plus uniquement une langue des Français mais aussi une langue des Africains pour des raisons d’ordre multiple (historique, politique…). Le français est un outil véhiculaire des cultures africaines. C’est en effet une langue dans laquelle beaucoup de jeunes Africains apprennent, par laquelle ils peuvent convaincre et défendre leurs valeurs et leur dignité.
Le français sert aussi le plus souvent de langue véhiculaire à ces jeunes Africains issus de cultures différentes et possédant des langues maternelles et nationales différentes. C’est ce sur quoi porte notre travail de recherche et c’est dans cette optique que nous nous dirigeons vers les résidences de l’Université Salah Boubnider sises à Constantine (Algérie) afin d’observer ce phénomène sociolangagier, celui de l’utilisation du français comme langue véhiculaire, plus précisément chez les locuteurs subsahariens au sein de ces enceintes. Nous tenons en effet à souligner que la langue française en Algérie jouit d’un privilège pour la transmission du savoir même si elle n’est pas du tout langue officielle.
Pour les linguistes, il s’agit des « langues utilisées pour l’intercompréhension entre des communautés linguistiques géographiquement voisines et qui ne parlent pas les mêmes langues. » (Louis-Jean Calvet, p.23). La notion a été reprise en 2012 par l’historien Benoît Grévin. Elle désigne une « langue employée pour des raisons politiques, commerciales, administratives ou autres comme langue commune par des populations de langues différentes. Véhiculaire qualifie donc des langues dotées d’un certain prestige et relativement diffusées, même si l’échelle de cette diffusion peut varier… » (p. 394). Permettant la communication entre des communautés distantes, elle s’oppose dans cette vision des choses aux langues vernaculaires utilisées localement dans des communautés restreintes.
Objectifs
Par le biais de notre travail de recherche, nous allons tenter de comprendre pourquoi la langue française s’est incrustée comme langue véhiculaire dans les résidences de l’Université Salah Boubnider, qui d’ailleurs est purement polyglotte. Nous allons donc essayer d’observer et d’énumérer les raisons qui ont fait en sorte que le français soit la langue qui permet la plus grande intercompréhension et interaction au sein de ces résidences pour la communauté subsaharienne.
Motivations
Derrière le choix de ce sujet se cache une envie de comprendre un phénomène sociolangagier, à savoir l’usage du français comme étant la langue la plus entendue et la plus utilisée par cette communauté linguistique. En effet, nous constatons l’usage quasi quotidien du français dans les interactions entre les étrangers subsahariens et avec leurs hôtes algériens, et ce malgré le statut de celle-ci dans ce pays. De ce fait, nous allons donc tenter de comprendre ce phénomène observé dans ces résidences où nous remarquons une importante diversité socioculturelle, c’est l’intitulé de notre travail de recherche.
Problématique
En effet, dans notre travail de recherche, nous nous sommes intéressés à la langue la plus parlée et la plus utilisée par ces locuteurs étrangers subsahariens dans ces résidences marquées par la diversité culturelle et le plurilinguisme, l’usage donc quasi quotidien du français au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider Constantine. Nous allons donc essayer d’en savoir davantage sur l’implantation de la langue française dans ce paysage linguistique.
Pour cela, un ensemble de questions relatif à notre sujet de recherche est donc nécessaire :
- La langue française permet-elle la plus grande intercompréhension entre les étrangers subsahariens ou encore avec les autochtones algériens ?
- Quel est le statut de la langue française au sein de ces résidences universitaires ?
- Le français favorise-t-il les interactions entre locuteurs de langues différentes ?
- Qu’est-ce qui est à l’origine de l’implantation de cette langue comme langue véhiculaire dans ces résidences ?
- Le français serait-il la langue qui permet l’intercompréhension entre la communauté estudiantine étrangère et les administrations de leurs résidences respectives ?
Hypothèses
Dans le but d’apporter des réponses aux questions évoquées ci-dessus, nous allons essayer de proposer un bon nombre d’hypothèses que nous tâcherons de vérifier tout au long de nos recherches. Ces hypothèses se présentent comme suit :
- La langue française est la langue des études de la plupart de ces résidents.
- Le rapport avec le statut de la langue française en Algérie.
- La diversité culturelle et sociolinguistique a peut-être fait en sorte que les concernés ont opté pour l’usage du français afin de se faire entendre et comprendre par son/leurs interlocuteur/s.
- Les représentations positives des étrangers envers la langue française.
- Le nombre important des étrangers subsahariens francophones au sein de ces résidences.
Présentation de l’Afrique subsaharienne
Nous présentons ci-dessous un bref aperçu de l’Afrique subsaharienne avec les langues officielles. Cette dernière est la région du continent africain située au sud du désert du Sahara et qui compte 48 pays pour un peu plus d’un milliard d’habitants.
Comme nous montre l’image ci-dessous, l’anglais et le français sont majoritairement les principales langues officielles dominantes dans cette partie de l’Afrique où sont parlées plus de deux mille langues.
Les pays de l’Afrique subsaharienne sont : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.
Image 1 : carte de l’Afrique subsaharienne avec les langues officielles.
2 LEE, S, (2020), Liste des pays d’Afrique Subsaharienne et classements par potentiel, Stileex, (Page consultée le 01/06/2021), https://stileex.xyz/afrique-subsaharienne.
3 Le Fil plurilingue, 2016, Afrique subsaharienne : 2000 langues utilisées, des situations sociolinguistiques complexes, (Page consultée le 02/06/2021), Twitter, https://twitter.com/filpluri/status/749976601794863104.
Plan de travail
Nous tenons à souligner que notre travail est scindé en trois chapitres :
- Le premier chapitre comporte la définition de quelques concepts clés relatifs à la compréhension du sujet.
- Le second chapitre, dont l’intitulé est « Aspect méthodologique/ Présentation et description des Corpus », sera quant à lui réservé à la description de l’ensemble de techniques et méthodes auquel nous avons recouru pour recueillir toutes les données qui nous seront utiles. Ajouté à cela la description des corpus.
- Enfin, dans le dernier chapitre, nous allons procéder à l’analyse des données recueillies. Nous ferons donc appel respectivement à la fois à l’analyse quantitative et à l’analyse qualitative.
Questions Fréquemment Posées
Quel est le statut de la langue française chez les étudiants subsahariens à l’Université Salah Boubnider?
Le français est perçu comme un outil de communication essentiel et est la langue la plus utilisée par les étudiants subsahariens dans les résidences universitaires de l’Université Salah Boubnider.
Quelles méthodes d’enquête ont été utilisées dans l’étude sur le français véhiculaire?
Les méthodes d’enquête incluent des questionnaires et des enregistrements pour une analyse approfondie des données.
Pourquoi le français est-il considéré comme une langue véhiculaire en Algérie?
Le statut du français en Algérie est lié à son rôle en tant que langue d’enseignement des sciences et des techniques dans le supérieur, ainsi qu’à son statut dans une majeure partie des pays subsahariens.
