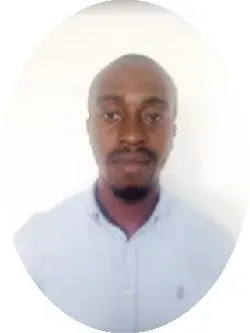L’analyse comparative des attributs produits révèle que la différenciation par qualité et variété est cruciale pour stimuler les échanges intracommunautaires au sein de la CEMAC. Cette étude met en lumière les défis économiques de la région et questionne le potentiel de cette stratégie pour intensifier les flux commerciaux.
DEUXIEME PARTIE :
DETERMINATION DE LA DIFFERENCIATION PAR ATTRIBUT DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE D’AFRIQUE CENTRALE
La vérification empirique de la relation entre l’achat des produits et attributs des produits repose sur la présentation du modèle théorique et sur les résultats qui en découlent.
Chapitre III- Choix de méthodologie de détermination
Pour répondre à cette interrogation, nous allons analyser l’impact des attributs du bois sous forme de meuble sur le comportement d’achat des consommateurs présent sur le marché du meuble gabonais. Le but de cette étude est de montrer comment les caractéristiques ou attributs des produits influencent les choix consommateurs et peuvent intensifier les échanges intra-CEMAC.
Notre étude portera sur deux essences de bois que l’on retrouve dans l’Afrique Centrale en général et au Gabon en particulier. Ces deux essences sont : OKOUME et WENGE. Ces bois sont présentés aux consommateurs (nationaux et expatrier) présent sur le marché gabonais sous forme de meuble.

Section 1:
Présentation du modèle
Le cadre théorique du modèle
L’analyse des choix du consommateur est au centre de la différenciation par attribut et a pour objectif d’expliquer l’analyse du comportement individuel du consommateur.
L’approche de Lancaster permet de rendre compte de la possibilité pour un bien de présenter un vecteur d’attributs distincts, eux-mêmes pouvant éventuellement être présents et combinés à d’autres attributs en quantité variable et issus de la consommation d’autres biens.
Selon Lancaster (1966), c’est la maximisation de l’utilité qui est, certes, l’objectif du choix du consommateur mais, ce sont les caractéristiques intrinsèques ou les attributs du produit (couleur; goût, vitesse, durée de d’utilisation…etc.) qui lui procure cette utilité sous l’influence de ses propres caractéristiques. « Les biens en eux-mêmes ne procurent aucune utilité aux consommateurs, ils possèdent des caractéristiques et ces caractéristiques fournissent une utilité » (Lancaster, 1966).
Sur cette base, Lancaster (1966) met au point la nouvelle approche pour la théorie du consommateur pour tenir compte des caractéristiques intrinsèques des produits demandés dans l’analyse de la demande. Cette nouvelle approche a révolutionné le domaine des études de la demande. Comme dans la fonction de demande originale, cette nouvelle approche pose l’hypothèse de choix qui maximise l’utilité du consommateur sous contrainte budgétaire.
Le développement de cette théorie permet à Lancaster de promouvoir toutes les actions en faveur d’une meilleure information des consommateurs quant aux attributs de consommation des différents biens. Ainsi les informations dispensées par les associations de consommateurs, les labels et autres étiquettes d’information sur la composition des produits, mais aussi sa propre éducation, doivent permettre au consommateur de choisir au mieux son panier de biens compte tenu de ses préférences et sa contrainte budgétaire. De plus, l’arrivée sur le marché d’un nouveau produit, innovant par la combinaison inédite de ses attributs, est facilement intégrée par le consommateur, ce qui permet de traiter de certaines formes de différenciation des produits.
L’utilité U est fonction des attributs intrinsèques (x) du produit et des caractéristiques (z) du consommateur.
On a donc : 𝑼ik= (𝒙,z) équation (1) Avec Uik est l’utilité du produit k pour le consommateur i ;
(x) représentant l’ensemble des attributs du produit ;
(z) désignant les caractéristiques propres au consommateur.
Pour opérationnaliser cette approche, plusieurs méthodes de collecte de données et des modèles d’analyses ont été développées. Parmi ces méthodes, l’analyse conjointe a été reconnue comme la meilleure méthode permettant d’évaluer l’importance relative des caractéristiques d’un produit sur la préférence du consommateur. Car, elle permet de mesurer par un seul plan d’expérience, toutes les informations non mesurables par un questionnaire adressé aux consommateurs (Gil, 1997 ; Guyon, 2010).
Il existe deux approches d’analyse conjointe. L’approche traditionnelle (rating based approach) qui consiste à faire noter ou à faire classer les consommateurs, un ensemble de profils et à estimer les utilités par régression linéaire (Guyon, 2010; Halbrendt, et al., 1991 et Ohannessian, 2008). Cette approche demande beaucoup d’énergie et nécessite que les répondants aient un niveau intellectuel donné.
Il faut qu’ils comprennent parfaitement les produits qu’on leur propose et qu’ils soient capables de mener une analyse critique de leurs caractéristiques afin de pouvoir noter ou classer objectivement et judicieusement. Cette méthode a été supplantée depuis les années 2000 par l’approche dite discrète (choice based approach) qui mesure les choix des consommateurs et non leur note ou classement.
Cette dernière approche a bénéficié des progrès effectués en économie dans la modélisation des choix initiés par les travaux de McFadden, (1970)2. Dans cette approche, les profits sont représentés en plusieurs petits groupes (jeux) pour faciliter l’appréciation.
Modèle empirique
Plusieurs modèles économétriques ont été mis au point sur la base du RUM3. Les plus utilisés sont: le logit multinomial (multinomial logit MNL) et le logit conditionnel (Green, 2005; Guyon, 2010; Kpenavoun, Gandonou, 2009 ; Ohannessian, 2008). Ces modèles posent un problème de cohérence en raison d’une hypothèse qui n’est pas souvent vérifiée: l’Indépendance des Alternatives non Pertinentes IIA (Green, 2005; Guyon, 2010; Kpenavoun, Gandonou, 2009 ; Ohannessian, 2008). Elle assume que le choix d’un produit ne dépend pas des autres produits qui lui sont semblables dans le groupe d’alternatives, ce qui n’est pas conforme à la réalité.
Des modèles alternatifs ont alors été proposés pour surmonter cette difficulté. On peut citer le logit emboité (Nested logit) introduit par McFadden, 1970 et le Probit Multinomiale (Green, 2005; StataCorp, 2009 et Wooldridge, 2002). Le Nested logit assume que la partie stochastique de l’utilité suit une loi GEV (Generalized Extreme-Value) qui tient compte des corrélations qui existent entre les alternatives au niveau d’un groupe (Kpenavoun, Gandonou, 2009). Mathématiquement, l’utilité d’un bien j pour un individu i est :
𝐔ij = Vij + εij équation (2)
Avec Vij la fonction linéaire des attributs du produit et/ou des consommateurs et εij est la variable stochastique qui représente les erreurs de perception et/ou d’optimisation de la part du consommateur i.
𝐕𝐢𝐣 =𝛃𝐱𝐢 +ᵧ𝒛𝒋 et 𝐔𝒊𝒋 = 𝛃𝐱𝐢 +ᵧ𝒛𝒋+ 𝛆𝐢𝐣
𝐔𝒊k = 𝛃𝐱𝐢 +ᵧ𝒛k + 𝛆𝐢k2 équation (3)
Cette équation traduit le fait que le consommateur (i) choisira l’alternative qui a la plus grande utilité pour lui.
𝐏𝒊𝒋 = 𝐏𝒓(𝐲𝒊 =𝐣 )
= (𝑼𝒊𝒋 >𝑼𝒊𝒌 ∀ 𝐤=𝟏,…𝐊≠𝐣) équation (4)
= 𝑷𝒓 (𝜺𝒊𝒌-𝜺𝒊𝒋 ≤𝑽𝒊𝒋 -𝑽𝒊𝒌 ∀ 𝐤=𝟏,…𝐤≠𝐣)
= Pr (𝜺𝒊𝒌-𝜺𝒊𝒋 ≤ (𝐱𝐢j – xik)’ ∀ 𝐤=𝟏,…𝐊≠𝐣)
L’équation (4) désigne le fait que consommateur i choisira l’alternative qui a la plus grande utilité pour lui. On pose la probabilité qu’il choisisse le profil j parmi les K profils soumis à son appréciation:
________________________
2 Ces travaux lui on valut le prix Nobel d’économie en 2000. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment la différenciation par attributs influence-t-elle les choix des consommateurs au Gabon ?
La différenciation par attributs influence les choix des consommateurs en montrant comment les caractéristiques ou attributs des produits, comme la qualité et la variété, affectent leurs décisions d’achat.
Quels sont les attributs du bois étudiés dans l’analyse des choix des consommateurs gabonais ?
L’étude se concentre sur deux essences de bois, OKOUME et WENGE, présentées aux consommateurs sous forme de meubles.
Quelle méthode est utilisée pour évaluer l’importance des caractéristiques d’un produit sur la préférence du consommateur ?
L’analyse conjointe est reconnue comme la meilleure méthode permettant d’évaluer l’importance relative des caractéristiques d’un produit sur la préférence du consommateur.