La résistance bactérienne en milieu aquatique est analysée à travers l’étude de 35 souches isolées dans les zones humides Ramsar d’Oran et de Bechar. L’article évalue leur résistance aux antibiotiques et leur contenu plasmidique, mettant en lumière l’impact des facteurs écologiques sur leur survie.
La survie des bactéries en aquatique :
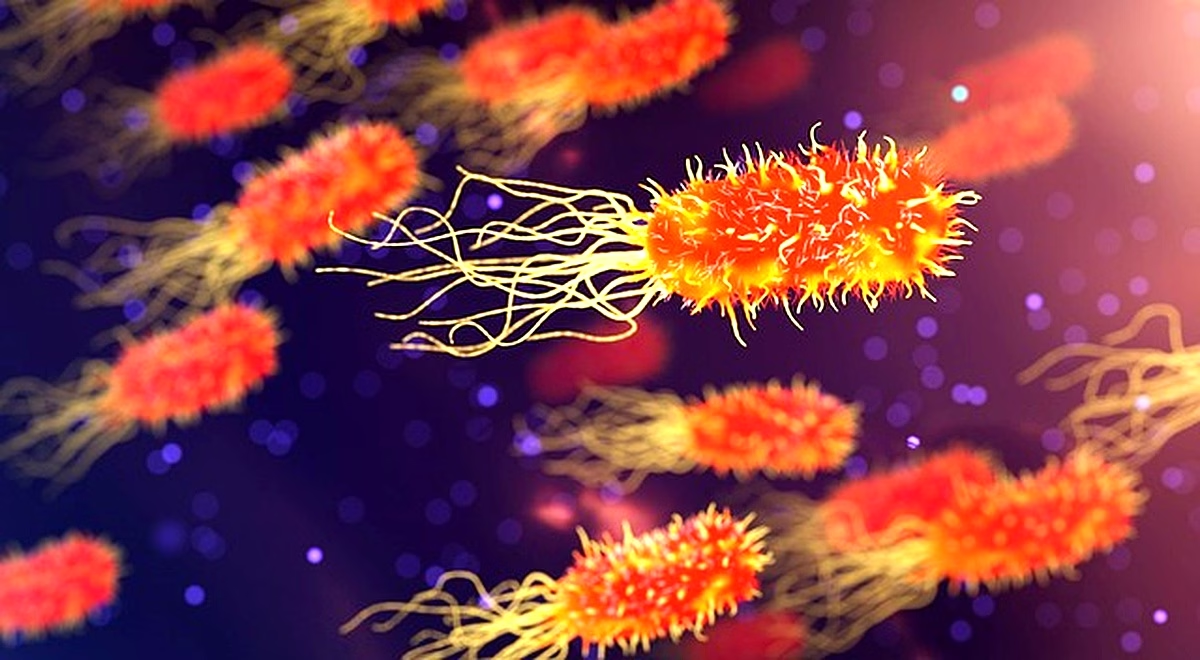
L’existence des bactéries dans l’environnement prend divers formes selon les conditions écologiques tel le microclimat et certains facteur physico-chimiques (T°,humidité, pression osmotiques, les élément nutritif, PH..) et dans une biocénose aquatique qui forme un habitat si particulier pour la survie bactérienne les germes ne pourront se croitre qu’à la présence des refuges qui les abritent en formant des biofilm sur les supports rencontrés ou en adhésion avec d’autres particules en fluctuation (forme adsorbé avec les MES matière en suspension) formant ainsi des systèmes phytoplanctonique ou bien absorbé par des protozoaires, métazoaires ou autres organismes filtreurs qui sert à des vecteurs passifs ou actifs et réservoir de nombreuses bactéries (Lucas, 2011).
Les microbes libres :
Cette forme est peu favorable et n’autorise pratiquement aucune forme de croissance. La survie ne peut que modestement se prolonger. Elle place la cellule en situation de carence car les germes n’ayant rencontré aucun support, aucun refuge, restent libres mais vulnérables.
Ils représentent une minorité en péril et sont incapables de reproduction et par conséquent appelés à disparaître (Brisou et Denis, 1978)
Les formes de résistance :
Certaines bactéries vivent dans un habitat relativement stable qui n’est pas soumis à des modifications physico-chimiques profondes, tel est le cas des bactéries pathogènes, parasites ou saprophytes de l’organisme hôte. D’autres organismes au contraire doivent s’adapter à des habitats contrastés et survivre dans un milieu hostile à des variations de température, de PH et à des carences nutritionnelles. Les bactéries doivent s’adapter pour survivre :
- Les spores sont l’une des formes de résistance et d’évolution que prennent certaines bactéries pour survivre dans des conditions hostiles et attendre des conditions plus propices afin qu’elles puissent germer et donner de nouvelles cellules végétatives identiques aux cellules originelles (Brisou et Denis, 1978 ; Leclerc et al, 1995).
- Les formes L représentent des états par lesquels toutes les bactéries peuvent passer à un moment de leur existence. Ce sont en fait des « façons d’être », des instantanés de la vie microbienne, fonctions de l’environnement. Des Salmonella, des Escherichia, prennent par exemple des formes inhabituelles de serpents, de poires, dès qu’elles séjournent dans une eau légèrement enrichie en matière organique. Le passage des bactéries à ces états de résistance, à été retrouvé dans les eaux d’égouts et de rivières et chez les mollusques. Ils restent le plus souvent inaperçus faute de mise en œuvre des techniques appropriées (Brisou et Denis, 1978).
Les microbes adsorbés :
L’adsorption d’une particule correspond à la fixation sur une autre sans intervention d’une réaction d’ordre chimique. Même si l’épaisseur de la couche adsorbée ne dépasse pas la dimension d’une molécule, l’adsorption constitue un état très favorable pour la survie bactérienne.
En effet, les matériaux favorables à la survie des bactéries, sont rassemblés aux doses maximales à la surface des particules adsorbantes ; ce qui permet aux microorganismes de trouver des conditions de survie acceptables.
Les particules adsorbantes, sont représentées par les matières en suspension (MES), et qui comprennent dans ce cas :
- le plancton représenté par le phytoplancton et le zooplancton;
- le tripton, qui regroupe les organismes morts, les détritus et des substances colloïdales. (Brisou et Denis, 1978)
Les microbes absorbés :
Vecteur passif en cas de simple adsorption, le plancton (protozoaires, zooplancton, métazoaires et organismes filtreurs la carpe argentée par exemple qui, en filtrant l’eau, absorbe de nombreuses bactéries entourant des particules en suspension) devient vecteur actif, conservateur, protecteur, véhicule de micro-organismes s’il les absorbe. Ces organismes jouent alors le rôle de réservoirs et de vecteurs de nombreux agents pathogènes pour l’homme et les animaux (Brisou et Denis, 1978).
Paramètres d’analyse bactériologique :
Généralités :
Le degré de pollution des eaux douces ou salés est cependant évalué par le dénombrement de certains bactéries appelées indicateurs de contamination fécale en général les coliforme fécaux appelées thérmotolérants et les streptocoques fécaux group D sont abondant dans les eaux usées la raison de ce choix tient essentiellement au fait que la numération de ces bactéries est beaucoup plus simple et rapide presque de 24 à 48 heures Les indicateurs de contamination fécale ont servi de base à l’établissement de l’ensemble des normes de qualité microbiologique des eaux.
Pour un niveau de contamination microbiologique donné, le risque sanitaire dépend de l’usage qui est fait de l’eau. L’eau qui est directement consommée, qui est utilisée comme ressource dans une usine de production d’eau potable, qui sert pour l’hygiène, la baignade ou pour d’autres activités récréatives nautiques, ou encore qui est utilisée pour l’irrigation des cultures n’expose évidemment pas aux mêmes risques sanitaires.
De ce fait, des normes différentes ont été établies pour chacun de ces usages (servais et al ,2007).
L’eau peut ainsi être un facteur de dissémination des microorganismes pathogènes les suivis et le contrôle de la qualité microbiologique de l’eau sont donc des éléments majeures dans la préservation de la santé publique à l’heure actuelle les contrôles sanitaires des eaux de surfaces sont généralisées pour les eaux de baignade et celles utilisées pour la production d’eau potable (Servais et al, 1999)
Nous fournissons ci-dessous deux exemple de ces normes le premier concerne la qualité des eaux de baignade pour lesquelles une norme toujours d’application a été édicté par l’UE en décembre 1975 le deuxième concerne la qualité pour les eaux superficielles destinées à la production d’eau de consommation selon (servais et al ,2007)
| Tableau 05: Qualité bactériologique requise pour les eaux de baignade (Directive européenne de Décembre, 1975) (servais et al ,2007) | ||
|---|---|---|
| Les germes | Norme guide | Norme impérative |
| Coliformes totaux | 500/100ml | 10000/100ml |
| Coliformes fécaux | 100/100ml | 2000/100ml |
| Streptocoques fécaux | 100/100ml | Non déterminé |
| Tableau 06: Qualité bactériologique requise pour les eaux douces superficielles utilisés pour la production d’eau livrée à la consommation (Directive européenne du 16 Juin, 1975, n°75/440) (servais et al ,2007) | |||
|---|---|---|---|
| Les germes | Valeur guide A1 | Valeur guide A2 | Valeur guide A3 |
| Coliformes totaux | 50/100ml | 5000/100ml | 50000/100ml |
| Coliformes fécaux | 20/100ml | 2000/100ml | 20000/100ml |
Les indicateurs microbiens :
On présente ci-dessous les germes indicateurs principaux, à savoir, les coliformes, les streptocoques fécaux :
Les coliformes totaux :
Les coliformes sont des bâtonnets, anaérobie facultatif, gram (-) non sporulant .Ils sont capables de croître en présence de sels biliaires et fermentent le lactose en produisant de l’acide et du gaz en 48 heures à des températures de 35 à 37° C ,ils regroupent les genres Escherichia, Citrobacter, Entérobacter, Klébsiella, Yersinia, Serratia, Rahnella, et Buttiauxella ,la recherche et le dénombrement de l’ensemble des coliformes (coliformes totaux), sans préjuger de leur appartenance taxonomique et de leur origine, est capital pour la vérification de l’efficacité d’un traitement d’un désinfectant mais il est d’un intérêt nuancé pour déceler une contamination d’origine fécale (Rodier et al, 1996).
Les coliformes fécaux :
Ce sont des bâtonnets Gram (-), aérobies et facultativement anaérobies ; non sporulant, capables de fermenter le lactose avec production de l’acide et de gaz à 36 et 44°C en moins de 24 heures. Ceux qui produisent de l’indole dans l’eau peptonée contenant du tryptophane à 44°C, sont souvent désignés sous le nom d’Escherichia Coli bien que le groupe comporte plusieurs souches différentes (Citrobacter freundii, Entérobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae…etc.) (Rodier et al ,1996). Les coliformes fécaux thérmotolérants (44°C) sont considérés d’origine humaine (Gaujous, 1995).
Les streptocoques fécaux :
Ces bactéries appartiennent à la famille de Streptococcaceae, au genre Streptococcus et au groupe sérologique D de LanceField (Sharpe, 1979). Ils sont définis comme étant des cocci sphériques légèrement ovales, gram positifs. Ils se disposent le plus souvent en diplocoques ou en chaînettes, se développent le mieux à 37°C et ils possédent le caractère homoférmentaire avec production de l’acide lactique sans gaz (Manuel de Bergey, 1984).
Il y a 5 espèces reconnues parmi les SF : S. bovis, S. equinus, S. avium, S. faecalis et S. faecium. Ils sont des témoins de contamination fécale assez résistant y compris dans les milieux salés (Gaujous, 1995). Ils peuvent aussi se multiplier dans les milieux présentant des pH allant jusqu’à 9.6
La flore mésophile aérobie totale :
La flore mésophile aérobie totale (FMAT) est utilisée comme un indicateur de pollution global. Elle englobe l’ensemble de microorganismes capables de se multiplier à l’air aux températures moyennes, surtout à une température optimale de croissance située entre 25 et 40°C. La FMAT renseigne aussi bien sur la microflore autochtone que sur la microflore allochtone apportée par la pollution.