Cette étude révèle comment l’innovation technologique contractuelle peut transformer la protection des droits du consommateur dans les contrats électroniques au Bénin. Découvrez les mécanismes juridiques essentiels pour prévenir les déséquilibres contractuels et garantir une exécution équitable des contrats.
Paragraphe II : L’annulation en cas de clauses abusives
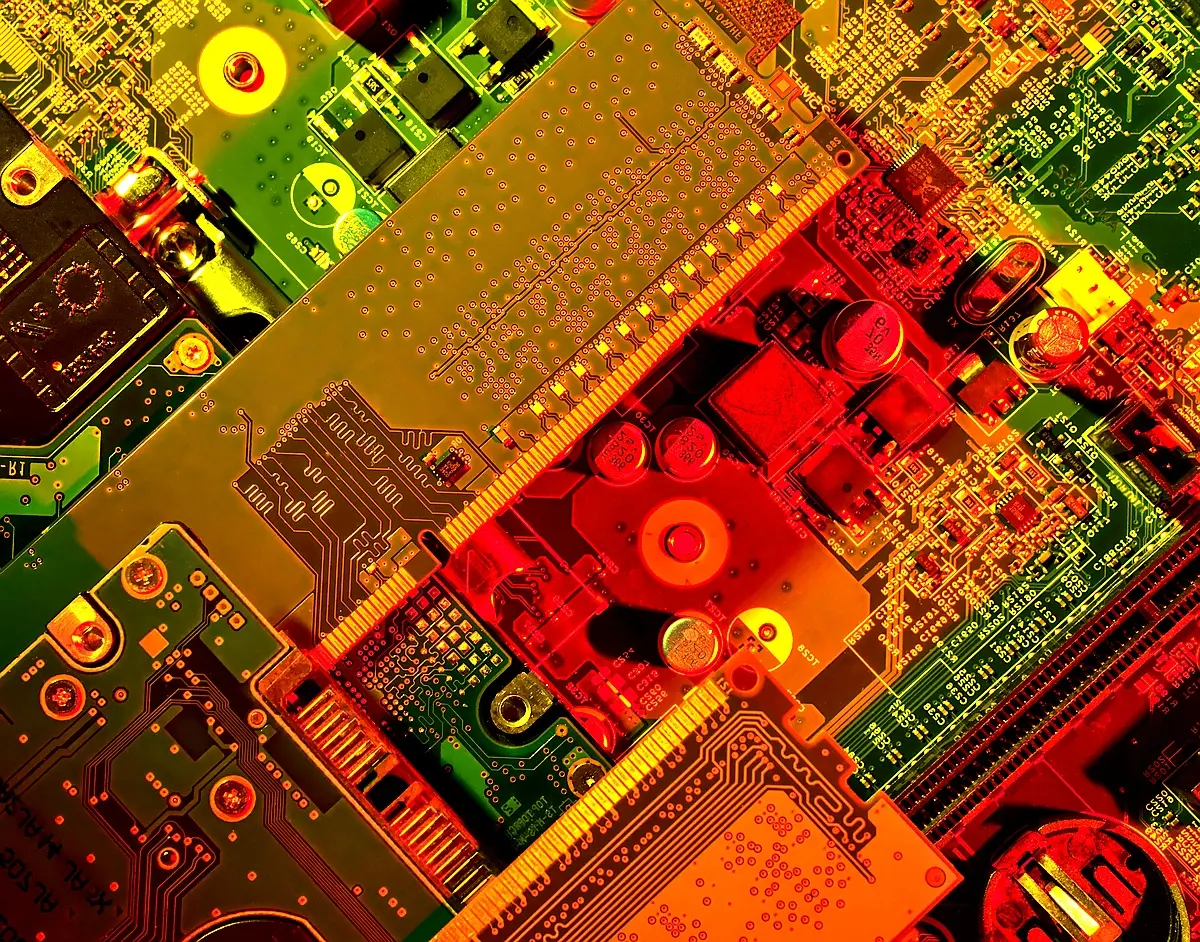
« Les clauses abusives sont des stipulations imposées à un non-professionnel ou un consommateur par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférant à celle-ci un avantage excessif »1. L’existence de clauses abusives met non seulement en cause l’équilibre contractuel du contrat (A) mais aussi viole la bonne foi qui est un élément essentiel dans la relation contractuelle qui lie les parties (B).
A- Le déséquilibre contractuel
Les parties qui s’engagent dans une relation contractuelle sont tous égaux tant à leur égard respectif que concernant les termes contractuels qui les lient. Ce principe d’égalité contractuel instauré en droit commun relativement aux contrats ordinaires s’invite également sur le terrain du contrat électronique. La relation contractuelle qui existe entre le professionnel et le consommateur en matière électronique étant une relation à priori dominée par le professionnel, il est du devoir de ce dernier de n’imposer des clauses abusives au consommateur. « Il s’agit des clauses, qui dans les contrats conclus entre
professionnels et non professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »2. Le déséquilibre contractuel s’explique par le fait pour le professionnel de profiter de sa position dominante sur le consommateur pour lui faire accepter des clauses qui en réalité peuvent être considéré comme abusives au regard de la relation contractuelle existant entre eux.
« Le déséquilibre doit donc être apprécié objectivement. Ce qui est essentiel, c’est le déséquilibre créé par la clause. Cela est particulièrement vrai en présence d’un pouvoir accordé unilatéralement au professionnel »3. « Une clause peut être regardée comme abusive bien qu’elle ait été négociée par le consommateur »4. Ce dernier étant ignorant du caractère abusif de la clause contractuelle par lui négocié au moment de la conclusion du contrat, il peut évoquer cette ignorance pour dénoncer la clause à laquelle il a préalablement souscrit.
L’existence de telles clauses peut donc justifier le recours au droit d’annulation par le consommateur.
Au Bénin, l’interdiction des clauses abusives a fait l’objet d’une attention particulière de la part du législateur tant qu’en droit commun des contrats de consommation, qu’en droit des contrats de consommation par voie électronique5. Toujours dans la dynamique de lutter contre le déséquilibre contractuel, le législateur béninois a mis à la charge du professionnel l’obligation de fournir au consommateur dès la conclusion du contrat des informations sur la substance des clauses contractuelles de façon claire, lisible et non- équivoque. Le non-respect d’une telle prescription est susceptible d’entraîner la nullité du contrat. En droit français, les clauses abusives, au sens de l’article L.132-1 du code de la
consommation sont prohibées, à la demande du client ou d’une association de consommateur6. La commission française des clauses abusives a émis une recommandation en 2007 relative aux clauses abusives dans les contrats de vente mobilière conclus par internet, dans laquelle elle propose d’éliminer seize (16) catégories de clauses7. Si la présence de clauses abusives influence considérablement l’équilibre contractuel entre les parties et peut être un motif d’annulation du contrat, il est évident que de telles clauses impactent aussi négativement la bonne foi des parties au contrat.
B- La violation de la notion de bonne foi
« La bonne foi est l’âme du droit des contrats »8, gardienne de la loyauté et de la morale mais elle est parfois critiquée pour sa subjectivité, source d’insécurité. La sécurité des transactions ne peut pourtant pas être acquise sans la loyauté. La bonne foi est l’un des éléments générateurs de la confiance contractuelle entre les parties contractantes.
Ainsi, pour donner une force obligatoire à une telle notion, le régime général des contrats l’a consacré à travers l’article 1134 du code civil français applicable au Bénin. Ces dispositions relatives à l’effet obligatoire du contrat font de la bonne foi un principe général qui s’impose aux parties lors de l’exécution du contrat.
Ce principe de bonne foi est également applicable au contrat électronique et les parties ont l’obligation de s’y soumettre. « Le rôle de la bonne foi est ici irremplaçable »9 « car il permet de sanctionner ceux qui entendraient jouer avec les dispositions contractuelles ou légales pour en retirer un bénéfice déloyal »10.
« C’est un principe bilatéral qui s’impose aussi bien au débiteur qu’au créancier, à tout contractant, quelle que soit sa qualité de professionnel ou de non professionnel. Le fait qu’elle pèse sur chacune des parties y compris sur celle que l’on pourrait qualifier de faible vient démentir l’idée selon laquelle la bonne foi aurait une vocation sociale et servirait un objectif de protection à sens unique »11. Selon la jurisprudence, « la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle »12. Il a été de même jugé à plusieurs reprises, « qu’une clause résolutoire n’est pas acquise, si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier »13.
En France, la réforme du 10 février 2016 généralise la bonne foi et renforce sa portée, de sorte que l’on peut s’interroger sur son influence grandissante. Il faut identifier les principales manifestations de son renforcement et les fonctions de la bonne foi mais aussi évaluer si la consécration d’un principe général constitue un danger ou un bienfait pour le droit des contrats.
La question se pose aussi de savoir si le principe général de bonne foi est totalement absorbé par les applications particulières qu’il sous-tend ou s’il a une portée supplémentaire. À la faveur de la réforme, la bonne foi ne progresse pas de manière anarchique mais ses fonctions sont rationalisées. La fonction de rééquilibrage du contrat qui lui est parfois attribuée, semble aujourd’hui dévolue à d’autres dispositifs, tels que le nouveau vice de violence résultant d’un abus de l’état de dépendance d’autrui14, la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion15 ou la révision judiciaire du contrat en cas d’imprévision16. Les contractants ne pourront pas s’affranchir directement ou indirectement de leur devoir de bonne foi. La loyauté ne se négocie pas17, et le principe de bonne foi est indivisible18. Il est ainsi impossible d’exclure les conséquences de sa défaillance contractuelle quant aux fautes dolosives commises de mauvaise foi19. La bonne foi n’affaiblit pas le droit des contrats mais le renforce. Elle joue un rôle directeur, protecteur, modérateur et défend une certaine morale des transactions sans affecter leur efficacité économique. Comme le relève un auteur, « mettre la bonne foi au premier plan ne signifie pas aller à l’encontre des évolutions de l’économie de marché… » 20. Le bénéfice du droit d’annulation implique pour le consommateur le fait de fonder son argumentaire sur des preuves tangibles.
________________________
1 CORNU (G.), op. cit., 11ème éd, Quadrige puf, 2016, p. 08. ↑
2 FERAL-SCHUHL (C.), op. cit., p. 345. ↑
3 SAUPHONOR-BROUILLAUD (V. N.), « clauses abusives dans les contrats de consommations : critères de l’abus », CCC 2008. Etudes 7 in GRYNBAUM (L.), LE GOFFIC (C.), MORLET-HAIDARA (L.), op. cit., p. 119. ↑
4 Ibid. p. 120. ↑
5 La loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en son article 10 a donné de manière précise ce qu’on peut entendre par clauses abusives. Si l’on se réfère au champ d’application (art 3) de la loi ci-dessus citée, il est évident que les dispositions de l’article 10 de ladite loi soient également applicables aux contrats de vente conclus via internet. ↑
6 TGI Paris, 4 févr.2003, Assoc. Familles de France c/Sté Père-Noel. Fr, D.2003, AJ 762, obs. MANARA (C.) ; Gaz. Pal. 2003, 2, somm. p. 2618. Note CHARPENTIER (Ph.), neuf clauses jugées abusives et annulées dans les conditions générales d’une société de vente par internet. ↑
7 Recom. n°2007-02, 24 mai 2007, BOCCRF 24 déc.2007 ; JCP E 2008, act. n°25. In LE TOURNEAU (P.), op. cit., p. 353. ↑
8 MEKKI (M.), « Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations » D. 2015, 816, n° 22. In DE BERTIER-LESTRADE (B.), ibid. ↑
9 MESTRE (J.), ibid. ↑
10 Ibid. ↑
11 FAGES (B.), « Droit des obligations », LGDJ 2018 n° 38. ↑
12 Com. 10 juillet 2007, Bull. civ. IV, n° 188. ↑
13 Civ. 1, 31 janv 1995, n° 92-20654. V. PICOD (Y.), « La clause résolutoire et la règle morale », JCP 1990, I 3447. ↑
14 C. Civ. art. 1143 Sur la distinction de la violence et de l’exigence de bonne foi V. TISSEYRE (S.), « Le rôle de la bonne foi en droit des contrats, essai d’analyse à la lumière du droit anglais et du droit européen », préf. FABRE-MAGNAN, PUAM (M.), 2012, n° 38. ↑
15 C. civ. art. 1171 V. Projet de cadre commun de référence, assoc H. Capitant SLC 2008 p. 150 qui relève que lors de la transposition de la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, certains « droits se sont éloignés du critère de bonne foi pour retenir uniquement le déséquilibre significatif comme caractéristique de l’abus, ainsi en droit français ». ↑
16 Ibid. ↑
17 Ibid. ↑
18 Ibid. ↑
19 Ibid. ↑
20 Ibid. ↑