Cette étude révèle les implications politiques des contrats électroniques au Bénin, en analysant les mécanismes juridiques qui protègent les droits des consommateurs. Découvrez comment ces règles peuvent transformer l’équilibre contractuel et garantir une exécution optimale des accords.
Section II : Le régime d’administration de la preuve
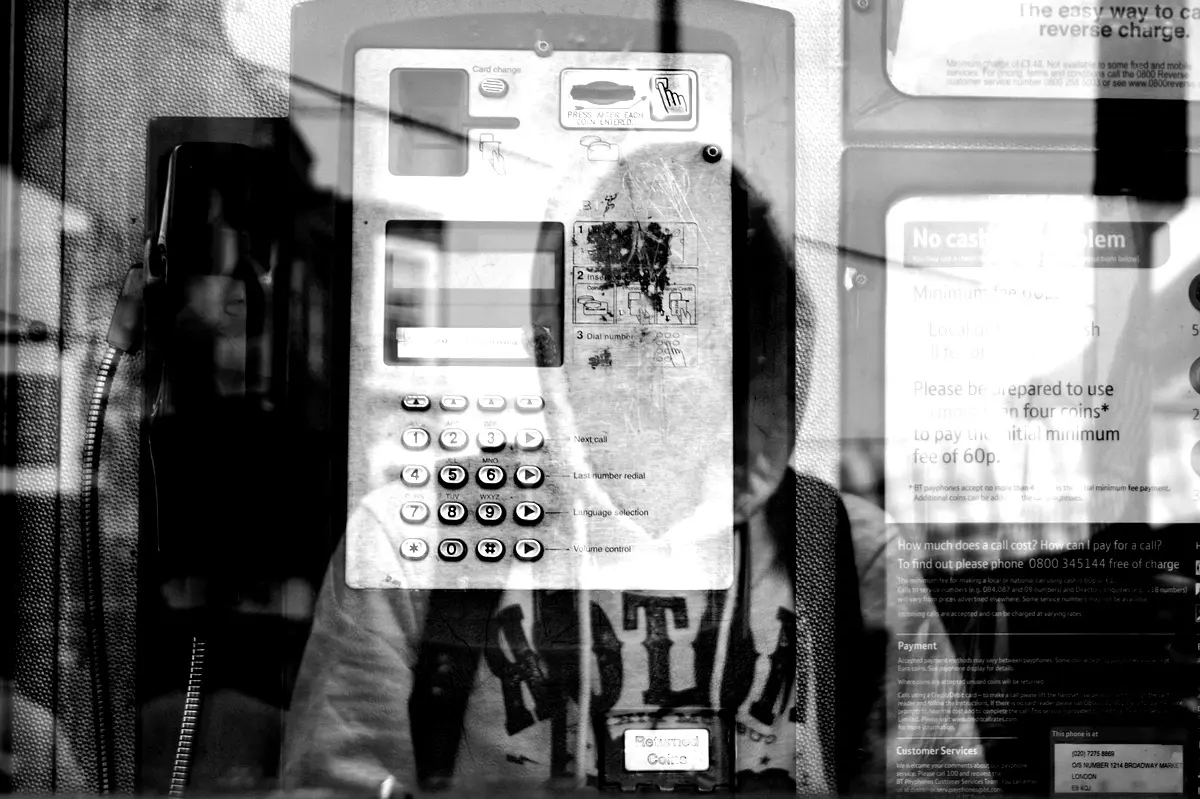
L’administration de la preuve pour solliciter l’annulation du contrat est basée sur une liberté (Paragraphe I) mais cette administration de preuve n’est pas sans difficultés (Paragraphe II).
Paragraphe I : La liberté de preuve
La virtualité qui caractérise les relations contractuelles entre le professionnel et le consommateur impose à ce dernier qui est tenu de rapporter la preuve pour justifier sa demande d’annulation du contrat (B), le recours à tous moyens pouvant lui permettre de faire prospérer ladite demande (A).
A- Un régime libératoire justifié
L’article 1315 du code civil pose en règle générale que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Dans l’administration de la preuve, il y a lieu de distinguer, en pratique, selon que l’existence d’un contrat est opposée à un commerçant ou à un non-commerçant. Dans le premier cas, la preuve est libre : une personne peut donc établir l’existence d’un contrat passé entre elle et un commerçant par toutes voies de droit, et notamment par témoignages ou présomptions.
Encore faut-il convaincre le juge de la valeur probante des témoignages et présomptions invoqués. En effet, ces modes de preuve n’ayant pas de force probante déterminée, le juge jouit, à leur égard, d’une souveraine liberté d’appréciation. Dans la seconde hypothèse, la preuve est réglementée : la loi hiérarchise les modes de preuves auxquels les parties peuvent recourir.
C’est le système du code civil, marqué par le principe de la prééminence de la preuve littérale, soit de l’acte instrumentaire préconstitué (authentique ou sous seing privé). Parmi les deux cas de figure précédemment évoqué, le premier cas est celui qui convient le plus en l’espèce car le contrat que le consommateur oppose au professionnel pour exercer son droit d’annulation est un contrat conclu avec un commerçant qui n’est rien d’autre que le professionnel en question.
Deux différents éléments justifient la liberté de preuve instaurée au profit du consommateur. Il y a d’abord, la virtualité sur lequel la transaction est basée et ensuite, la qualité de non-commerçant du consommateur. S’agissant de la question de la virtualité de la transaction, il est important de préciser que le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur est un contrat dématérialisé, c’est-à-dire un contrat dont la matérialité est numérisée.
Face à un tel cas de figure, le consommateur pour exercer son droit d’annulation du contrat peut produire non seulement le contrat mais aussi tout élément lui permettant de démontrer qu’il a eu une relation contractuelle avec le professionnel. Il n’est donc pas limité à la seule administration du contrat numérisé mais il a également la possibilité de faire recours à d’autres procédés lui permettant de convaincre le juge sur le bien-fondé de son action en annulation.
Concernant la qualité de non-commerçant du consommateur, il convient de préciser que dans le cas d’espèce, le consommateur qui s’engage dans une relation contractuelle avec le professionnel n’est pas un commerçant et le bien ou la prestation de services dont il sollicite le bénéficie est utilisé à des fins personnels. Au regard de ces éléments et de l’ignorance parfois des règles gouvernant les transactions en ligne souscrites par le consommateur, il est normal que l’on accorde à ce dernier une liberté dans l’administration de la preuve.
Même l’administration de la preuve est basée sur un régime libératoire qui se trouve justifié au regard de certains éléments de la transaction électronique et de la qualité du consommateur, il revient donc au consommateur de rapporter les preuves de son action en annulation en vue de convaincre le juge d’accéder à sa demande. Ainsi donc, la charge de la preuve en de pareilles circonstances incombe au consommateur.
B- La charge de la preuve
Dans le langage commun de l’administration de la preuve, il est de principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit être en mesure de rapporter la ou les preuve(s) fondant sa demande1. Ce principe découle de l’adage « la preuve est la rançon du droit ». « La charge de la preuve incombe ainsi au demandeur à l’instance (actori incumbit probatio), qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
Le défendeur à l’instance n’a quant à lui, à ce stade, rien à prouver. Cette solution est fondée sur l’idée que le demandeur, parce qu’il entend remettre en cause une situation « normale », doit supporter le fardeau de la preuve »2. En effet, « normalement, personne ne doit rien à personne »3 ; il en résulte, par exemple en droit des contrats, que le vendeur qui réclame l’exécution du contrat de vente doit en établir l’existence, de même qu’en droit de la responsabilité extracontractuelle, la victime d’un dommage doit, pour en obtenir réparation, établir la faute du défendeur, le préjudice subi et enfin, le lien de causalité entre la faute et le préjudice. L’évocation de l’annulation d’un acte juridique ne se présume donc pas, il doit être prouvé afin que la demande d’annulation soit recevable ou non. Ainsi donc, il pèse sur le consommateur, l’obligation de justifier sa demande à travers des preuves tangibles pouvant emporter la conviction du juge.
Le consommateur qui estime qu’il est en droit de bénéficier du droit d’annulation doit être en mesure de justifier son action. Si l’on reconnait à la vente en ligne une certaine particularité qui déroge souvent aux principes de droit commun applicable aux contrats ordinaires, le principe de la charge de la preuve n’a pas connu une atténuation en matière de contrat électronique. Ainsi donc, il ne suffit de bénéficier d’un privilège de la loi pour se prétendre avoir gain de cause automatiquement lorsque l’on intente une action en justice.
Objet d’applications régulières et constantes en jurisprudence, ce principe vient à nouveau d’être rappelé dans une décision récente de la Cour de cassation, qui posait la question de la charge de la preuve du caractère disproportionné de la démolition consécutive à l’anéantissement d’un contrat de construction de maison individuelle résultant de l’exercice, par les maîtres de l’ouvrage, de leur faculté de rétractation. Le constructeur s’étant opposé à la demande de démolition des maîtres de l’ouvrage, la Cour de cassation a alors rappelé que relève du juge, et non du constructeur (partie à l’instance), la charge d’apprécier en droit la proportionnalité de cette sanction : « en cas d’anéantissement du contrat, le juge, saisi d’une demande de remise en état du terrain au titre des restitutions réciproques, doit rechercher si la démolition de l’ouvrage réalisé constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent »4. Même si une certaine liberté est reconnue au consommateur pour administrer la preuve, ce dernier rencontre des difficultés pour exercer cette charge.
________________________
1 Cf. art 1315 du code civil. ↑
2 MARAIS (A.), « Introduction au droit », Vuibert, 5e éd., n° 256, p. 216. ↑
3 MEKKI (M.), « La réforme au milieu du gué. Les notions absentes ? Les principes généraux du droit des contrats– aspects substantiels », RDC 2015, p. 653. ↑
4 LE TOURNEAU (P.), POUMAREDE (M.), Répert. Civ. Dalloz, Bonne Foi n° 21. ↑