L’évolution du statut des femmes divorcées en Kabylie révèle des transformations significatives, influencées par des réformes juridiques et des coutumes locales. Cette étude met en lumière les impacts du divorce sur leur statut social, en comparant les contextes traditionnels et modernes.
Chapitre III
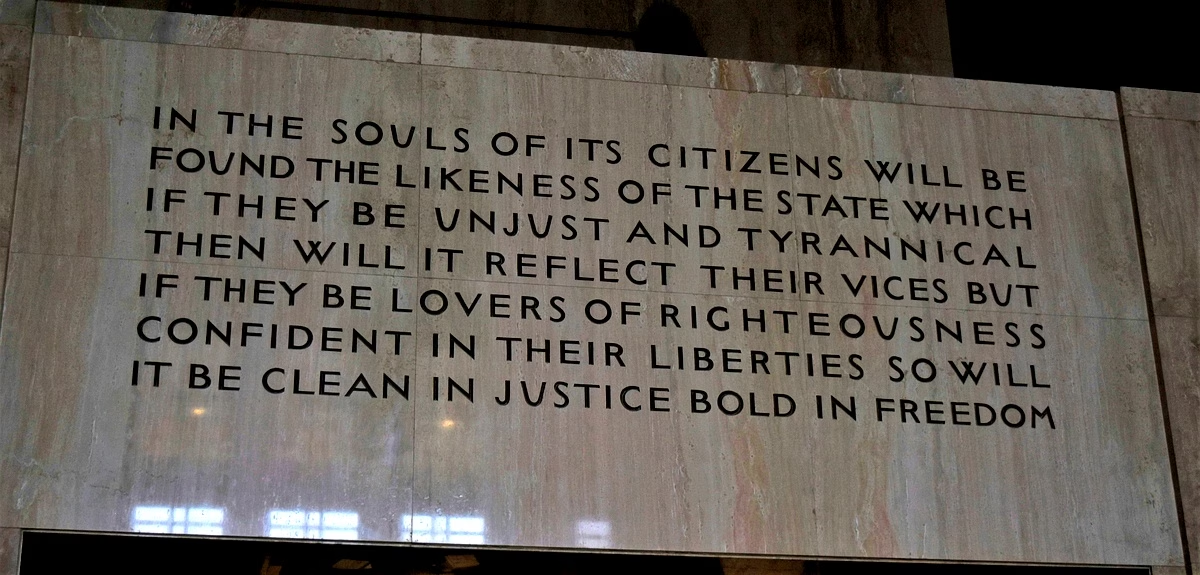
L’évolution du statut de la femme divorcée dans la société kabyle
Les premières réformes du statut personnel de la femme interviennent en Kabylie dès les années vingt et trente. Pour le gouvernement français et les juristes coloniaux, le statut personnel de la femme kabyle apparait particulièrement discriminatoire et non conforme au droit musulman. Il est plus largement codifié par les coutumes locales. Cet état de fait, ne permet pas en particulier à la femme kabyle d’hériter ou d’accéder aux droits du divorce.
En effet, la femme dans la société kabyle occupe un statut qui n’est pas toujours le même car il change à travers le temps. Notre intérêt dans le présent chapitre est d’arriver à cerner toutes les conditions sociales et juridiques dans lesquelles vit la femme « divorcée » dans la société kabyle traditionnelle et moderne. Il s’agit également de voir quels sont les changements significatifs que nous pouvons relever.
Et pour atteindre notre objectif nous avons recouru aux cas du divorce que nous avons recueillis sur le terrain avec l’aide des femmes divorcées de différentes générations. Nous avons examiné aussi le dispositif juridique qui découle soit du droit coutumier (qanoun kabyle) soit du code de la famille. Enfin, nous avons consulté une avocate qualifiée qui nous a éclairés sur les questions liées à notre objet.
Le statut de la femme kabyle divorcée dans la société traditionnelle
Dans la société traditionnelle kabyle, la femme occupe une place cardinale dans la sauvegarde et la reproduction du groupe auquel elle appartient. De tout temps, elle a su faire perdurer notre culture malgré les situations difficiles auxquelles elle a été confrontée.
Dans le contexte kabyle, la coutume est représentée comme une loi codifiée, c’est ce qu’on appelle le «qanoun », de toutes les législations qui ont attribué au mari un droit supérieur au droit de l’épouse, la coutume kabyle est la plus dure à l’égard de la femme.
Dans le cadre de l’anthropologie coloniale, on trouve dans les travaux des administrateurs, missionnaires, ou militaires à l’image du général Hanoteau qui a consacré toute une partie dans son ouvrage « poésie populaire de la Kabylie de Djurdjura » sur la situation de la femme chez les Kabyles. Il a fait une critique virulente des lois coutumières et du traitement réservé par les villages et leurs assemblées aux femmes.
Selon Hanoteau et Letourneux, les conditions de vie de la femme kabyle sont misérables et pénibles. Elle n’avait ni autorité, ni les droits dont jouissent l’homme. Hanoteau critique le mariage chez les Kabyles en le considérant comme un acte de vente. La femme ne peut émettre son avis, ni choisir son mari, c’est son père qui la marie à celui qu’il veut.
L’auteur écrit à ce propos : « C’est la conséquence forcée de la nature du mariage, par lequel celle-ci n’est pas unie à l’homme, mais achetée par lui »1. Il rapporte également qu’il fut témoin de quelques prix avec lesquelles sont vendus les femmes : « il y a celles qui sont vendues à 75ff, certaines à 12 ff, d’autre 2ff, ou encore 5ff »2.
Concernant la séparation des époux, celle-ci ne peut se réaliser sauf en cas de mort du mari ou par la répudiation. Comme dans les sociétés sémitiques primitives, la dissolution du lien matrimonial ne se conçoit pas autrement que par la répudiation prononcée par le mari considéré par ailleurs comme le maître tout puissant au sein du couple.
Le mariage n’est pas en effet conçu comme un contrat d’association entre un homme et une femme. Et tout comme il n’est pas demandé à celle-ci de consentir à son mariage, il ne lui est pas demandé d’avoir un avis sur sa dissolution. Dans ce contexte, la rupture du lien conjugal ne revêt aucun caractère juridique ou même sacramentel.
Il est tout simplement reconnu au mari la possibilité de prononcer la rupture du mariage si telle est sa volonté.
Dans la société traditionnelle kabyle la répudiation connait deux espèces qui sont :
- Le berru-n-teguri (répudiation avec fixation de prix) :
Dans ce type de divorce le mari renvoie sa femme en prononçant la formule suivante : «Je te répudie et je mets sur ta tête telle somme » (briɣ-am, greɣ fell-am kada n yidrimen). La formule est prononcée une, deux ou trois fois.
L’effet du berru-n-teguri est de donner à la femme la liberté de se marier moyennant le payement de la somme fixée. Néanmoins, il arrive quelques fois que la somme fixée est tellement forte qu’elle ne peut être remise au mari. Dans ce cas, la répudiation équivaut alors à une interdiction absolue de mariage. La femme qui subit ce cas est retirée de la circulation et nommée thamaouok’t 3. Mais dans le cas où ce type de répudiation s’est effectué l’opinion publique n’admet pas que la femme ainsi répudiée puisse être reprise par son mari. Cependant, si la formule de répudiation n’a été prononcée qu’une fois, le mari peut reprendre sa femme tout en faisant intervenir un marabout et des témoins. Il lui offre à nouveau un çadak, et obtient le consentement du père qui peut exiger un supplément de taɛmamt(timerna). Mais si la formule fatale a été répétée, le mari ne trouvera aucun moyen pour se réunir à nouveau avec sa femme.
________________________
1 HANOTEAU ET LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles, op. cit. p178. ↑
2 HANOTEAU A., Poésie populaire de la Kabylie du djurdjura, éd Challamel, Paris, 1867, p. 288. ↑
3 HANOTEAU ET LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles tome 2, op. cit. p.178. ↑