Le discours rapporté dans Ravisseur de Leila Marouane révèle des modes variés de représentation de la parole, intégrant habilement discours direct et indirect. Cette analyse met en lumière leur rôle crucial dans la progression narrative et la construction des idéologies au sein du récit.
Le discours rapporté
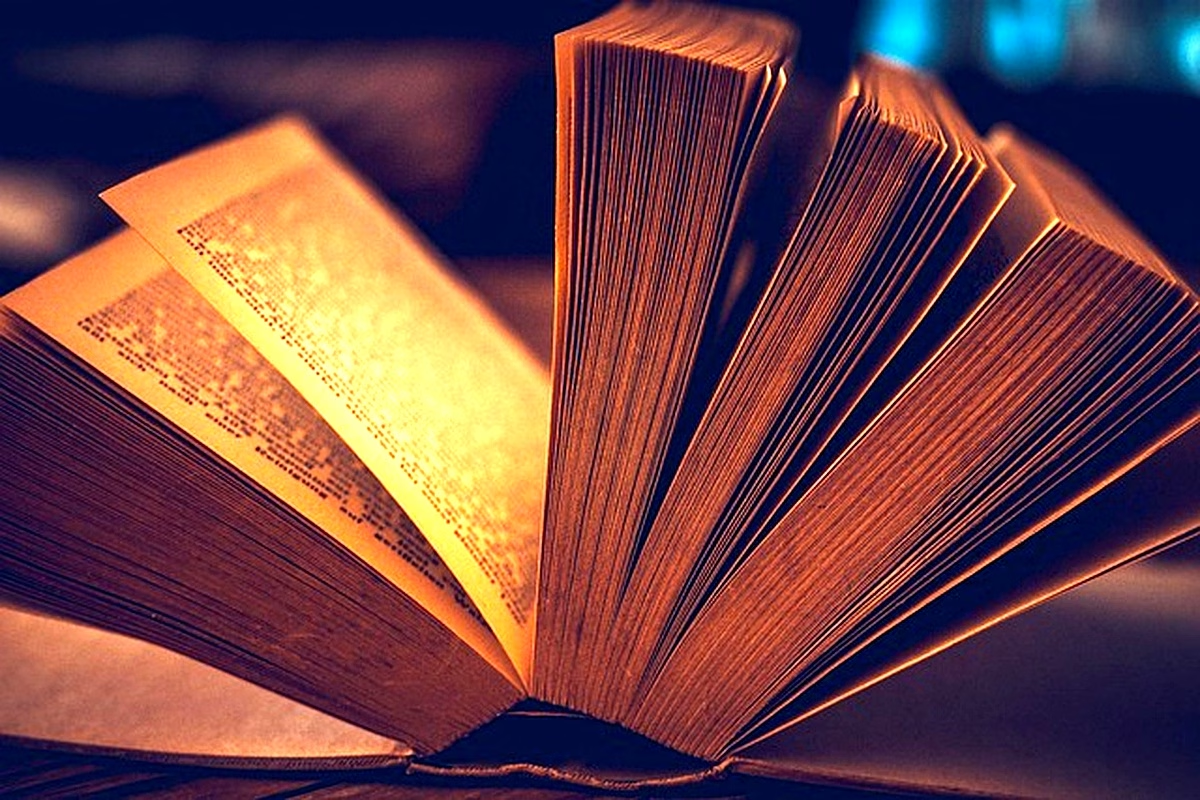
I. 2.1. Les modes de représentations de la parole
L’auteur peut transmettre les paroles des personnages en utilisant différents styles et en adoptant divers procédés soit rapporter fidèlement les paroles des personnages soit de les analyser ou de les faire suivre d’un accompagnement narratif. Ravisseur, se caractérise par l’emploi de différentes formes de discours rapportés pour intégrer le discours cité dans le discours citant : le discours direct, l’indirect, l’indirect libre et le narrativisé.
I. 2.1.1. Le discours narrativisé
Le discours narrativisé correspond à un résumé dans lequel la narratrice survole les propos échangés par les personnages. L’accent est généralement mis sur l’action que constituent les paroles résumées (menace, blâme, accusation, encouragement…). Ce discours est un lieu de polyphonie qui mêle les voix de plusieurs personnages.
Mon père se plaignait de ne pas digérer son déjeuner, un ragoût de sardines cuisiné par les jumelles, et menaçait de leur faire ingurgiter une bouteille de javel (…) (p. 57)
Quand ses douleurs se furent calmées, mon père cessa ses complaintes et me dit de monter…, si j’en avais envie. En fait c’était un ordre, un vrai, de ceux qu’on ne discute pas, auquel on ne coupe pas, auquel on n’échappe pas. Il me demandait en quelque sorte, d’espionner ma mère dans ses préparatifs pour ses deuxièmes noces. (p. 58)
Ma belle sœur essayait de convaincre ma mère de troquer ses robes contre un caftan de son trousseau de mariée. (p. 58)
Aucun détail n’est fourni sur la nature des plaintes, des menaces et des insultes. C’est là qu’intervient le rôle du lecteur pour deviner les mots qui peuvent être prononcées dans des situations identiques.
Et dans l’exemple qui suit, la narratrice survole la scène parce que le lecteur a connaissance de tous ces évènements (évoqués dans le récit et les dialogues précédent) d’où l’inutilité de les raconter de nouveau.
Je raconte tout : les visites du vrai faux sage, sa soudaine disparition suivie de l’arrivée immédiate de l’unijambiste, ses confidences, la soi-disant émasculation, Khadidja qui n’est pas Khadidja. Tout. Même les femmes-hommes….
Elles m’écoutent sans égayer. (p 183)
Ce type de discours est souvent employé pour rapporter des évènements passés sans sombrer dans les détails.
Mes cris réveillèrent mes sœurs. Les jumelles appelèrent à l’aide, s’époumonèrent, ameutèrent le quartier. En vain. Au-dehors, les hommes pressaient le pas en ricanant ; les femmes ouvraient leurs persiennes, conjuraient le sort en crachant dans leurs corsage, les plus sensibles versaient une larme. (p. 112)
Noria et Fouzia se précipitèrent dans la rue, implorèrent les voisins de prévenir la police, les pompiers, ou l’hôpital. Les hommes continuaient de presser le pas. Mais ils ricanaient moins. (p.113)
Le discours narrativisé permet de rapporter non seulement le comportement verbal des sœurs (appeler, s’époumoner, ameuter) employant des verbes véhiculant une charge sémantique, mais aussi pour exhiber la réaction des voisins qui ne cessaient de ricaner approuvant l’agression physique de la fille aînée. Nous remarquons un déplacement de la maison à la rue. Les jumelles n’ayant pu obtenir de l’aide, les petites sœurs sortent dans la rue implorer les voisins
Dans l’exemple ci-après, le père libère d’une façon inconsciente ses pensées (il est saoul et parle à sa tante décédée)
Enfermé dans sa chambre, l’esprit brumeux, il parlait à sa tante, faisant l’apologie de la peine de mort, des bourreaux et de toutes les législations, religieuses ou non, monothéistes ou non, condamnant les adultères de quelque nature qu’ils fussent, appelant à la lapidation des femmes sans vertu. (p. 95)
Donc le discours narrativisé permet de rapporter les réflexions des personnages et de faire résonner des voix simultanément dans le récit
I.2.1.2. Le discours indirect
Les passages au discours indirect sont cités en hypotaxe et en dépendance énonciative du discours citant, auquel ils sont subordonnés sur le plan syntaxique. Ce discours laisse voir d’une manière plus détaillé les propos des personnages. Il est aisément facile de reconnaître le discours indirect, puisque chaque assertion est introduite par verbe de locution.
Ce procédé est utilisé dans Ravisseur pour insérer des dialogues résumés et pour introduire les dialogues au discours direct comme le montre cet exemple.
[…] il se lança dans un interminable serment, qu’il conclut par un mot gentil pour chacune de nous. Il jura sur la tombe, mère et tante, aïeux et aïeules, saints et saintes devant nous, ses filles, ses meilleurs témoins, qu’il cesserait de boire, dès le lendemain, qu’il irait purifier son âme et ses os à Zamzam, la source de la sainte Kaaba, que ma mère l’accompagnerait, qu’ils nous rapporteraient des coupons de soie damascène et indienne et même des bijoux pour nos trousseaux de mariage. (p.68-69)
L’auteur présente le discours du père dans un style indirect ce qui introduit une distance. Interdit momentanément, de s’exprimer directement, le père est alors en position inférieure sur l’axe hiérarchique. L’auteur utilise le style indirect, tant le contenu des propos du père est sans conséquence parce que toutes ces promesses sont faites en état d’ivresse. La parole lui est donnée lorsque les filles participent à la conversation.
Cette situation de renversement d’une position haute à une position basse est confirmée par le commentaire descriptif qui introduit le discours du père et qui met l’accent sur une situation de tension.
Titubant et rotant son vin, mon père errait dans la maison ; ses pas maintenant résonnaient dans le couloir. Nous nous tûmes, épiant le moindre bruit. Nous attendant à la démolition immédiate des lieux. C’est alors qu’il poussa la porte de la chambre. Nous nous redressâmes par la peur. Le moment était donc venu de nous incriminer de tous les maux, de nous rosser, jusqu’à la meurtrissure et l’évanouissement. (p. 68)
Puis elle poursuit le commentaire, avec une situation opposée introduite par un connecteur d’opposition.
Mais un sourire déchirait le visage adipeux de notre père. Un sourire de contrition, certes, mais un sourire. Même ses yeux mi-clos, bouffis et rougis semblaient baigner dans une triste hilarité. Qu’est-il donc advenu de rugissements du lion ivre ? que craignait celui qui pouvait acheter et revendre le quartier, et avec lui ses habitants ? (p. 68)
Quelques lignes plus loin, la narratrice parle de monologue.
Il poursuivit son monologue, autorisant désormais Fouzia à parler, à discourir, si ça lui chantait (…) promit de lui procurer des livres de poésie, de chants, peut-être même un piano, d’engager un orthophoniste pour elle ; il exposa un nouveau plan pour les jumelles…. (p. 69)
Après hésitation, marquée par les points de suspension, le père enchaîne au style direct un dialogue avec ses filles. Les répliques des filles ne sont en réalité que des remerciements.
- Vous serez coiffeuse. Je vous achèterai un salon que les meilleures architectes de la capitale transformeront en un salon digne des coiffeurs de Paris.
- Merci, papa.
- Merci, papa.
- Merschi, papa.
- Merci, papa.
- Quant à toi reprit-il en me dévisageant, je ferai venir le marabout le plus compétent du pays qui te débarrassera du démon qui t’habite.
- Je suis sûr que tu es une bonne fille, poursuivit mon père. Enfin, tu serais une bonne fille si ce n’était ce mauvais génie. Quand tu auras guéri, expié tes fautes et terminé ta formation, je t’achèterai des ordinateurs, des fax, des photocopieurs, tout ce qu’il faudra pour un bureau des plus modernes.
- Merci, papa, dis-je à mon tour. (p. 69-70)
Chez Marouane, le discours indirect est un moyen pour achever un dialogue en rapportant les paroles des personnages.
Quand elle eut terminé de s’égosiller, Noria rangea ses affaires et annonça qu’elle se coucherait sans dîner. Fouzia l’imita. Ainsi mirent-elles un terme à la discorde des jumelles. (p. 102)
La fonction du discours indirect dans le récit est de résumer, d’introduire le dialogue ou d’assurer sa clôture mais surtout d’interdire l’expression directe d’un personnage. Dans son roman, l’auteur n’utilise pas un type de discours mais préfère varier les discours.
I. 2.1.3. Le discours indirect libre
Le discours indirect libre, énoncé rapporté sans indices d’attribution, et conservant l’emploi des temps et des pronoms de l’indirect, permet d’insérer l’intonation du locuteur dans le texte. Maingueneau souligne que « le discours indirect libre, selon les cas, intègre des proportions variables de traits linguistiques caractéristiques du discours direct et du discours indirect. Certains textes seront plutôt dominés par le discours indirect et d’autres plutôt par le discours direct. »1
L’indirect libre se caractérise d’une part, par l’absence de subordination, et s’accompagne d’une transposition des temps et des personnes comme le style indirect ; et d’autre part par son caractère hybride « il suppose au moins deux instances d’énonciation, le discours rapportant se faisant l’écho d’une autre voix, dont on ne peut reconstituer les paroles comme dans une citation distincte.»2
Ce discours succède souvent au style indirect. Il est utilisé pour introduire les pensées du personnage..
Il y avait des jours où elle ne me lâchait pas d’une semelle, de plus en pus, elle se fondait dans mon ombre et n’avait de cesse de me témoigner sa confiance. (Excellente ruse de guerre). Elle me racontait sa vie, s’embourbait dans des détails, que je démêlais, faisant mine de l’aider à recouvrer ses souvenirs. En fait, je l’empêtrais davantage. (Tactique de guerre). Elle insistait sur les chalutiers confisqués, réquisitionnés à cause, précisément, des micmacs et manigances menés contre Aziz le pêcheur, échafaudés par Youssef Allouchi et ses filles dont l’aînée, une certaine Samira (MOI !), devait maintenant faire bon usage de son corps, là-haut, très haut, sur les montagnes.
Le discours indirect libre est souvent introduit par la narratrice. Maingueneau remarque que « ce recours systématique au discours indirect libre permet de mettre à l’imparfait et à la non personne aussi bien les descriptions du monde extérieur que celle des pensées des personnages. » et « au discours indirect libre, le présent, le passé et le futur sont tous traduits par des formes en ait »3
Derrière la porte de sa chambre, mon père se noyait dans son vin, s’embourbait dans ses supputations, s’étranglait de remords Après tout….
Ils ne réapparaissaient pas.
N’avaient-ils pas pris le train de leur plein gé ?
Aurait-il pu deviner ce qu’elle faisait seule à la maison ? Il aurait dû mettre des cadenas aux portes…
Non, il aurait dû s’enfermer avec elle.
Ses enfants étaient-ils les siens ?
Les zeitoun n’engendraient pas autant de filles. Et si filles il y avait, elles étaient vertueuse, ne découchaient pas, ne se laissaient pas violer, ne répudiant pas leur mari, ne corrompaient pas les imams, ne manipulaient pas leurs fils. N’est-ce pas ? Ô ma tante ! Ô sa tante ! Quel affront !
Si Youssef Allouchi ne s’était jamais marié, c’est qu’il n’en avait pas besoin ; sa belle était à portée de main. Mon père préférait de dire de main, par respect, mais sa tante saurait traduire ! (p. 98-99)
Nous remarquons dans l’exemple ci-dessus, l’emploi de l’imparfait et la troisième personne. Les pensées et paroles plausibles du personnage peuvent être rétablies sous une forme directe et, par soustraction apparaîtra le discours du locuteur supposé. Ce type de discours permet à la narratrice de se confondre avec le personnage pour tracer une ironie discrète (Après tout – Il aurait dû mettre des cadenas aux portes- Non, il aurait dû s’enfermer avec elle, sa tante saurait traduire).
________________________
1Maingueneau Dominique.L’énonciation en linguistique française. Hachette. 1991. p. 113-114 ↑
2Bakhtine Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman. Gallimard. 1975. p. 116 ↑
3Maingueneau Dominique. Eléments de linguistique pour le texte littéraire. Bordas. 1990. p. 100 ↑