Cette étude révèle comment les applications pratiques des contrats au Bénin garantissent la protection des droits des consommateurs dans le cadre électronique. Découvrez les mécanismes juridiques essentiels qui préviennent les déséquilibres contractuels et optimisent l’exécution des contrats.
B- La théorie de la formation du contrat sous condition résolutoire potestative
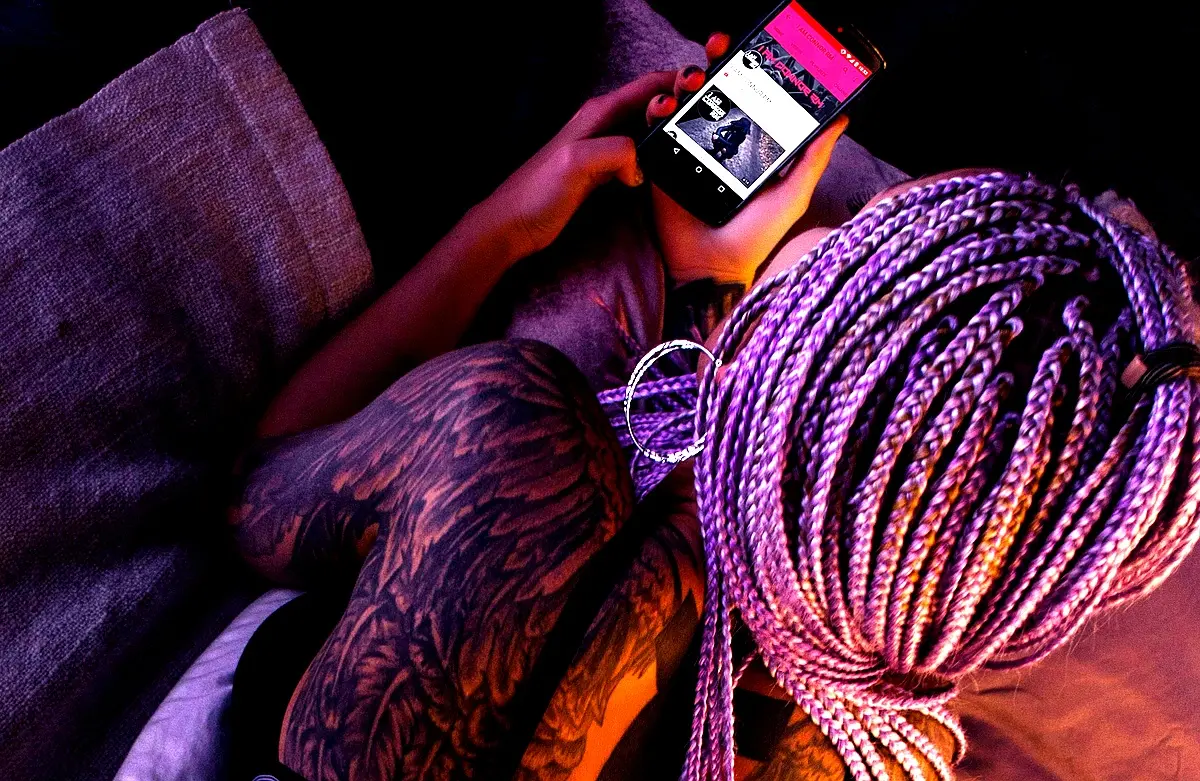
« Les droits potestatifs sont des pouvoirs par lesquels leurs titulaires peuvent agir sur les situations juridiques préexistantes, en les modifiant, les éteignant ou en créant de nouvelles, au moyen d’une activité propre unilatérale »1. « Plusieurs prérogatives ont pu être qualifiées de droit potestatif. En matière contractuelle, on a identifié notamment les réserves stipulées dans un contrat » 2, « les droits d’option en général » 3 et « plus récemment la clause de dédit »4 et la « clause résolutoire »5.
La théorie des droits potestatifs, si elle doit être précisée6, reste séduisante et d’une construction logique rigoureuse. Elle est susceptible d’accueillir de nombreuses prérogatives qui semblent insaisissables par les qualifications de droit personnel et de droit réel.
Tel semble être le cas du droit de rétractation. Plusieurs auteurs assimilent le droit de rétractation à un droit potestatif7. Tant sous l’angle actif que sous l’angle passif, le droit de rétractation répond à la définition de ces prérogatives.
Sous l’angle actif du droit, tout d’abord, il est manifeste que le titulaire du droit de rétractation est investi d’un pouvoir qui lui permet de modifier ou d’éteindre une situation juridique préexistante8.
Sous l’angle passif du droit, la maîtrise du contrat par le titulaire du droit de rétractation est assurée par la complète passivité de son cocontractant. « Le législateur a veillé à ce qu’il lui soit impossible d’y faire obstacle par l’interdiction dans de nombreux cas de tout début d’exécution »9, par l’impossibilité d’obtenir du consommateur une renonciation anticipée10, par diverses mesures d’ordre pratique visant à faciliter sa rétractation11. Le législateur a donc bien organisé la sujétion du professionnel à l’exercice par le consommateur de son droit potestatif de rétractation.
« Cependant, dans les études où il est distingué nettement entre le délai de réflexion et la rétractation, les auteurs considèrent que cette faculté constitue une condition résolutoire qui affecte un contrat déjà formé »12. Il découle de ces études, que « la rétractation constitue une manifestation de volonté ayant pour objet de mettre fin au contrat déjà formé, elle entraîne la résolution ou la résiliation du contrat »13.
Dans ces conditions, un contrat même formé peut perdre son effet obligatoire sans mettre en jeu la responsabilité du consommateur. Ce dernier peut donc user du droit de rétractation dont il bénéficie pour anéantir l’effet obligatoire du contrat. On peut donc conclure que le contrat n’a jamais existé entre les parties contractantes.
Cette conception d’assimilation du droit de rétractation à un droit potestatif impliquant la résolution ou la résiliation du contrat qui est déjà conclu pose un problème de sécurité juridique contractuelle dans la mesure où il est de principe en droit contractuel que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Si l’on conçoit donc que le contrat une fois formé sans qu’il ne soit exécuté, peut-être rompu, par l’une des parties au contrat de manière unilatérale, cette rupture ne sécurise pas la relation contractuelle et porte atteinte au principe de l’effet obligatoire du contrat. Malgré ces évidences, la raison d’être du droit de rétractation ne manque pas de pertinence, car il est instauré pour protéger le consommateur qui est en position de vulnérabilité.
Étant donc le bénéficiaire d’un tel droit, le consommateur dispose de la faculté d’exercer ledit droit.
________________________
1 Définition de l’auteur italien MESSINA, largement répandue en doctrine, voir BOYER (L.), « les promesses synallagmatiques de vente ». p. 26 note 5. ↑
2 V. la thèse de CÉLICE (M. B.) « les réserves et le non-vouloir dans les actes juridiques », th.1965, Paris, Bdp.t.84, LGDJ 1968, qui définit le droit potestatif comme la faculté de mettre autrui dans l’inefficacité de vouloir (n° 209) et la réserve dans le contrat comme la création synallagmatique de droits potestatifs qui assurent à leur bénéficiaire la maîtrise de la durée de l’acte (n°412). ↑
3 NAJJAR (I.) « Le droit d’option, contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral », th. Paris 1966, LGDJ 1967, n°97 et s., sur le droit de préemption, en particulier SAINT-HALARY-HOUIN (C.), « Le droit de préemption », Bdp.t.164, LGDJ 1979, n°479 et s.., sur le droit du bénéficiaire d’un pacte d’option, on citera deux études en particulier : BÉNAC-SCHMIDT (F.), « Le contrat de promesse unilatérale de vente », Bdp.t.177, LGDJ 1983, spéc. n°137 et s., et, COLLART-DUTILLEUL (F.), « Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble », Sirey 1988, coll. Immobilier Droit et gestion, spéc. n°252 et s. ↑
4 BOYER (L.) « La clause de dédit » in Mélanges RAYNAUD (P.), D, 1985, p. 41. ↑
5 PAULIN (Ch.), « La clause résolutoire », Bdp t.258, LGDJ 1996, n°163. Pour un recensement des droits potestatifs, v. en dernier lieu VALORY (S.), « la potestativité dans les relations contractuelles », th. Aix-Marseille, 1999, n°51 et s. ↑
6 Notamment en matière de promesse unilatérale de contrat, il faudrait se garder de toute conclusion hâtive. La théorie des droits potestatifs doit être précisée à propos de la situation du sujet passif : on avait fait, dès l’origine, ce reproche à Messina de rester un peu évasif quant au contenu de la notion de sujétion (V. NAJJAR (I.), th. préc. n°101). Il ne semble pas que l’élément de sujétion exclut une combinaison avec des obligations à la charge du sujet passif (obligation de ne pas faire dans le pacte d’option) ou du sujet actif (obligation de payer une somme d’argent : dédit ou indemnité d’immobilisation). Bien au contraire, les qualifications traditionnelles sont d’un utile secours pour préciser les relations patrimoniales des parties, c’est-à-dire là où la théorie des droits potestatifs est en défaut : V. par ex. COLLART-DUTILLEUL (F.), « Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble », préc., n°254 qui estime que la situation du promettant dans la promesse unilatérale se compose d’une sujétion et d’une obligation de ne pas faire; Adde l’opinion de VALORY (S.), « la potestativité dans les relations contractuelles », th préc.n°47. ↑
7 BAILLOD (R.), « le droit de repentir », RTD. Civ. 1984, p.227, spéc. n°20 ; BOYER (L.), « La clause de dédit » in Mélanges RAYNAUD (P.), D., 1985, p.41; MIRABAIL (S.), « La rétractation en droit privé français », th. Toulouse 1991, Bdp.t.284, LGDJ 1997, spéc. n°177 ; VALORY (S.), « La potestativité dans les relations contractuelles », th préc. n°55. ↑
8 Ibid. ↑
9 Ibid. ↑
10 Ibid. ↑
11 Ibid. ↑
12 Ibid. ↑
13 Ibid. ↑