La performance des entreprises publiques au Cameroun a été profondément transformée par la privatisation, révélant des améliorations notables en rentabilité et productivité. Cette étude, basée sur des données empiriques, met en lumière des résultats surprenants qui redéfinissent notre compréhension de l’impact économique de la privatisation.
CHAPITRE II : CLARIFICATION CONCEPTUELLE, CADRE THEORIQUE ET TRAVAUX EMPIRIQUES
Le présent chapitre de cette étude propose d’abord, de définir les concepts clés de notre étude. Ensuite, nous évoquerons les théories en faveur de la privatisation et enfin, nous présenterons une revue de la littérature des travaux qui traitent la relation privatisation et performance des entreprises.
2.1 Clarification des concepts
Dans les paragraphes suivant nous donnons la signification des mots et expressions clés employés dans le thème, tout en précisant les définitions que nous retiendrons dans le cadre de cette étude.
2.1.1 Définition du concept d’entreprise publique
La définition de l’entreprise publique est une mission complexe au regard du flou à la fois juridique et opérationnel qui la caractérise. Mais, Selon Chevalier F. (1979), l’entreprise publique est une entreprise produisant des biens et services en vue de leur vente à un prix qui doit couvrir approximativement leur prix de revient, mais qui est la propriété de l’Etat ou placée sous son contrôle.
Au Cameroun, l’article 2, de la Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic définit les entreprises publiques suivant deux catégories : les sociétés à capital public[5] et les sociétés d’économie mixte[6].
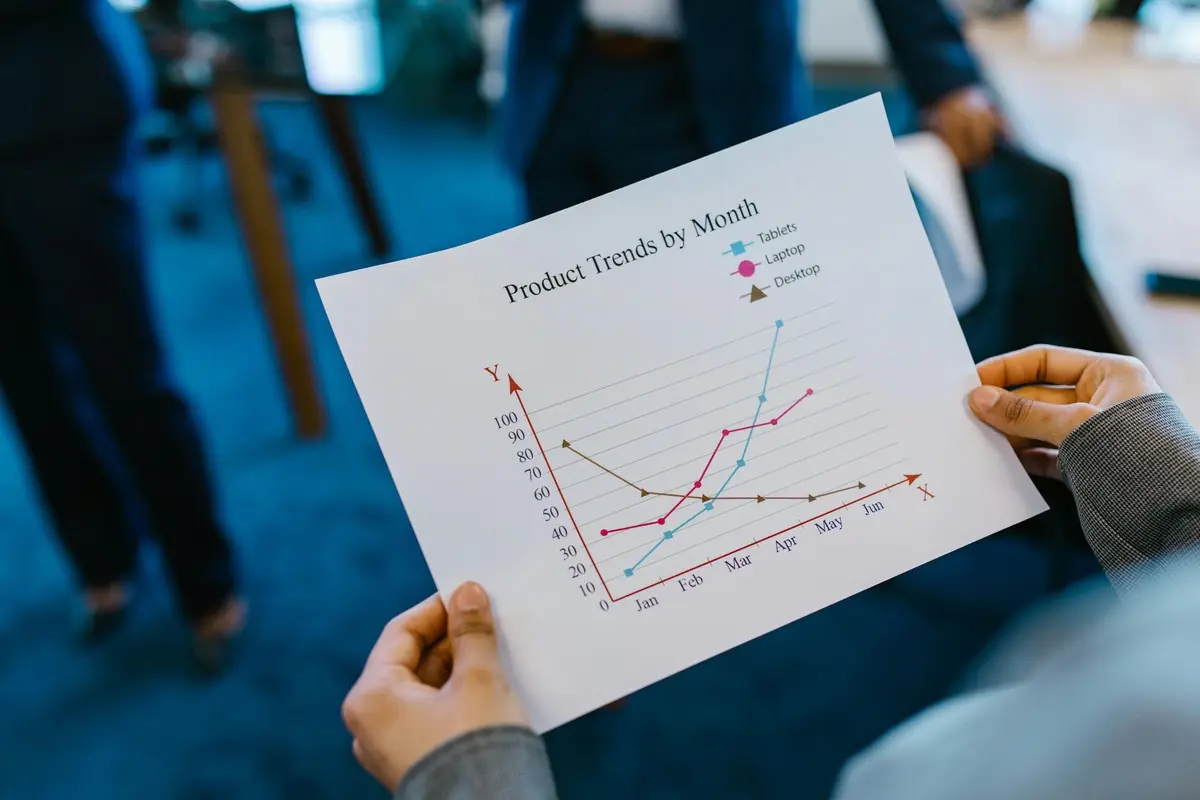
Cependant plusieurs définitions données par les spécialistes[7] de gestion permettent de mieux la distinguer de l’entreprise privée :
- L’entreprise publique est une entreprise dont le capital ou une majorité de celui-ci appartient à l’Etat ou à une collectivité publique ;
- L’entreprise publique est une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent ;
- L’entreprise publique est une entreprise qui est la propriété de l’Etat et dont les dirigeants sont nommés en Conseil des Ministres.
La multitude de définitions et d’approches de l’entreprise publique est révélatrice de la complexité du secteur dont elle relève (secteur public), notamment aux plans de sa gestion et de ses objectifs. Si l’on retient les deux éléments suivants : la structure du capital de l’entreprise et le contexte légal et réglementaire, nous pouvons dire avec Darbelet et Laugine (1984) que l’entreprise publique est une entreprise dans laquelle tout ou partie du capital et du pouvoir de décision appartient à une collectivité publique, c’est-à-dire l’Etat, une région, un département ou une commune. C’est sous cette approche que sera abordée l’entreprise publique tout au long de ce travail.
2.1.2 Définition du concept de privatisation
Dans son étymologie, le mot privatisation vient du latin « privare » qui signifie priver ou mettre à part. Elle est l’opération consistant à transférer totalement ou partiellement les activités relevant du secteur public au secteur privé (The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, 1992: 206).
La définition de la privatisation est donnée au Cameroun par l’ordonnance no 90/004 article 1er, al 1er : « aux termes de la présente ordonnance, La privatisation est l’opération par laquelle l’Etat ou un organisme public ou parapublic se désengage totalement ou partiellement au profit du secteur privé des entreprises, quelle que soit leur forme juridique (établissement public, société d’Etat, société d’économie mixte ou autre), dans laquelle il détient tout ou partie du capital ».
En effet, l’Etat qui détient la propriété d’une entreprise, se désengage progressivement ou en bloc en cédant les droits de propriété à des particuliers qui deviennent alors les nouveaux patrons. Pour exercer efficacement le contrôle de l’entreprise, le nouveau propriétaire doit pouvoir détenir la majorité du capital. Ce qui fait dire à certains auteurs que la privatisation est la cession par l’Etat de plus de la moitié du capital aux privés. C’est donc un transfert du contrôle de l’entreprise à des agents privés.
Cette conception du phénomène de privatisation justifie l’analyse faite par de nombreuses recherches sur les effets du transfert de propriété sur la performance de la firme. En effet pour la majorité d’entre elles, l’accroissement de performance attendue après chaque privatisation est dû au seul changement de propriétaire (public/privé). Mais les critiques de certains auteurs tels que Williamson (1991) et Chatelin (2001) amènent à penser que la privatisation ne saurait se limiter à la seule nature de la propriété mais qu’elle est d’avantage à l’origine d’un changement organisationnel plus complexe.
2.1.3 Concept de la performance
Le concept de performance suscite aujourd’hui d’énormes passions et de vives polémiques dans le champ de la pensée managériale. En effet, il apparaît davantage comme une notion fourre-tout, un mot-valise, sujet à de nombreuses polémiques, dépendamment des disciplines ou écoles de pensée auxquelles appartiennent les auteurs, et selon les critères et la perspective d’analyse choisie. La réalité est qu’aujourd’hui, il n’existe pas de consensus ou d’unanimité autant sur ce qu’est la performance que sur la façon de la mesurer, car chaque culture, chaque contexte sociopolitique et chaque entreprise peuvent amener des réponses différentes (Lebas, 1996).
Mesurer la performance disait Roover (1991) est une tâche complexe frustrante, difficile qui représente un vrai défi. Et pourtant, selon Lord Kelvin il y a fort longtemps, « […] ce qui ne se mesure pas, n’existe pas ». Autrement dit, si la performance existe, nous devrions non seulement être capables de la définir, de l’appréhender, mais aussi et surtout de la mesurer.
2.1.3.1 Définition et indicateurs de mesure de la performance
La définition de la performance est un exercice difficile car c’est une notion qui recouvre plusieurs acceptions, ce qui laisse présumer qu’une définition opérationnelle de la performance serait donc encore plus ardue. « Peut-on définir la performance ? », s’interrogeait Annick Bourguignon, en 1995, du fait de la polysémie qui a toujours entouré cette notion, tant dans le domaine des sciences économiques que dans celui des sciences de la gestion. Et pourtant, comme le dit si bien Lebas (1995) dans un article fort controversé, « Il faut définir la performance », même si l’on admet que l’exercice est risqué et assez périlleux. Dans la littérature, plusieurs définitions ont été données :
Pour Bourguignon (1995, 2000), la performance peut être définie à partir de trois sens généraux à savoir : la performance résultat, la performance action et la performance succès.
La performance résultat est mesurée en comparant les résultats à l’objectif fixé. La performance action est appréhendée à partir des moyens, des processus, des compétences et des qualités mise en œuvre pour atteindre ces résultats. Enfin, la performance succès est fonction des représentations de la réussite (Bessire, 1999) et varie donc en fonction des représentations que s’en font les acteurs, et de manière plus générale, l’organisation toute entière.
Albanes (1978) définit la performance comme la raison des postes de gestion, impliquant l’efficacité et l’efficience. Il définit par la suite l’efficacité comme le résultat obtenu par rapport au niveau du but recherché et l’efficience comme le résultat obtenu par rapport aux moyens mis en œuvre. L’efficience permet de répondre à des questions telles que : « est-ce que les résultats sont suffisants compte tenu des moyens mis en œuvre ? » ou « les ressources mobilisées par l’action ont-elles été exploitées de manière rentable ? ».
Frioui (2001) associe à ces deux axes de la performance, un troisième axe à savoir, la pertinence, qui est le rapport entre les moyens détenus et les objectifs fixés et poursuivis. Schématiquement on peut concevoir les composantes de la performance comme suit :
Figure 2.1: Les composantes de la performance
Objectifs
Efficacité |
Pertinence |
Ressources Résultats
Efficience |
Source: Jean-Bernard Ducrou, Hachette Technique, 2008
E.M. Morin et al. (1994) recensent quatre grandes approches théoriques de la performance : une approche économique, une approche sociale, une approche systémique et une approche politique.
L’approche économique repose sur la notion centrale d’objectifs à atteindre. Ces derniers traduisant les attentes des propriétaires dirigeants, ils sont donc souvent énoncés en termes économiques et financiers.
L’approche sociale met l’accent sur les dimensions humaines de l’organisation. E. Quinn et J. Rohrbaugh (1981) indiquent que cette approche ne néglige pas les aspects précédents mais intègre les activités nécessaires au maintien de l’organisation.
L’approche systémique est développée par opposition aux approches précédentes considérées comme trop partielles met l’accent sur les capacités de l’organisation.
L’approche politique repose sur une critique des précédentes. En effet, chacune des trois approches précédentes assigne certaines fonctions et certains buts à l’entreprise. Or, d’un point de vue distancié, tout individu peut avoir ses propres critères pour juger la performance d’une organisation. (Lebas, 1996).
Vu donc le caractère disparate de cette notion de performance, nous nous appesantirons dans notre étude sur les aspects microéconomiques de celle-ci en nous inspirant notamment de la définition de Millward et al.(1983) pour qui la performance peut être appréhendée en termes de rentabilité, de productivité et de coût ; cependant, nous nous limiterons dans notre travail au aspect rentabilité et productivité de la performance.
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la définition d’une entreprise publique au Cameroun?
Selon Chevalier F. (1979), l’entreprise publique est une entreprise produisant des biens et services en vue de leur vente à un prix qui doit couvrir approximativement leur prix de revient, mais qui est la propriété de l’Etat ou placée sous son contrôle.
Comment la privatisation affecte-t-elle la performance des entreprises publiques?
Les résultats montrent une amélioration significative de la rentabilité et de la productivité pour la majorité des entreprises étudiées après leur privatisation.
Qu’est-ce que la privatisation selon la législation camerounaise?
La privatisation est l’opération par laquelle l’Etat ou un organisme public ou parapublic se désengage totalement ou partiellement au profit du secteur privé des entreprises, quelle que soit leur forme juridique.
5. Société d’économie mixte: personne morale de droit privé, dotée de l’autonomie financière et d’un capital – actions détenu partiellement d’une part, par l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, ou les sociétés à capital public et d’autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé. ↑
6. G. Charreaux, Le gouvernement des entreprises, Editions Economica, 1997. ↑
7. Voir annexe D ↑