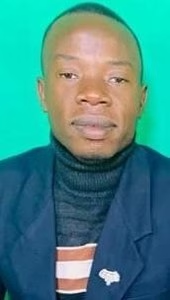La théorie des affaires courantes, issue du droit belge, illustre l’évolution d’une pratique royale vers une codification contemporaine. Cet article explore ses implications juridiques et son intégration dans le droit écrit, soulignant son caractère justiciable devant les tribunaux.
SECTION 2:
NOTION D’AFFAIRES COURANTES
La théorie d’expédition des affaires tire ses origines en droit belge comme une pratique royale, un droit non écrit. Par ailleurs, il a paru nécessaire en droit contemporain, la codification de cette théorie (§1). Ainsi, la théorie d’expédition d’affaires courantes engendre certains effets et faisant déjà partie du droit écrit, elle est justiciable de plein droit devant le juge (§2).
§1. Origine de la théorie des affaires courantes et son évolution
1. Les affaires courantes et le droit non écrit
La théorie d’expédition des affaires courantes dans son essence est la règle non écrite qui tire ses origines dans une pratique du Palais. En effet, lorsque le Roi en Belgique accepte officieusement la démission présentée par le Gouvernement, il charge ce dernier d’expédier les affaires courantes, et par conséquent de restreindre son action. Après l’avoir chargé de cette mission, le monarque refuse de signer les arrêtés royaux présentés par le cabinet démissionnaire qui excèdent la sphère desdites affaires1.
En effet, l’invasion d’un droit non écrit dans l’ordre constitutionnel dérègle les certitudes, entraîne confusions, débats et contradictions. D’où la nécessité de sa codification pour éviter ce fléau. Par ailleurs, la règle non écrite s’adapte parfaitement lorsque la période des affaires courantes est courte.
Tel est le cas du Gouvernement Augustin MATATA PONYO, démissionné le 14 novembre 2016, il expédie les affaires courantes jusque le 17 novembre 2016, soit trois jours seulement d’expédition des affaires courantes. Dans cette hypothèse, elle permet à l’État de continuer à fonctionner, jusqu’à ce qu’un gouvernement soit nommé à bref délai.
Par contre, la règle engendre un sentiment de malaise lorsque la période dure, comme ce fut le cas en RDC du Gouvernement Bruno Tshibala Nzenze, démissionné le 20 mai 2019, il expédie les affaires courantes jusque le 7 septembre 2019, soit quatre mois.
Les affaires courantes et le droit écrit
D’après Anne-Stéphanie RENSON et Marc VERDUSSEN, l’obligation pour un gouvernement de gérer les affaires courantes trouve sa justification dans l’impossibilité, pour le Parlement, d’exercer temporairement un contrôle sur l’action de celui-ci2. Comme nous l’avons souligné précédemment, le principe de continuité de l’État ou de continuité de services publics exprime le fondement de la théorie d’expédition des affaires courantes.
C’est pour quoi, ces deux principes apparaissent rituellement dans les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires3.
En République démocratique, la Constitution du 18 février 2006, dans ses 229 dispositions, ne fait nulle part mention à la notion des affaires courantes. Par ailleurs, le législateur congolais quant à lui, y fait rarement allusion.
Tels sont les cas de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, son article 31 dispose : « En cas d’adoption d’une motion de censure, le Gouvernement expédie les affaires courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Gouvernent »4.
Mais aussi, en qui concerne le chef de chefferie, l’article 84 de la Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les provinces, dispose : « En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Chef de chefferie pour un fait portant atteinte à l’honneur ou à la dignité, les trois Echevins expédient collégialement les affaires courantes en attendant la désignation du nouveau Chef de chefferie »5.
Ces deux dispositions peuvent être considérées comme la base du droit écrit des affaires courantes en droit positif congolais. Toutefois, le législateur ne définit pas cette notion ni en détermine sa durée. Ce qui ne permet pas au Gouvernement démissionnaire de savoir expressément l’étendue et la durée de leur pouvoir pendant cette période de crise.
________________________
1 MARC UYTTENDAELE, « La coutume constitutionnelle dans le droit publique belge contemporain », in Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, vol.54, Ed. De Boeck Université, 1989, p.409 ; NICOLAS BERNARD, Quelle évolution pour le concept d’affaires courantes, Actes du colloque organisé par le Centre d’Études Jacques Georgin à la Chambre des représentants, le 29 novembre 2019, p.4. ↑
2 A-S. RENSON ET M. VERDUSSEN, «Le contrôle juridictionnel des actes posés en affaires courantes », in Revue Belge de Droit constitutionnel, vol.2022, n°3, p.342. ↑
3 Tels sont les cas des articles 146 à .147 in fine de la Constitution du 18 février 2006 et l’art.41 de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatives à la libre administration des provinces. ↑
4 Article 31, Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatives à la libre administration des provinces telle que modifiée et complétée par la Loi n°13/008 du 22 janvier 2013, in J.O.R.D.C, 5e année, n° spécial, 1er février 2013. ↑
5 Art. 83, Loi organique n° 08/016 du 0 7octobre 2008 portant composition et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les provinces, in J.O.RDC, 1er partie n° spécial, 10 octobre 2008, p.24. ↑