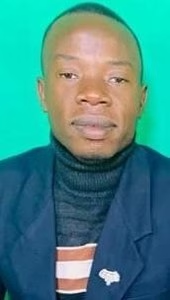La continuité des services publics est essentielle pour garantir que les ministres démissionnaires conservent un pouvoir limité afin de traiter les affaires urgentes. Cet article clarifie les limites de ce principe, soulignant qu’il ne doit pas être interprété comme une autorisation d’agir sans restrictions.
Portée
En vertu du principe de continuité de service public, les ministres démissionnaires conservent une partie de leur pouvoir pour régler les questions dont la solution ne doit souffrir d’aucun retard1. Toutefois, le principe de continuité ne saurait être assimilé à la vague qui emporterait tout sur son passage2. Car il est l’exception apportée à la règle d’incompétence en cas de désinvestiture. C’est pourquoi le gouvernement démissionnaire ne peut pas tout faire. Il ne peut rien faire, sauf ce qui est requis par les exigences de la continuité3.
Cela étant, il ne confie pas à une autorité démissionnaire un pouvoir continuel dans l’irrégularité, mais plutôt un moyen qui permet à l’Administration dans l’accomplissement de ses missions et droit au bénéfice des administrés d’obtenir une prestation optimum4.
Enfin, c’est un principe d’application générale dans la mesure où, en ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics, les autorités de tutelle sont tenues de le garantir, dans les conditions prévues par la loi. Aussi, le principe de continuité peut être aussi apprécié en termes de consistance du service public à condition qu’un texte la définisse explicitement.
Dans ce cas, le principe de continuité de l’État se déduit en continuité des services publics. Comme l’affirme le professeur GILLES GUGLIELMI de l’Université Paris-II : « le principe de continuité des services publics est le versant administratif du principe de continuité de l’État »5. Ainsi, on ne peut appréhender le principe de continuité de l’État et celui de continuité des services publics de manière séparée, car l’un conduit simplement à l’autre, implique l’autre et découle de l’autre.
Tous les deux, leur raison d’être est celle d’assurer la permanence de l’État et de ses services, quelles que soient les circonstances, car la continuité du fonctionnement des services publics essentiels à la vie nationale doit être assurée à tout prix6.
Les rapports avec d’autres principes de droit public
1. Le régime de la grève
Le Code du travail congolais considère la grève comme une cessation collective du travail à l’occasion d’un conflit collectif du travail qui n’a pas été résolu7. Il découle de ce qui précède que la grève est une cessation collective et concertée du travail par les travailleurs. Par ailleurs, la grève reflète l’existence d’un conflit collectif du travail, mais ne constitue pas le conflit lui-même.
Le conflit naît du désaccord entre employeur et travailleurs sur une question relative au régime du travail. Lorsque ce désaccord persiste, la grève devient donc l’arme dont les travailleurs peuvent s’en servir pour imposer leur prétention à l’employeur.
Elle est à cet effet, un moyen pour les travailleurs, de faire pression sur l’employeur concernant une réclamation professionnelle qui lui a été soumise. Ainsi, l’élément spécifique de la grève est un élément matériel8. Cela étant, il faut la concrétisation ou la matérialisation de la grève par les grévistes ; la mise en application de l’intention annoncée par eux.
La grève n’est pas donc une déclaration d’intention, mais un fait. Pour que le régime privilégié de la grève puisse se substituer au droit commun des relations de travail, il faut que la cessation du travail annoncée soit mise en application, elle doit donc être l’ultime recours quand toutes les autres démarches ont échoué9.
Ceci dit, quel rapport entre le régime de la grève et le principe de continuité des services publics ?
En effet, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le principe de continuité des services publics constituait un empêchement juridique à l’exercice du droit de grève dans les services publics. L’acte de grève constituait pour les agents du service public une faute10. Aujourd’hui, le droit de grève est reconnu aux agents des services publics. Mais cela pose un problème de conciliation entre ce droit, constitutionnellement reconnu, et le principe de continuité des services publics.
Le problème de fait n’a pas été vraiment résolu, le plus souvent la grève entraîne en effet l’interruption du service, ce qui serait contraire au principe de continuité de services publics. Cela, engagerait par conséquent la responsabilité du service public ou de son personnel qui est censé, dans la poursuite de l’intérêt général, à rendre ses services aux usagers sans aucune interruption.
De ceci, il ressort par ailleurs que la légalité du droit de grève n’est pas contestable en République démocratique du Congo, mais ce droit n’est absolu. Bien que constitutionnellement garanti avec les libertés syndicales auquel il s’attache, dans l’administration publique, ce droit reste modéré. Ainsi, l’article 39 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation »11. Il découle de cette disposition constitutionnelle que les grévistes de l’administration publique, surtout ceux exerçant une activité d’intérêt vital pour la nation n’ont pas un champ libre pour recourir aisément à la voie de grève et interrompre intempestivement le fonctionnement normal du service public.
Elle renvoie par ailleurs à une loi pour déterminer ces interdictions. Ainsi, l’article 93 de la Loi n° 16/ 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, dispose : « Le droit de grève est garanti à l’agent des services publics de l’État.
L’exercice de ce droit ne peut être limité que dans les conditions fixées par la loi, notamment pour tenir compte du fonctionnement régulier des services publics d’intérêt vital, qui ne peuvent souffrir d’aucune interruption. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres ayant la fonction publique et les droits humains dans leurs attributions, fixe la liste des services publics d’intérêt vital ainsi que les modalités du service minimum à imposer aux agents grévistes de ces services »12.
Ainsi, aucun décret du Premier ministre délibéré jusqu’à ce jour, ne donne la liste des services publics d’intérêt vital qui ne doivent souffrir d’aucune interruption. De même l’Arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale de 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail, n’en donne pas également13.
Toutefois, lisant son annexe, il convient de signaler qu’en cas de grève, les prestations des services indispensables notamment : la dispensation des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ; le transport des malades et blessés ; le fonctionnement des hôpitaux, cliniques, maternités sanatoriums, établissement pour des malades mentaux, crèches et pouponnières ; le fonctionnement des services publics et privés veillant à la prophylaxie des maladies contagieuses, les services de distribution d’eau et d’électricité…seront assurés par le personnel minimum nécessaire14.
La Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale relative aux instructions procédurales pour l’usage du droit de grève en RDC aux Organisations Professionnelles des Employeurs et des Travailleurs, Entreprises et Etablissements de toute nature, impose de manière générale, l’organisation par les grévistes, d’un service minimum obligatoire en faveur de la population en tant que prestations d’intérêt général, durant la grève ou la fermeture d’établissement15. Par ailleurs, nous pensons que par « Tout service d’intérêt vitale pour la nation », il faut faire allusion aux services remplissant les missions régaliennes de l’État, notamment l’armée (la défense), la police, la justice, la Banque centrale, les services de perceptions des taxes et impôts et pour ne citer que ceux-là.
Notons, cependant, que le principe de continuité ne saurait en aucun cas justifier des moyens illégaux de lutte contre la grève. L’utilisation d’entreprises de travail temporaire pour remplacer des agents publics grévistes est exclue16. Et donc, tout en assurant le principe de continuité des services, on ne doit pas porter atteinte au droit de grève constitutionnellement garanti, mais plutôt le modéré, en organisant obligatoirement le service minimum pour garantir la satisfaction de l’intérêt général à la population sans interruption complète du service public. Car dans la pratique, pendant la grève, les prestations de services publics sont insuffisamment fournies du fait de la réduction du personnel contraint qu’à rendre un service minimum nécessaire.
________________________
1 C.E., Section du contentieux administratif, La Fondation d’utilité publique « Comité belge pour l’UNICEF» et crt c/ État belge, Op.cit.,§1, p.4. ↑
2 Apporter à son passage les institutions, les règles, les procédures, les contrôles et pour ne citer que ceux-là. ↑
3 F. DELPEREE, « Gouverner sans gouvernement ? », In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome 23, 2012. p. 128-129. ↑
4 STEPHANE PINON, « Le principe de continuité services publics: du renforcement de la puissance étatique à la sauvegarde de l’expression démocratique », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2003/2 volume 51, p.74. ↑
5 J. GILLES GUGLIELMI, Op.cit., p.17. ↑
6 STEPHANE PINON, « Le principe de continuité des services publics : du renforcement de la puissance étatique à la sauvegarde de l’expression démocratique », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 51, 2003, p.70. ↑
7 Article 315, al.1, Loi n° 015/2002 du 15 octobre 2002 portant code du travail, in J.O.RDC, 47e année, numéro spécial, Kinshasa ,25 octobre 2002, p.76. ↑
8 T. MITONGO KALONJI, Droit de grève et principe de continuité dans les établissements publics (Analyse théorique en Droit congolais), Centre Africain d’Études et de Recherches en Droits de l’Homme-Yula, Lubumbashi, juillet 2009, pp.30-31. ↑
9 T. MITONGO KALONJI, Op.cit., p.31. ↑
10 J. GILLES GUGLIELMI, Op.cit., p.18. ↑
11 Art. 39, Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, in J.O. RDC, 52e année, n° spécial, Kinshasa, février 2011, p.20. ↑
12 Art. 93, Loi n° 16/ 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, Op.cit., p.33. ↑
13 Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail, in J.O.RDC, 46 ème année, 1 ère partie, Kinshasa, 5 décembre 2005. ↑
14 Annexe de l’Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail, Op.cit., p.4. ↑
15 Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale relative aux instructions procédurales pour l’usage du droit de grève en RDC aux Organisations Professionnelles des Employeurs et des Travailleurs, Entreprises et Etablissements de toute nature. ↑
16 J. MORAND-DEVILLER, Op. cit., p.399. ↑