Le cadre théorique de l’histoire révèle comment Alice Zeniter transforme la fiction en un puissant outil de réécriture historique. En explorant les silences de la Révolution algérienne, cet article offre une perspective inédite sur la valeur de la fiction littéraire dans la compréhension des événements passés.
L’écrivain face à l’Histoire :
Afin de pouvoir illustrer la relation qu’entretient le récit fictionnel avec l’Histoire référentielle, il serait utile de rappeler la voie qu’adopte Alice Zeniter pour remonter le passé et réécrire l’Histoire.
Concernant L’art de perdre, il s’agit d’un récit de rétrospection qui bascule entre l’histoire d’Ali, voire l’Histoire de la guerre trouée toujours des non-dits, et celle de Naima et Hamid les héritiers des silences, des stéréotypes et des étiquettes inhérents à leur origine.
Contrairement à la tendance traditionnelle du roman historique qui opte pour la glorification du grand homme et les événements notables, Alice Zeniter semble passionnée par les particularités des minuscules vies, celles des humbles et des marginaux, et sans rendre compte à l’événement lui-même, elle s’intéresse plutôt à ses répercussions sur l’humain, ses impacts sur le présent, et les sensations de ceux qui avaient l’occasion de témoigner.
En effet, l’histoire d’Ali, celle d’un simple paysan sur qui tombent les rancunes de la guerre, s’inscrit avant tout dans l’Histoire du pays, alors elle acquiert une dimension référentielle universelle et établit une relation directe avec l’Histoire ; or il reste toujours basé sur les fragments de la mémoire individuelle et des témoignages, Alice Zeniter écrit l’Histoire d’un point de vue personnel, elle tend même à magnifier le rôle d’Ali et cherche à le réhabiliter en l’étiquetant comme sacrifié de l’Histoire.
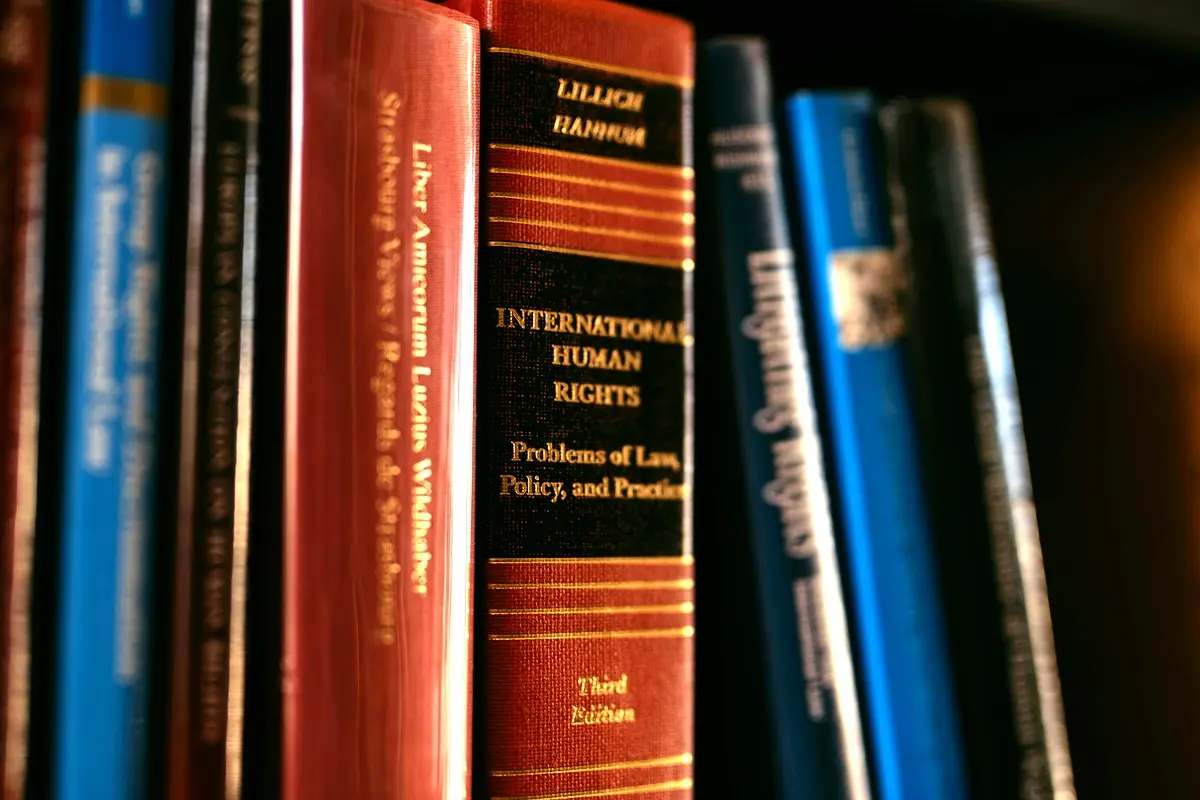
L’auteure retrace l’histoire d’Ali qui dérive de celle de l’Histoire de l’Algérie colonisée, tout en déployant en abondance les références pour renforcer sa position et attester la véracité de ses convictions ; de fait, la fiction et l’imaginaire dans le roman se lisent comme vrai, ou du moins comme des faits attestés.
Cependant, donner à lire comme vrai ne représente pas l’ultime but de l’auteure : « la fiction, elle ne dit pas ceci est la vérité, l’Algérie que je vais vous décrire est la seule, la fiction elle permet aussi de dire : sous le mot Algérie des centaines de milliers des personnes désignent des centaines de milliers des réalités différentes. »159
C’est dans le refus d’une seule et unique réalité que réside l’essence de l’œuvre d’Alice Zeniter, qui propose de reconsidérer l’Histoire officielle autrement, loin des mythes des
159 France 24, L’art de perdre, d’Alice Zeniter, in Youtube, vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=0E07LY1JeDE&t=152s (consulté le 04/08/2020 à 14:15h)
civilisations et les stéréotypes occidentaux dominants : « D’autres acceptent les versions officielles avec joie et se livrent à des compétitions de rhétorique pour mieux vanter l’œuvre civilisatrice qui suit son cours. »160
Alors elle se met à dénoncer et à déconstruire l’Histoire vue par un regard externe et soumise au conformisme occidental, et en dévoiler les mystifications ; afin de reconstruire la sienne par la littérature, une autre voie d’accès à la connaissance humaine, en l’occurrence celle de sa famille.
L’écrivaine s’interroge ainsi sur la manière dont l’Histoire est transmise : « L’Algérie, à l’été 1830, est clanique. Elle a des histoires. Or, quand l’Histoire se met au pluriel, elle commence à flirter avec le conte et la légende. »161
L’Histoire est avant tout une histoire racontée par des pluralités de voix, soumise à la subjectivité de celui qui la raconte, alors de possibles versions du fait162 se multiplient ; en effet, toujours susceptible de changer en fonction des pouvoirs en place et des idéologies :
« Le malentendu historiens-littéraires ne tombe pas du ciel. Il est inscrit dans l’HISTOIRE -c’est le cas de le dire- et dans l’écriture de notre galaxie idéologique, qui est une structure spécifique et contraignante, mais qui est aussi une genèse et un devenir ; galaxie qui, comme toutes les galaxies, est une négation de l’historicisme naïf, mais qui aussi, comme toutes les galaxies, est née, mourra, évolue, est à lire, donc, dans le relatif, donc dans le transformable. »163
À l’instar de tous les nouveaux romanciers, Alice Zeniter nous invite à repenser l’Histoire hors du dogmatisme, prône le scepticisme et la relativité d’esprit ; et sans épargner même son récit, déconseille la croyance aveugle aux mots, ce qui ne signifie pas, pour autant, de renoncer au mutisme :
« La troisième partie finit comme elle a commencé parce que Naïma dit que ce voyage l’a apaisée, sans doute, et que certaines de ses questions ont obtenu des réponses, mais il serait faux pourtant d’écrire un texte téléologique à son sujet, à la façon des romans d’apprentissage. Elle n’est arrivée nulle part au moment où je décide d’arrêter ce texte, elle est mouvement, elle va encore. »164
160 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.19.
161 Ibid, p.18.
162 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p.281.
163 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p.78.
164 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.604.
Pourtant, la fiction se veut être un élément dispensable et inhérent à la transmission de l’Histoire, ce qui ne doit pas être perçu comme une falsification ou une altération des vérités, mais un tournant vers le phénomène de signification, et pas à celui des faits165. Ainsi, le réel de la guerre d’Algérie reste encore proche et étroitement vivace dans les esprits ce qui le rend invulnérable aux altérations de fiction : « l’histoire est sans doute notre mythe. Elle combine le
« pensable » et l’origine, conformément au mode sur lequel une société se comprend »166
De surcroit, les références et les faits attestés ne sont pas suffisants pour représenter la réalité de la guerre et de la souffrance d’immigration, alors l’écrivaine n’avait qu’à avoir, inéluctablement, recours à la fiction pour assurer la transmission du sens et de l’impact de l’événement ; à cela s’ajoutent les effets de temps qui creuse entre la réalité vécue et l’instant de transcription de l’Histoire. La fiction s’opère aussi en témoignage, comme l’affirme Alice Zeniter, qui : « propose de passer par la vie quotidienne et par toutes ses expériences sensibles qu’elle a constitué »167, une idée concordante avec celle de Jean-Marie Schaeffer qui estime que
« la question primordiale posée par la fiction non pas celle des relations que la fiction entretient avec la réalité, mais celle qui consiste à voir comment elle opère dans la réalité, c’est-à-dire dans nos vie » 168
La fiction permet aussi à l’auteure de sortir du cadre de la guerre et de s’interroger sur les conditions humaines et les conséquences désastreuses du colonialisme, de dénoncer la guerre et de critiquer l’Histoire officielle dévorant des vérités : « L’Histoire de France marche toujours au côté de l’armée française. Elles vont ensemble. L’Histoire est Don Quichotte et ses rêves de grandeur ; l’armée est Sancho Pança qui trottine à ses côtés pour s’occuper des sales besognes. »169
Alors le défi pour l’écrivaine c’est de se réconcilier avec l’éthique de transmission de l’Histoire sans pour autant renoncer à la fiction, d’amalgamer la biographie et l’Histoire, avec le langage et l’imagination :
« Parmi les documents qui nous remettent devant les yeux les sentiments des générations précédentes, une littérature, une notamment une grande littérature, est incomparablement le
165 Jérôme Roger, La Critique Littéraire [1997], France, Armand Colin, 2005, p.31.
166 Certeau Michel, L’Ecriture de l’histoire, Paris, Gallimard, « Folio histoire », 1975, p.38.
167 France 24, L’art de perdre, d’Alice Zeniter, in Youtube, vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=0E07LY1JeDE&t=152s(consulté le 04/08/2020 à 14:15h)
168 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Éditions du seuil, coll. « Poétique », 1999, p.212.
169 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.18.
meilleur […] c’est donc principalement par l’étude des littératures que l’on pourra faire l’histoire morale et marcher vers les connaissances des lois psychologiques, d’où dépendent les événements. »170
170 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.18.
Et c’est toujours la différence cruciale entre l’historien et l’écrivain, entre celui qui prétend la précision et l’objectivité, et l’autre qui tente de marquer la faillite de l’Histoire officielle et la fragmentation des mémoires, et se met à chercher l’Histoire ailleurs dans le sens, et qui nous fait constater que la littérature et avant tout un art du beau langage, et que la fiction ce n’est pas forcément le contraire du réel.
Conclusion générale
Si la littérature se réclame un espace susceptible de livrer une réalité historique ; alors le grand défi pour l’écrivain c’est de se distinguer par son écriture de l’Historien ; tout en transmettant éthiquement la réalité ; c’est ce qu’affirmait Balzac171 ; et c’est ainsi qu’Alice Zeniter choisit ingénieusement une thématique à la marge de l’Histoire ; comme si elle était en train d’écrire sur une feuille blanche une histoire sans entrave historique, une Histoire qui n’a jamais existé auparavant.
Tout au long de cette étude, nous avons essayé de répondre au questionnement primordial de notre mémoire : la fiction littéraire peut-elle avoir une valeur historique dans L’Art de perdre d’Alice Zeniter ?
A travers notre analyse nous avons révélé que la fiction peut toucher tous les éléments du texte : les personnages, les évènements, l’espace et le temps, les classes sociales jugées minoritaires, et même le langage. Dans la première partie, en fictionnalisant le factuel, Alice Zeniter donne une image rétrospective à travers les souvenirs et les réminiscences émotives, démontre les stéréotypes faussés, détourne l’image atroce de la guerre par l’esthétisation et l’ellipse, révèle enfin les mystifications et les silences d’Histoire et interroge l’attitude humaine face à
l’Histoire ; en somme Alice Zeniter cherche à révéler ce que l’Histoire omet : « La supériorité de l’artiste sur l’historien c’est de s’affranchir de l’obligation de véridicité, pour exprimer le « général » et non plus le « particulier » ».172
En effet, l’altération survenue se joue dans les failles de l’Histoire, elle se produit souvent au niveau de la construction narrative. L’auteure, par ses choix esthétiques, cherche ce qui entoure l’évènement, comme les traditions, les souvenirs familiaux et la vie quotidienne pour faire comprendre le passé et lui donner une densité et une forme plus familière, et par conséquent la relation entre fiction et Histoire est souvent implicite et imperceptible ; tandis que l’historien s’attache à la transcription aveugle de l’Histoire, comme l’affirmait Pierre Barberis :
« Quant aux historiens […] il leur échappe le symbolique, le travail verbal et fictionnel, le forgeage du sens par le texte. »173
En revanche, dans la deuxième partie d’analyse nous avons vu que la fiction se veut une forme nouvelle d’écriture de l’Histoire, une réalité qui ne dit pas les choses de manière explicite, mais de manière cathartique et émotionnelle, cette altération est survenue souvent au niveau du
171 Honoré de Balzac, les chouans [1828], Paris, Gallimard, Folio, 1972, p. 497.
172 François Trémolièers, FICTION, Encyclopédie Universalis2016.
173 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p. 79.
contenu ; ce qui a permis l’auteure expose son point de vue et son propre système interprétatif, comme le disait Pierre Barbéris : « l’Histoire écrit un déjà existé. Le littéraire écrit un nouvel existant »174.
174 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p. 93.
La littérature se donne pour mission d’être une tribune pour accueillir les paroles des vaincus en défrayant de nouveaux chemins vers la réalité en proposant de nouvelles lectures interprétatives ; loin des idéologies et de l’Histoire stéréotypée ; alors dans certains contextes la fiction s’érige comme un discours critique envers l’Histoire dominante et hétéronome.
En effet, l’auteure marque le dysfonctionnement et le dévoiement de l’Histoire soumise à l’emprise idéologique ; dénonce l’Histoire sacrée qui s’est bâti sur des glorifications de personnes types et d’évènements marquants pour justifier le mythe de la civilisation occidentale.
Dans le troisième chapitre, nous avons procédé à une légitimation de l’écriture fictionnelle de l’Histoire ; en puisant dans ses souvenirs familiaux et en se référant à d’autres textes, l’auteure établit une procédure d’enquête qui révèle une démarche éthique envers la réalité qui à pour but de se sauver de l’oubli et d’assurer la transmission du savoir et de l’expérience d’une communauté souvent mise en marge.
Après tant de recherches, Alice Zeniter arrive à constituer son propre point de vue a contrario de celui du récit Historique stéréotypé et sans aucun égard pour les idéologies occidentales. La littérature préconise le scepticisme et l’acceptation des points de vue différents et propose de changer la perspective, de sortir du cadre de la guerre et de s’intéresser plutôt au versant humain de l’Histoire, et ainsi lever le voile sur d’autres vérités pas moins intéressantes que la vérité évènementielle, et nous rappeler que les personnages
étudiés sont avant tout des humains malgré tout ce qu’ils ont fait, et que l’Histoire ainsi est avant tout une version possible du fait et n’est en rien exhaustive.
En regardent l’œuvre littéraire sous l’angle de ce qu’elle peut accomplir, à savoir réveiller notre capacité de questionnement et d’empathie par son pouvoir émotif, comme le disait Pierre Barbéris : « L’effet du texte littéraire est de nous amener au bord d’une ouverture nouvelle, d’une interrogation nouvelle. »175 ; D’une certaine manière la fiction et la réalité deviendraient liées, la fiction deviendrait un moyen de dire la réalité.
Si nous avons opté pour une démarche interprétative, cela tient du fait que nous manquons de ressources fiables pour fournir des informations concernant le roman historique ; D’ailleurs,
176 George Lukacs, Le roman Historique, Paris, Payot, 1965.
177 Isabelle Durand, Le roman historique par Isabelle Durand, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=lM3uLK-Y3EY&t=2409s (05/09/2020 à 18:20h)
________________________
159 France 24, L’art de perdre, d’Alice Zeniter, in Youtube, vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=0E07LY1JeDE&t=152s (consulté le 04/08/2020 à 14:15h)
160 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.19.
161 Ibid, p.18.
162 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p.281.
163 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p.78.
164 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.604.
165 Jérôme Roger, La Critique Littéraire [1997], France, Armand Colin, 2005, p.31.
166 Certeau Michel, L’Ecriture de l’histoire, Paris, Gallimard, « Folio histoire », 1975, p.38.
167 France 24, L’art de perdre, d’Alice Zeniter, in Youtube, vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=0E07LY1JeDE&t=152s(consulté le 04/08/2020 à 14:15h)
168 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Éditions du seuil, coll. « Poétique », 1999, p.212.
169 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.18.
170 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.18.
171 Honoré de Balzac, les chouans [1828], Paris, Gallimard, Folio, 1972, p. 497.
172 François Trémolièers, FICTION, Encyclopédie Universalis2016.
173 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p. 79.
174 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p. 93.
175 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p. 93.
176 George Lukacs, Le roman Historique, Paris, Payot, 1965.
177 Isabelle Durand, Le roman historique par Isabelle Durand, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=lM3uLK-Y3EY&t=2409s (05/09/2020 à 18:20h)
Questions Fréquemment Posées
Comment Alice Zeniter utilise-t-elle la fiction pour réécrire l’Histoire dans L’Art de Perdre ?
Alice Zeniter utilise la fiction pour combler les lacunes historiques et offrir une perspective alternative sur les événements, en s’intéressant aux impacts de l’Histoire sur les vies humaines plutôt qu’aux événements eux-mêmes.
Quelle est la dimension référentielle de l’histoire d’Ali dans L’Art de Perdre ?
L’histoire d’Ali, un simple paysan, s’inscrit dans l’Histoire de l’Algérie colonisée, acquérant ainsi une dimension référentielle universelle tout en étant basée sur des fragments de mémoire individuelle et des témoignages.
Pourquoi Alice Zeniter remet-elle en question l’Histoire officielle dans son œuvre ?
Alice Zeniter remet en question l’Histoire officielle pour dénoncer et déconstruire la vision externe et conformiste de l’Histoire, proposant ainsi une autre voie d’accès à la connaissance humaine à travers la littérature.