Les stratégies de mise en œuvre de la fiction dans « L’Art de Perdre » révèlent comment Alice Zeniter transforme des récits historiques en une exploration poignante des mémoires familiales. Cette recherche met en lumière l’importance de la narration pour combler les lacunes de l’Histoire, offrant ainsi une perspective inédite sur des événements méconnus.
Monte Cassino, détourner l’indicible:
La participation à la terrible bataille de Monte Cassino est l’une des bribes d’Histoire qu’Ali a léguée à ses descendants. Alors Naima, sa petite-fille, dans son enquête du passé de sa famille, procède à une documentation minutieuse sur la bataille de Monte Cassino, aux trousses de l’histoire occultée de sa famille.
Cependant les histoires de la guerre sont souvent liées à la violence, au sanglant et au choquant, voire de l’indicible ; et à ce stade, c’est à la fiction de combler les trous des non-dits. Dans ce chapitre de Monte Cassino, l’auteure part du présent d’énonciation, celui de Naima, vers un passé lointain, celui d’Ali ; en se projetant immédiatement vers le passé, l’auteure fait mine de raconter un conte, alors que le lecteur se laissera happer facilement par
cette « attente narrative » 59:
« Naïma a prononcé plusieurs fois la phrase : « Mon grand-père a fait Monte Cassino », avec ce qu’il faut d’effroi dans la voix, même si elle n’est pas sûre de la formulation. Il serait peut-être plus juste de dire qu’on l’a forcé à faire Monte Cassino, comme on dit « on lui a fait à l’envers». »60
Au premier abord, cet extrait nous donne l’impression que l’auteure interroge même l’aptitude du langage à exprimer l’expérience de la guerre atroce, quand on voit Naïma qui arrive à percevoir ce qu’il y a d’effroyable dans le mot, mais elle n’arrive pas à l’expliquer. Alors que, et afin de détourner l’indicible, l’auteure se trouve contrainte à employer d’autres formules susceptibles d’exprimer l’atrocité et le trouble de la guerre.
Premièrement on distingue un ton ironique de la part de l’auteure qui aurait eu l’intention de désacraliser l’Histoire avec le discours comique, ensuite une approximation avec : « il serait peut-être » qui tache l’Histoire officielle d’une certaine oralité et de doute, et encore l’image littéraire : « on lui a fait à l’envers » qui rend le discours de l’auteure d’une familiarité perceptible ; des tels procédé sont à même de conférer une certaine intimité à l’évènement, l’accommoder avec l’imagination des lecteurs, et le mettre en adéquation avec la perception.
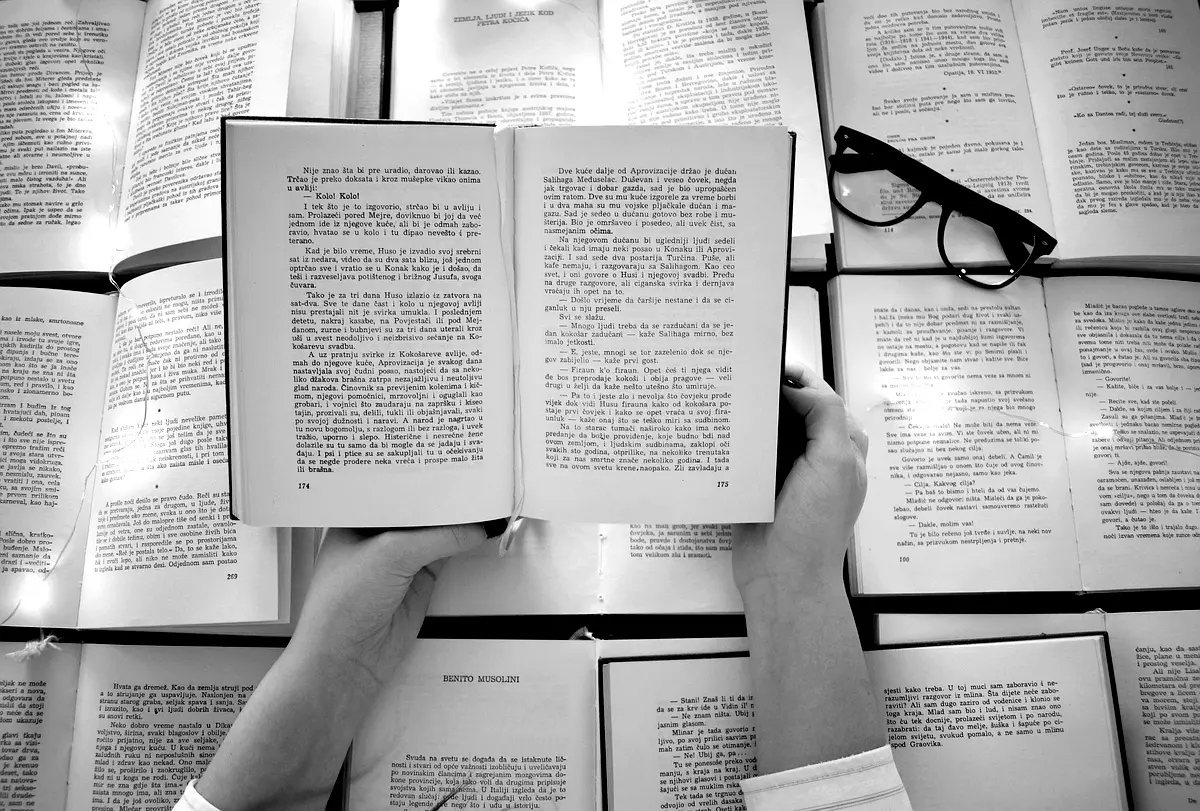
Il n’est pas anodin que l’auteure veuille dépouiller l’Histoire de son caractère sacrée, elle voudrait plutôt faire face à la mystification de l’histoire officielle, ce qui s’avère vraie par la
59 Bruno Hongre, L’intelligence de l’explication de texte, France, Ellipses, 2005, p. 123.
60 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 245.
suite : « Durant les quatre batailles du Mont, les hommes des colonies ont été envoyés en première ligne : Marocains, Tunisiens et algériens du côté français, Indiens et Néo-Zélandais du côté anglais. Ce sont eux qui fournirent les morts et les blessés qui permirent aux Alliés de perdre cinquante mille hommes sur un massif montagneux. »61
C’est comme un discours réquisitoire par lequel l’auteure s’érige contre l’abus de l’Histoire.
La synthétisation et l’ellipse sont aussi des procédés qui permettent à l’auteure de détourner l’indicible, et d’en donner les informations superficiellement, loin des descriptions précises et profondes, comme si l’auteure a du mal à décrire les scènes de l’agonie ou de la mort : « Monte Cassino, le fleuve, tout en bas, sur lequel les Alliés tentent de construire des ponts. Souvent, il coule rouge.
Monte Cassino. Les gémissements dans six ou sept langues différentes. Tous les mêmes, pourtant : J’ai peur, j’ai peur. Je ne voudrais pas mourir. »62
Du fait, l’auteure donne l’évènement comme un sens et une morale à saisir et pas comme une vision qui pourrait nuire à la bienséance du texte.
A cela on pourrait ajouter l’écriture poétique qui caractérise ce chapitre et qui peut détourner la perception du lecteur vers la musicalité : l’auteure donne la primauté à l’esthétique au détriment de la vérité poignante de la guerre.
Bien que l’auteure accorde une grande importance à ce chapitre, étant donné qu’il est le seul chapitre hérissé par un titre, l’auteure se détache complètement et à maintes reprises de cette Histoire pour s’intéresser à autre chose tel que le cinéma :
« Je crois que le début du film Indigènes est supposé montrer la bataille de Monte Cassino. On y voit l’assaut difficile d’un mont. Mais comme c’est le début du film et que l’on ne peut pas sacrifier les personnages auxquels le spectateur vient tout juste de s’attacher, c’est une bataille qui, curieusement, se passe mal sans qu’aucun gentil ne meure. Dans ma tête, Monte Cassino ressemble davantage à La Ligne rouge de Terrence Malick. C’est une longue
61 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 246.
62 Ibid.
boucherie lassante dans un lieu qu’aucune topographie ne peut rendre compréhensible. »63
L’auteure conclut ce chapitre en remettant en question l’exhaustivité de l’écriture de l’Histoire : « Parmi les soldats de l’armée d’Afrique accrochés au flanc du mont, il y a Ali, mais aussi Ben Bella et Boudiaf, respectivement premier et quatrième président de la future Algérie indépendante. Ils ne se sont pas rencontrés. Peut-être cette histoire eût-elle été très différente s’ils en avaient eu l’occasion. »64
Les bougnoules :
L’Art de Perdre, titre bien révélateur d’une énigme qui hantait l’auteure tout au long du récit, comment perdre un pays, mais un pays certainement ne pourrait pas être perdu ; il aurait été moins difficile si l’auteure se demandait comment gagner un pays, mais elle aurait risqué de spoiler tout le récit avant même de l’entamer, à savoir dans le prologue :
« Pourtant, si l’on croit Naïma, l’Algérie a toujours été là, quelque part. C’était une somme de composantes : son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs, les dimanches chez Yema. Ça, c’est une Algérie qu’elle n’a jamais pu oublier puisqu’elle la portait en elle et sur son visage. »65 Rien que le fait que son prénom soit Naima suffit à lui rappeler à l’infini que l’Algérie est toujours là ; les mots sont d’une ténacité irréductible, notamment s’ils sont ancrés dans l’Histoire ; et c’est grâce aux plumes des écrivains que ces mots deviennent domptables, Alice
Zeniter semble bien consciente de l’effet des mots :
« C’est notamment une question de vocabulaire, et donc ça évidemment passionnant pour l’écrivain, c’est de se dire au moment où on choisit un mot sans le savoir, sans s’en rendre compte, on est déjà à un endroit, à une fourche, à une bifurcation, et on tourne le dos sans le voire à tout un autre futur possible. »66
63 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 246.
64 Ibid, p. 247.
65 Ibid, p. 13.
66 La Grande Librairie, Algérie – France, destins croisés, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=XXEAH4eyTlg (consulté le 06/08/2020 à 19:17H)
En effet, dans l’Art de Perdre l’auteure remet à maintes reprises le pouvoir des mots en question, cependant le mot le plus récurent et le plus touchant dans le roman, pour qui l’auteure consacre tout un passage pour l’expliquer, c’est le mot bougnoul :
« L’une des explications étymologiques du mot « Bougnoule » le fait remonter à l’expression : Bou gnôle, le Père la Gnôle, le Père Bouteille, un terme méprisant employé à l’égard des alcooliques. Une autre la lie à l’injonction Abou gnôle (Apporte la gnôle) utilisée par les soldats maghrébins lors de la Première Guerre mondiale et reprise comme sobriquet par les Français. Si cette étymologie est juste, alors dans la salle qui leur est prêtée, Ali et ses compagnons font joyeusement – quoique discrètement – les Bougnoules. Mais en faisant les Bougnoules, ils imitent en réalité les Français. »67
Selon Le Petit Robert, le mot bougnoule c’est une injure raciste, qui qualifie péjorativement un Maghrébin ou un arabe ; et c’est toujours le sens reconnu unanimement. Cependant, l’auteure à travers une histoire qui lie le mot bougnoul à la France et à la guerre, semble viser au-delà de la signification directe et concrète du mot, elle voudrait abolir le cliché prédominant en peignant le sens figé du mot de sa propre image, de l’ironie et même de l’émotion et du souvenir, une sorte de connotations subjective68 qui s’est érigée contre le sens déconcertant du mot.
En lisant l’Art de Perdre, l’auteure nous apprend que la réalité peut résider dans l’imaginaire, que les français ainsi faisant, et atrocement, le bougnoule :
« On raconte que le propriétaire du grand Café du Centre offre sa tournée pour tout soldat qui lui rapportera l’oreille d’un fellouze. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour boire un Fernet-Branca avec des allures de héros ? Quelques recrues, au soir tombé, posent sur le comptoir de zinc un morceau sanglant de cartilage. À la santé de la France, les gars ! Vous l’avez bien mérité. »69
Un mot est une arme à double tranchant, un mot perverti peut dissimuler l’hypocrisie et la barbarie de l’Histoire, or, quand les mots tombent dans les mains de celui qui les utilise subtilement, peuvent tout déceler de l’inéquitable Histoire de la guerre, et devient un sceau de dysfonctionnement s’inscrit dans l’Histoire70.
67 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 45.
68 Bruno Hongre, L’intelligence de l’explication de texte, France, Ellipses, 2005, p. 343.
69 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 106.
70 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p. 126.
________________________
59 Bruno Hongre, L’intelligence de l’explication de texte, France, Ellipses, 2005, p. 123. ↑
60 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 245. ↑
61 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 246. ↑
63 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 246. ↑
66 La Grande Librairie, Algérie – France, destins croisés, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=XXEAH4eyTlg (consulté le 06/08/2020 à 19:17H) ↑
67 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 45. ↑
68 Bruno Hongre, L’intelligence de l’explication de texte, France, Ellipses, 2005, p. 343. ↑
69 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 106. ↑
70 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p. 126. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment Alice Zeniter utilise-t-elle la fiction pour aborder l’histoire dans ‘L’Art de Perdre’?
L’auteure utilise la fiction pour combler les lacunes historiques et offrir une perspective alternative sur les événements, en se servant de procédés comme la synthétisation et l’ellipse.
Pourquoi l’auteure remet-elle en question le caractère sacré de l’Histoire?
Elle veut faire face à la mystification de l’histoire officielle, comme le montre son discours réquisitoire contre l’abus de l’Histoire.
Quels procédés littéraires Alice Zeniter emploie-t-elle pour exprimer l’indicible dans son récit?
L’auteure emploie des procédés tels que l’ironie, l’approximation, et l’écriture poétique pour détourner l’indicible et donner une certaine intimité à l’événement.