L’approche des soins à domicile transforme radicalement la prise en charge des patients, notamment en Haïti, où les taux de mortalité maternelle et infantile demeurent alarmants. Cette recherche innovante propose un modèle hospitalier sans murs, promettant des solutions viables pour améliorer la santé maternelle dans les pays en développement.
Évolution des structures sans murs dans les pays développés et en développements
Préambule
Dans le souci d’encourager l’adaptation du patient et de l’offrir des soins complexes et continus dans sa demeure familiale, l’Hospitalisation à domicile (l’une des structures sans murs la plus populaire) a vu le jour depuis plus d’un demi-siècle9. Comme mentionné au début de ce chapitre, les États-Unis et la France, pays industriellement développés, ont les premiers à expérimenter cette forme de prise en charge.
Au même titres que les pays développés, les pays en voie de développement se trouvent confronter à des difficultés très importantes relatives à l’insuffisance des ressources, à l’inégalité géographique d’accès aux soins et l’accroissement continue des dépenses de santé.
Nous essayons, dans les sections suivantes, de vérifier l’existence des structures sanitaires sans murs dans les trois pays développés et les trois pays en voie de développement que nous avons étudié dans le chapitre I. Il consiste à analyser leur mode d’organisation, les types en vigueurs et voir si leurs modèles peuvent être compatibles à la situation haïtienne ou tout simplement les réorganiser dans un contexte haïtien.
Les structures d’HAD dans trois pays développés
La France
La structure d’hospitalisation à domicile a subi une évolution plutôt croissante dans la France métropolitaine. Cette forme de prise en charge qui a vu le jour en 1958 avec seulement un centre, se propage à travers tout le pays (voir le graphe de la figure 11). Selon les données publiées par l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) et la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile (FNEHAD), il existe en France en 2008, près de 233 établissements d’HAD.
De 2005 à 2008, les chiffres sont presque doublés en termes de statistiques. On voit, en effet, que le nombre d’établissement passe de 123 à 233 ; les journées d’hospitalisation passent de 1 505 814 à 2 777 900 ; 63 666 à 112 591 séjours complets ; et de 35 017 à 71 743.
1958 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1990 1991 1992 1997 1999 2004 2005 2006 2007 2008
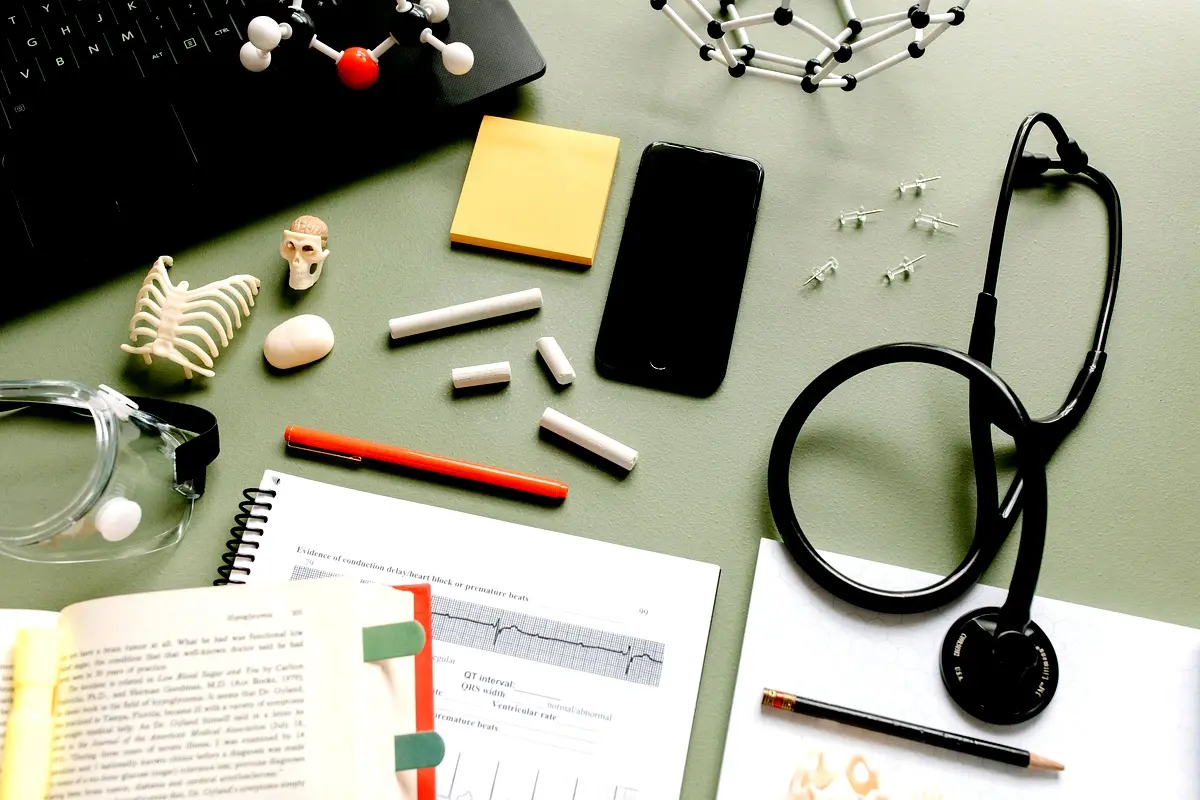
0
5
2
1
20
12
41 41
38
36
33
28
50
68
100
123
114
150
166
200
204
233
250
Evolution établissements HAD en France
Figure 11: Évolution des structures HAD en France depuis 1958
En ce qui concerne le fonctionnement de cette structure en France, certaines conditions sont établies à travers les textes réglementaires et des décrets que nous avons mentionnés précédemment. Par exemple, la nature des locaux et leurs fonctions sont prévues par l’article D. 6124-307 du code de la santé publique (CSP).
Ces textes imposent aussi aux structures d’HAD de disposer de personnels (médecin coordonnateur, de cadre(s) d’infirmier(s), des équipes de soins, de rééducation, des assistantes sociales ou psychologues) dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la nature et du volume d’activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques (article D. 6124-308 CSP).
De manière plus précise encore, afin de garantir les conditions de sécurité, l’article D. 6124-308 du CSP indique que chaque structure d’HAD doit disposer en permanence d’au moins un agent pour six patients pris en charge.
Le personnel exprimé en équivalent temps plein exerçant dans la structure en dehors des médecins, doit être constitué d’au moins pour la moitié d’infirmiers. La structure d’HAD doit comporter quelle que soit sa capacité au moins un cadre infirmier (PODEUR 2007).
En France, il y a deux catégories d’établissements d’HAD à savoir les établissements d’HAD de statut public qui dépendent directement d’une structure hospitalière constituant en quelque sorte un service spécialisé de l’hôpital, et les établissements d’HAD de statut privé gérés par des associations à but non lucratif par la loi de 1901.
Néanmoins, si l’hospitalisation à domicile peut constituer un dispositif hautement satisfaisant dans de nombreux cas, elle ne peut être mise en place que dans des conditions bien précises et incontournables :
- Accord du patient,
- Accord du médecin traitant,
- Accord et participation de l’entourage,
- Sécurité du lieu de vie.
À partir de ce constat, il paraît important qu’une offre puisse être faite d’hospitalisation à domicile sur l’ensemble de la région tout en ayant conscience que ce type de prise en charge ne constituera toujours qu’une offre complémentaire et résiduelle par rapport aux besoins d’hospitalisation.
Quoique pionniers dans le domaine de l’HAD, les américains ne font pas la distinction entre soins à domicile et H.A.D. Ils regroupent en une seule notion, le « home care », ou plus précisément le « home health care ». Contrairement au système français, le « home care » exclut la médecine libérale reposant sur le principe du déplacement du médecin hospitalier.
Donc en résumé, je présente dans le tableau 3 les grandes lignes du système de santé Français:
Table 3: Analyse du système hospitalier classique et sans murs en France
| Analyse du système hospitalier classique et sans murs en France | |
|---|---|
| Paramètre/Critère | Description/Valeur |
| Système de santé | Socialisation médicale |
| Performance | De plus en plus performant |
| Structures d’HAD | Très actives et implantation géographique étendue |
| Ratio médecin/1000 habitants (2000) | 3.30 |
| Ratio médecin/1000 habitants (2012) | 3.72 |
| Exemple à suivre | Organisation, réforme, alternative et accessibilité aux soins |
Grâce à son système de socialisation médicale, le système de santé français se révèle de plus en plus performant. Les structures d’HAD sont très actifs et continuent d’être implantées géographique un peu partout sur le territoire.
Le ratio de médecin pour 1000 habitants augmente constamment (3.30 en l’an 2000 et 3.72 en 2012). Vu la synthèse , qui est faite dans le tableau 3, nous voyons que la France peut être considérée comme un bon exemple à suivre en terme d’organisation, de réforme, d’alternative et d’accessibilité aux soins de santé.
Toutefois des améliorations continues vont permettre d’atteindre les objectifs collectifs et communautaires.
________________________
9 voir la revue prescrire Novembre 2012/Tome 32 No. 349. Page 854. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que l’hospitalisation à domicile en Haïti?
L’hospitalisation à domicile est une forme de prise en charge qui permet d’offrir des soins complexes et continus au patient dans sa demeure familiale.
Comment l’approche des soins à domicile peut-elle améliorer la santé en Haïti?
L’objectif principal est de développer une alternative viable à l’hospitalisation classique pour améliorer la prise en charge de la maternité.
Quels outils sont utilisés pour modéliser le système hospitalier haïtien?
L’étude utilise des outils comme les réseaux de Petri, le logiciel ARENA et des algorithmes d’optimisation linéaire mixte.