Les implications politiques de l’exil révèlent un paradoxe fascinant : comment la langue, souvent perçue comme un simple outil de communication, devient-elle un vecteur de déracinement identitaire ? Cette étude sur Leïla Sebbar éclaire les tensions entre culture française et arabe, offrant des perspectives essentielles sur la quête identitaire.
La langue, un facteur de quête identitaire
Dans un premier temps, il important de savoir que la langue est une partie intégrante de notre identité. Elle forme un élément important pendant chaque échange identitaire et culturel ainsi la langue maternelle joue un rôle essentiel dans la construction de notre soi parce qu’elle est inséparable de la pensée, à ce sujet le psychologue français Delacroix confirme que « la pensée fait le langage en se faisant par le langage »42, de ce fait, la langue est également comme le premier responsable d’une identité collective.
Mais si cette langue maternelle est méconnue, inconnue ou perdue, ici on est confronté à un questionnement obsédant et douloureux que résume bien Mohammed Dib dans L’arbre à dires : « Je parle une autre langue : qui suis-je ? »43 Cette interrogation sur le rapport entre sa langue maternelle et sa langue d’écriture suppose une rupture et un complexe d’appartenance linguistique.
Ce principe est justement central dans notre travail de recherche dans ce sens qu’il nous permet de saisir le lien qui existe entre la langue exigée ( le français) de l’écrivaine issue de mariage mixte, et sa langue paternelle (l’arabe) très tôt entendue et cependant jamais apprise. Ce principe sera abordé d’un point de vue psychologique.
De prime abord, nous tenterons de dégager que le roman Je ne parle pas la langue de mon père ne révèle pas uniquement un problème identitaire : culturel ou religieux mais également linguistique. Il évoque un exemple de divergence linguistique et culturelle. C’est
42 Rôle des langues dans la construction de l’identité des immigrés, [en ligne] in : http://www.memoireonline.com/10/9/2784/m_Rle_des_langues_dans-la-construction-de-lidentite-des-immigres- italiens-et-de-leurs-descendan11.html (consulté le : 09/03/2017)
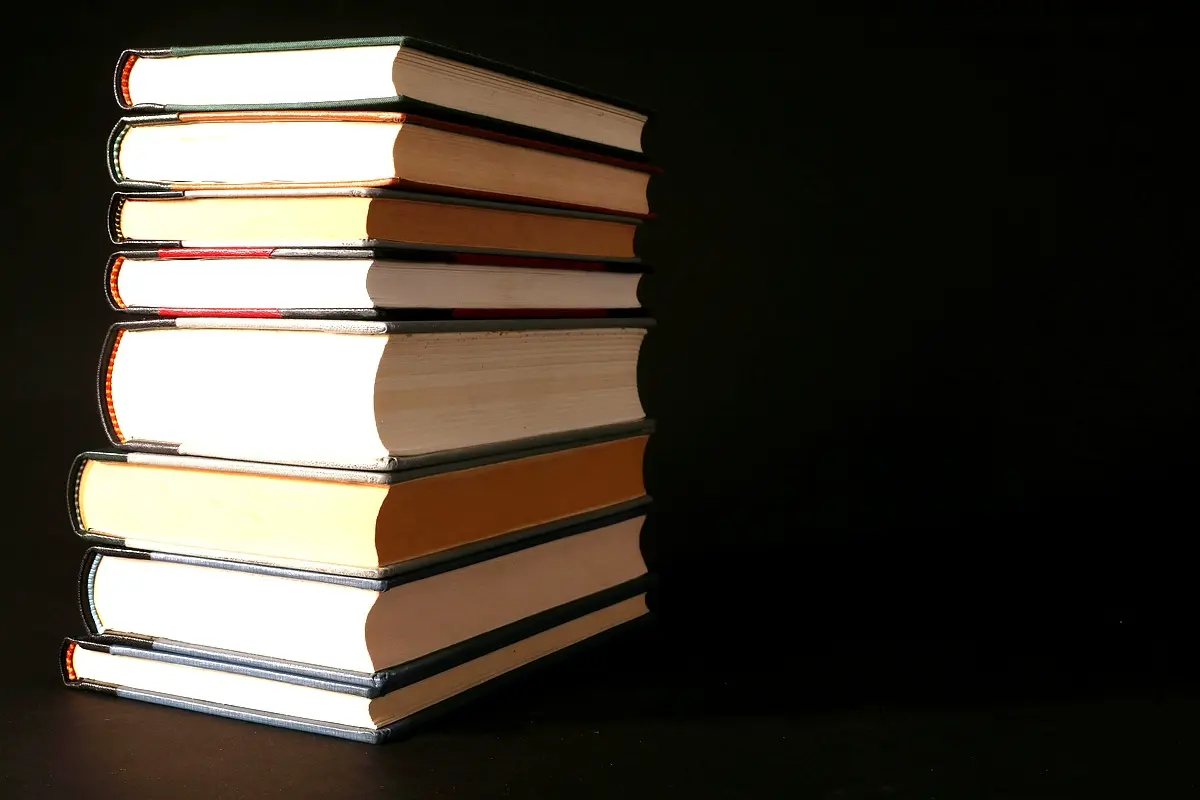
43DIB, Mohammed, L’Arbre à dires, Paris, Albin Michel, 1998.
pour cette raison tout au long de son roman Leïla Sebbar raconte sa difficulté avec la langue, notamment les obstacles qu’elle a croisés avec la langue arabe, et plus précisément le parler algérien parce qu’elle ne possède que le français. Donc elle a décidé d’utiliser cette langue pour exprimer son blocage linguistique et pour nous raconter sa quête d’arabité.
La langue arabe pour Leïla Sebbar reste impénétrable ainsi imperméable c’est un rêve impossible à atteindre, ce conflit que vit péniblement l’écrivaine est le seul porteur du malaise, de blessure et de sa souffrance avec la reconstruction de soi à travers le texte et l’écriture en langue française. Ainsi la langue française n’est qu’un moyen pour transmettre la souffrance itérative chez Leïla Sebbar.
De ce fait, l’écriture est une utopie qui ôte le déracinement et le déchirement chez notre écrivaine, et rend perceptible cette séparation avec la langue, aussi elle creuse l’écart que fait le père de Leïla, c’est pour cela l’auteure dans son récit met un terme en quelque sorte de divorce qui s’est pénétré entre elle et son père car l’instituteur Sebbar n’incite pas l’utilisation de sa langue natale par ses enfants et donc excluait une acculturation, pour lui, c’est une façon de protection.
Leïla Sebbar avait déjà signalé l’importance de l’écriture dans sa construction de soi et sa quête de la langue perdue « peut être que je m’approche à moi-même grâce aux autres et que je cherche à aller à la source de mon inspiration littéraire du côté de l’enfance en Algérie coloniale, de la guerre d’Algérie, de mon identité métisse, du silence de la langue arabe, la langue de mon père »44
Notre romancière est consciente que la seule solution pour survenir à construire son identité est la langue arabe, c’est elle qui lui a autorisée de fusionner et côtoyer à la communauté algérienne, de la sorte que cette langue est attachée à son identité. C’est pour cette raison elle pose toujours la même question : Comment vivre séparée de la langue de mon père?
Cette question échappe à chaque fois car elle sait bien qu’elle ne pourra jamais maîtriser sa langue paternelle qui la sépare des autres, de ses origines de pays de son père, elle regrette néanmoins cet entourage qu’elle considère comme un monde mystérieux, nous prenons l’exemple du dernier chapitre : « Je n’apprendrai pas la langue de mon père, je veux l’entendre, au hasard de mes pérégrination.
Entendre la voix de l’étranger bien aimé, la voix de la terre et du corps de mon père que j’écris dans la langue de ma mère »45
44KIAN, Soheïla, entrevue avec Leïla Sebbar : L’écriture et l’altérité, octobre 2004, pp. 128-136
45SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, p 125
De surcroît, on peut déduire par la suite que la langue paternelle est inaccessible imperméable et impossible à l’atteindre chez l’écrivaine, cela veut dire qu’elle ne peut pas s’identifier ni arriver à une identité algérienne stable, donc elle est impuissante de se reconnaitre. Cependant Leïla Sebbar maîtrise bien la langue française, elle parle et prononce couramment cette langue ainsi ses parents communiquent avec elle en français, de ce fait, la véritable langue de l’écrivaine est le français, elle grandira dans cette langue elle écrit en
français qui est le seul véhicule de sa création littéraire, elle étudie en français, elle écoute en français. Cette langue, plus que jamais maternelle, lui permet de dire et raconter à sa façon les moments de sa vie qu’elle manqua ainsi de dévoiler sa filiation rompue, elle a écrit : « Je suis Française, écrivain français de mère française et père algérien…, et les sujets de mes livres ne sont pas mon identité, ils sont le signe, les signes de mon histoire de croisée, de
métisse obsédée par sa route et les chemins de traverse. »46
En effet, Je ne parle pas la langue de mon père, ce récit émouvant est écrit dans une langue impeccable aussi annoncé par un rythme touchant où l’auteure essaye d’éloigner le déchirement, l’inquiétude, et l’instabilité pour faire placer la sagesse. En rendant sa langue accessible afin d’arriver à dénouer cette énigme indéchiffrable sur le mutisme de la langue du père (une seule langue pour deux parents appartenant à deux pays différents et chacun des deux dans le pays de l’autre), de ce fait on peut déduire que toute l’œuvre de Leïla Sebbar vise à rétablir « une filiation rompue », on devinant son père dans la langue de sa mère.
Cette façon d’exposer cette distance envers la langue reflète certainement l’inconscient de l’écrivaine qui apparaît malgré elle, pour révéler la souffrance et le déséquilibre identitaire que cause la langue de l’autre. Dans le même contexte nous remarquons que Leïla Sebbar dans son texte, reproche sa méconnaissance de la langue de son père, elle le considère comme un premier responsable de cette ignorance et ce blocage linguistique, en blâmant son père, elle lui affectait ses émotions accusatrices, le chapitre « Mon père ne m’a pas appris
la langue de sa mère » résume bel et bien cette idée : « Mon père, avec lui nous séparait de sa terre, de la langue de sa terre. Pourtant tout autour de l’école c’était l’arabe. »47
Cela veut dire que l’arabe est envisagé comme un véritable tiraillement entre elle et son identité. À cause de cette langue Leïla Sebbar ne peut pas imposer son existence ni dans sa famille ni dans sa société et même dans son pays natal. Elle la rend impassible sans aucune
46SEBBAR, Leïla, Nancy Huston, Lettres parisiennes, Autopsie de l’exil, Paris, Edition J’ai lu, 1999, p134
47 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, P. 45
puissance. Malgré cette complication linguistique, notre écrivaine aime bien la langue arabe, elle la trouve comme une merveille pour un étranger qui est passionné à l’écouter.
De la sorte, sans pourtant ne connaître aucun mot de l’arabe classique, Leïla Sebbar était très intéressée par les poèmes lus par Mahmoud Darwich. Certes elle a toujours ce sentiment de plus enfoncé et plus proche à son cœur, la même émotion lui provient lorsqu’elle écoute le Coran avec ses assonances des rimes de versets et ses rythmes internes, elle témoigne ainsi :
« j’aimerais, a-t-elle dit récemment, avoir trouvé de livre en livre l’émotion mélodique de la langue arabe dans l’émotion orale de la langue française (ce qui ne signifie pas écrire le langage parlé »48
En outre, l’attachement de l’écrivaine à la langue arabe, on peut l’expliquer à travers l’usage des termes d’origine arabe emprunté dans son texte à titre d’exemple : l’eau du Zemzem, l’eau miraculeuse, le haïk, la Kaaba, Cheikh, etc. Ces expressions tirées de l’arabe dans un texte français indiquent l’influence mutuelle de ces deux langues chez Leila Sebbar, ceci attribue à l’apparition d’un charabia, comme il est écrit dans notre corpus :
Jema la galeta savavou couman Y a du boure doudan…
(J’aime la galette, savez-vous comment Avec du beurre dedans…)49
________________________
42 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
43 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
44KIAN, Soheïla, entrevue avec Leïla Sebbar : L’écriture et l’altérité, octobre 2004, pp. 128-136 ↑
45SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, p 125 ↑
46SEBBAR, Leïla, Nancy Huston, Lettres parisiennes, Autopsie de l’exil, Paris, Edition J’ai lu, 1999, p134 ↑
47 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, P. 45 ↑
48 j’aimerais, a-t-elle dit récemment, avoir trouvé de livre en livre l’émotion mélodique de la langue arabe dans l’émotion orale de la langue française (ce qui ne signifie pas écrire le langage parlé ↑
49(J’aime la galette, savez-vous comment Avec du beurre dedans…) ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les implications politiques de l’exil chez Leïla Sebbar ?
L’exil chez Leïla Sebbar est lié à une quête identitaire et à une souffrance existentielle qui devient source de création littéraire.
Comment la langue influence-t-elle l’identité dans le roman de Leïla Sebbar ?
La langue est une partie intégrante de l’identité et joue un rôle essentiel dans la construction de soi, notamment à travers le tiraillement entre le français et l’arabe.
Pourquoi Leïla Sebbar éprouve-t-elle des difficultés avec la langue arabe ?
Leïla Sebbar éprouve des difficultés avec la langue arabe car elle ne l’a jamais apprise, ce qui crée un conflit et un malaise identitaire.