Le rapport d’audit fiscal PME révèle une réalité surprenante : l’absence de normes établies laisse une liberté inédite aux auditeurs. Cette étude met en lumière les enjeux cruciaux de la gestion des risques fiscaux, offrant des solutions innovantes pour les experts-comptables désireux d’améliorer leur pratique.
Section 3 :
Le rapport d’audit fiscal
Si en matière d’audit financier, les instances professionnelles ont élaboré des normes de rapport, dans le cadre de l’audit fiscal en revanche, de telles normes n’existent pas. Les auditeurs disposent donc d’une grande liberté en la matière. Certaines caractéristiques du rapport peuvent toutefois être prédéterminées d’un commun accord entre les parties; d’autres en revanche sont nécessairement laissées à l’initiative de l’auditeur en fonction des constatations effectuées tout au long de sa mission.
Quelles que soient les attentes du client, le rapport final de la mission d’audit doit comporter deux points dont la rédaction ne peut être laissée qu’à l’initiative de l’auditeur. En premier lieu, celui-ci doit faire référence aux différents travaux qu’il a effectués dans le cadre de sa mission. Cette description est importante, notamment en cas de litige ultérieur entre les parties, afin de justifier le coût de la mission et d’apprécier la qualité des travaux effectués par l’auditeur, et déterminer ainsi si celui-ci a été diligent ou non en cas de mise en cause de sa responsabilité par l’entreprise auditée.
267M.Cozian, Abus de droit, simulation et planning fiscal: Bulletin fiscal, Francis Lefebvre, 1984, n°12, p.623.
268M.Chadefaux, L’audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.268.
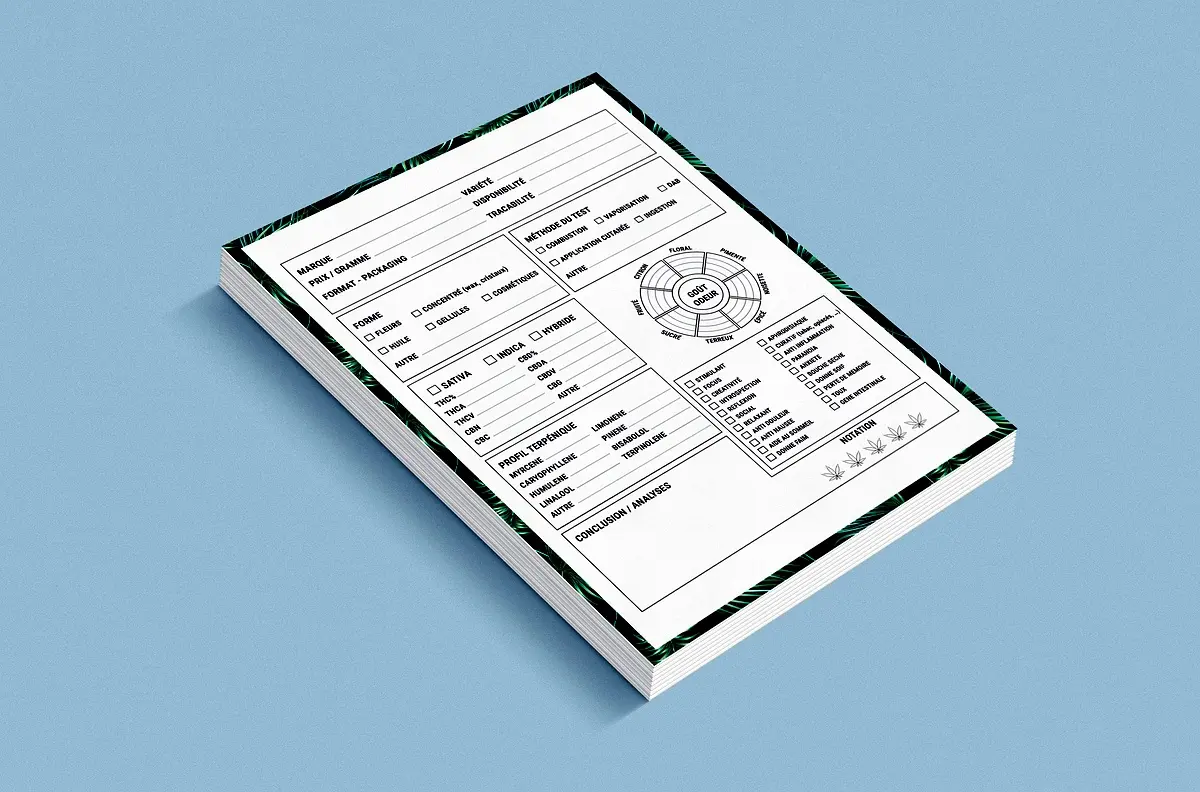
Ensuite, il importe que l’entité auditée ait bien conscience des conditions dans lesquelles l’auditeur a pu effectuer ses investigations et en particulier des difficultés qu’il rencontre.
L’auditeur doit pour cela énoncer les contrôles auxquels il n’a pu procéder et les raisons pour lesquelles ces contrôles n’ont pu être effectués.
De cette façon, l’auditeur présente dans son rapport à son client les éléments essentiels qui sont : les objectifs de la mission, les travaux effectués ou ceux qui n’ont pu l’être pour atteindre de tels objectifs, et enfin, les conclusions auxquelles il est parvenu. Cela permet de rapprocher les conclusions des travaux, de les relativiser, de bien mettre en évidence les bases sur lesquelles les conclusions, et le cas échéant les recommandations, ont été formulées269.
Le rapport d’audit fiscal devrait comporter les parties suivantes présentées dans l’ordre suivant: 1ère partie: Régime fiscal de l’entité auditée
2ème partie: La mesure du risque fiscal
3ème partie: Les recommandations pour corriger les anomalies constatées ou réduire le risque fiscal.
4ème partie: les recommandations pour améliorer l’efficacité fiscale.
Il est cependant nécessaire de rappeler au niveau du rapport d’audit les clauses convenues dans la lettre de mission se rapportant aux objectifs de la mission, à la période sur laquelle porte la mission, à l’étendue de l’activité de l’entité concernée par la mission d’audit et la variété des impôts concernés par la mission.
Sous-section 1: Régime fiscal de l’entité auditée
Dans cette première partie du rapport, l’auditeur fiscal expose (même à titre de rappel) le régime fiscal de la société, qui a été défini au début de la mission et qui a servi de base à l’audit fiscal.
Cette partie est très utile pour les raisons suivantes270:
- Les utilisateurs du rapport d’audit fiscal ne sont pas tous des spécialistes en fiscalité, et peuvent par conséquent, ne pas comprendre certains ou plusieurs passages du rapport s’ils n’ont pas été au début informés du régime fiscal applicable à la société;
- La plupart des anomalies et insuffisances qui seront soulevées dans le corps du rapport sont dues à une déviation par rapport au régime fiscal applicable à l’entité, d’où la nécessité de rappeler les grandes lignes du régime fiscal pour permettre de situer l’insuffisance par rapport à l’obligation.
269M.Chadefaux, L’audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.208.
270K.Thabet, Séminaire la théorie de l’audit fiscal, lumière formation, 2007.
Sous-section 2: La mesure du risque fiscal
Pour une bonne approche du calcul de risque en matière d’IS par exemple, il convient de distinguer deux notions qui sont utilisées dans les développements de notre mémoire: risque en base et risque en droits.
Le risque en base correspond au montant estimé du rehaussement du résultat fiscal de l’exercice considéré271.
Le risque en droits correspond au supplément d’IS résultant, pour l’exercice considéré, de la prise en compte de ce rehaussement272.
Le risque en droits calculés ne constitue pas nécessairement un risque définitif. En effet, le risque définitif doit être calculé en tenant compte des éventuelles perspectives de réduction qu’entraîne le rehaussement273.
Lorsque le risque est uniquement lié à la prise en compte erronée dans le temps d’un produit ou d’une charge, il ne s’agit que d’un risque temporaire, encore appelé « risque de timing ». Dans ce cas, le coût définitif du redressement est généralement limité aux pénalités de retard274.
Cette deuxième partie comporte notamment:
- Les anomalies et irrégularités relevées, au niveau du régime fiscal appliqué par la société;
- Les anomalies et irrégularités relevées, au niveau de l’application de ce régime fiscal;
- La mesure du risque fiscal encouru par la société (en principal) ainsi que les pénalités y afférentes.
271M.H.Pinard-Fabro, Audit fiscal, Editions Francis Lefebvre, 2008, p.37.
272Op. cit, page 37. 273Op. cit, page 38. 274Op. cit, page 38.
La mesure du risque fiscal peut être présentée selon le tableau suivant:
| Impôts/Taxes | |
|---|---|
| Montants déclarés | Montants qui |
| Risque en base | Risque en droits |
| Définitif | De timing |
| Incidence sur l’IS | Ecart positif |
| Référence ou | en base |
| pourraient être réclamés en base | (écart négatif) |
| Principal | Pénalités |
| de retard | Principal |
| Pénalités | de retard |
| (Déduction en cascade) | (Manque à gagner ou paiements indus) |
| Renvoi à une page ou une annexe | |
| IS | |
| Acomptes provisionnels | |
| Retenues à la source | |
| TVA | |
| Droit de Consommation | |
| TCL | |
| TFP | |
| FOPROLOS | |
| Autres impôts et taxes | |
| Totaux | |
Sous-section 3: Les recommandations pour corriger les anomalies constatées ou réduire le risque fiscal
Cette troisième partie comporte notamment:
- Les recommandations préconisées à titre curatif;
- Les recommandations préconisées à titre préventif: Propositions d’un plan d’amélioration. Ces recommandations doivent être suivies des actions nécessaires à leur mise en œuvre. Ces actions sont de deux sortes: Des actions de correction et des actions d’amélioration.
Nous illustrons à titre d’exemples:
- Dépôt d’une déclaration d’employeur rectificative: Les honoraires, commissions, courtages, ristournes commerciales ou non et rémunérations payés aux salariés et aux non salariés en contrepartie d’un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale supportés par l’entité auditée ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable s’ils ne sont pas déclarés au niveau de la déclaration de l’employeur. Néanmoins, l’auditeur peut recommander le dépôt d’une déclaration d’employeur rectificative afin d’éviter la sanction de la non déductibilité du montant omis ou non porté sur la déclaration dite de l’employeur tant qu’aucun contrôle fiscal n’est intervenu275.
- Demande de la restitution d’un crédit de TVA, de retenues à la source non imputées, ou d’acomptes provisionnels avant le délai limite: En vertu de l’article 28 du CDPF, l’action en restitution des sommes payées en trop doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l’impôt est devenu restituable conformément à la législation fiscale et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la date du recouvrement par le trésor. Toutefois, le délai de cinq ans n’est applicable lorsque l’impôt est devenu restituable en vertu d’un jugement ou d’un arrêt de justice. L’auditeur fiscal peut recommander le dépôt d’une demande en restitution du crédit d’impôt avant la date limite prévu par l’article 28 du CDPF. A défaut, passé cette date limite, le droit à restitution est forclos et le crédit d’impôt perd sa qualité de restituable mais reste reportable sur l’impôt dû ultérieurement276.
- Constater la perte de l’exercice en amortissements différés dans les limites et conditions prévues par la loi afin de bénéficier du report indéfini de la perte.
275R.Yaich, L’impôt sur les sociétés 2007: Maîtrise des risques fiscaux, Les Editions Raouf Yaich, 2007, p.304.
276Op. cit, page 307.
________________________
267 M.Cozian, Abus de droit, simulation et planning fiscal: Bulletin fiscal, Francis Lefebvre, 1984, n°12, p.623. ↑
268 M.Chadefaux, L’audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.268. ↑
269 M.Chadefaux, L’audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.208. ↑
270 K.Thabet, Séminaire la théorie de l’audit fiscal, lumière formation, 2007. ↑
271 M.H.Pinard-Fabro, Audit fiscal, Editions Francis Lefebvre, 2008, p.37. ↑
275 R.Yaich, L’impôt sur les sociétés 2007: Maîtrise des risques fiscaux, Les Editions Raouf Yaich, 2007, p.304. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce qu’un rapport d’audit fiscal pour les PME ?
Le rapport d’audit fiscal est un document qui présente les travaux effectués par l’auditeur, les objectifs de la mission, ainsi que les conclusions et recommandations formulées.
Pourquoi est-il important de rappeler le régime fiscal dans un rapport d’audit fiscal ?
Il est important de rappeler le régime fiscal pour que les utilisateurs du rapport, qui ne sont pas tous des spécialistes en fiscalité, puissent comprendre les anomalies et insuffisances soulevées.
Quels éléments doivent figurer dans un rapport d’audit fiscal ?
Le rapport d’audit fiscal doit comporter le régime fiscal de l’entité auditée, la mesure du risque fiscal, des recommandations pour corriger les anomalies, et des recommandations pour améliorer l’efficacité fiscale.
Comment l’auditeur justifie-t-il ses travaux dans le rapport d’audit fiscal ?
L’auditeur justifie ses travaux en décrivant les contrôles effectués, ceux qui n’ont pu l’être, et les raisons de ces limitations, afin de clarifier la qualité de sa mission.